Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang présentent dans DC Mini, nom emprunté à Kon Satoshi, une chronique pour aborder « ce dont le Japon rêve encore, et peut-être plus encore ce dont il ne rêve plus ». Ils évoquent ici le festival Nippon Connection, dont l’édition virtuelle s’est tenue du 9 au 14 juin dernier.
Marion Klomfass, directrice du festival Nippon Connection à Francfort, avait conçu de nombreux événements pour célébrer la vingtième édition de cette manifestation. Dans le contexte actuel de la pandémie, elle a néanmoins réussi à organiser des versions virtuelles de son programme ambitieux, qui comprenait 70 films (courts et longs) ainsi que des échanges préenregistrés avec divers cinéastes dont Werner Herzog (Family Romance, LLC), Hirabayashi Isamu (SHELL and JOINT), et Hirose Nanako (Book-Paper-Scissors). Des conférences en streaming ainsi que des tables rondes de circonstance autour de l’avenir post-covid de l’industrie cinématographique au Japon (avec Karen Severns du club des correspondants internationaux au Japon s’entretenant avec Ichiyama Shozo de Tokyo FilmEX, la productrice Takamatsu Miyuki, et le réalisateur Yukisada Isao) et Nippon Connection 2020 – Deux Décennies de Cinéma Japonais (un échange mené par Alexander Zahlten de l’université Harvard, autrefois membre du comité de programmation du festival, avec Stephan Holl de Rapid Eye Movies, Marion Klomfass, et Tom Mes, co-fondateur du site Midnight Eye). ‘Qui s’exprime au nom du cinéma japonais‘ aurait pu faire l’objet d’une autre table ronde.
Soulignons cependant un important programme de films explorant le thème d’un avenir ‘distinct’, celui des femmes, afin de s’interroger si celles-ci offraient d’autres regards sur le Japon, et sur les rôles qu’elles occupent dans le cinéma japonais actuel. Il était composé d’une sélection de films de fiction et documentaires mis en scène par des réalisatrices. Une autre table ronde anglo-centriste accompagnait ce programme et soulignait, sinon la limite d’un réseau, du moins un parti-pris quant à la parole portée sur cette cinématographie.
Yangyu Zhang et moi avons retenu six titres, cinq documentaires et un film adapté d’une histoire vraie qui fit également l’objet d’un documentaire, les deux films des portraits d’une courageuse journaliste de Tokyo. Ces deux films furent réalisés par des hommes.
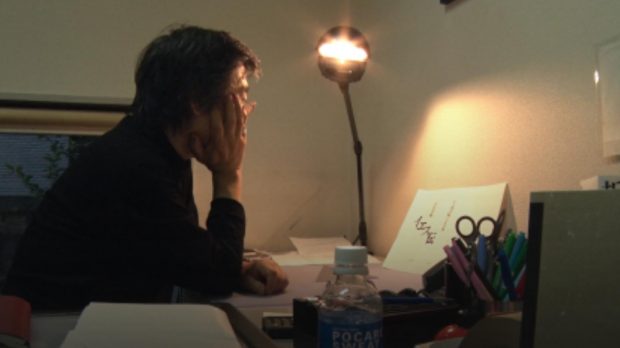
Book-Paper Scissors de Hirose Nanako répondait sans hésiter quant à ce futur au féminin qui tourmente le Japon. Le film retrace la carrière et la méthode artisanale Kikuchi Nobuyoshi, un graphiste de 75 ans avec plus de 15 000 couvertures de livres derrière lui, toutes conçues à la main. Hirose, autrefois assistante-réalisatrice de Kore-eda Hirokazu, qui a depuis signé un remarquable premier long-métrage, His Lost Name, a passé trois ans à construire ce monument à Kikuchi, dont la vocation s’ouvre et prend fin avec l’oeuvre de Maurice Blanchot, lorsqu’il découvrit la traduction japonaise de L’Espace Littéraire, le menant à ce qui allait devenir le couronnement de sa carrière, concevoir les couvertures des volumes de la traduction de L’Entretien Infini de Blanchot. Entre les deux, Hirose construit une chronologie de révolutions graphiques dues à Kikuchi dont l’artisanat traditionnel résonna à travers le milieu de l’édition, et le transforme, alors que se pointe à l’horizon les outils numériques.
Tout cela avec un accompagnement jazz, touche à la Murakami devenue indispensable pour tant de documentaires japonais contemporains. Hirose expliquait que son père fut également graphiste ; le film est ainsi une tâche accomplie par amour, comme l’est celui que Kikuchi porte à son travail au fil des décennies. La réalisatrice introduit un jeune graphiste qui « ose » montrer un projet récent et se voit réduit en pièces par un Kikuchi souriant. Le film accumule les moments de férocité splendide de son sujet, et vaut largement le détour, ne serait-ce que pour cette anecdote de fin lorsqu’il explique son concept derrière le design pour le texte de Blanchot. Il rappelle qu’au moment où Blanchot écrivait L’Entretien, il « fréquentait » Marguerite Duras. Son choix du papier pour la couverture devait évoquer la peau de Duras tandis que la jaquette se rapprochait de sa lingerie. Et non des caleçons boxer de Blanchot.
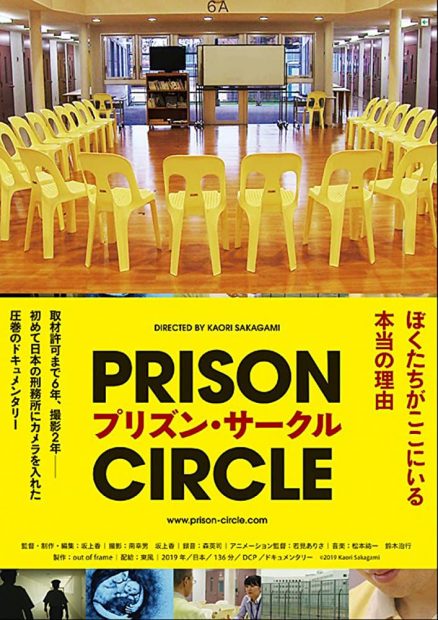
Avec Prison Circle, Sakagami Kaori se retrouve également dans un cadre entièrement masculin, réalisant le premier long-métrage sur le système carcéral au Japon. Pendant qu’elle tournait deux films sur les prisons en Amérique, elle œuvra pendant six ans à obtenir l’autorisation de tourner dans une prison au Japon, le Centre de Réhabilitation de Shimane Asahi, qui s’appuie sur un programme précis ayant pour nom ‘communautés thérapeutiques’, une forme de traitement qui s’appuie sur les échanges de groupe.
Son film retient quatre jeunes détenus sur la durée de ce programme de deux ans. La réalisatrice peut mener des entretiens, toujours supervisés, avec chacun d’eux. Ils parlent tous d’un traumatisme d’enfance, aux mains d’une brute à l’école ou de parents sans amour. Ils parlent d’un Japon qui semble loin derrière et pourtant leurs récits eurent lieu dans les années 90. Chacun partage un souvenir qui explique, croient-ils, le chemin qu’ils ont pris ; ces souvenirs deviennent ensuite des séquences animées par Wakami Arisa.
Ses sujets n’ont pas tous la même capacité engageante, et bien que la composition et quelques plans-séquence font penser à un Wang Bing aseptisé, le film fait preuve d’une sentimentalité proche de Kore-eda. L’absence de concept pour qualifier ce qu’est l’incarcération, pour les hommes et les femmes, traverse tout le film. Aucune réponse ne provient au spectateur, ni des psychologues ni du directeur de la prison.

Kamata Reika, avec Saito Jun-Ichi, met plus 90 minutes à raconter ce qui aurait pu être un passionnant sujet de 52 minutes, riche en sous-entendus chers à Imamura Shohei. Sleeping Village veut nous faire entendre une voix que des magistrats ont refusé d’écouter. Elle appartenait à Okunishi, un villageois de la préfecture de Nara, un homme coincé dans un triangle amoureux (épouse et maîtresse), accusé à 35 ans, en 1961, d’avoir tué cinq femmes en leur ayant offert du vin empoisonné. À celle-ci s’ajoute celle de Nakadai Tatsuya, narrateur du récit judiciaire, comme pour un épisode des « Experts Nara« . Le ton rocailleux, le débit ralenti amènent une cohérence à des décennies de soubresauts menant à la déception de tous ceux qui crurent que la confession de Okunishi fut obtenue sous pression par la police et les juges de la région, tandis que des témoignages étaient modifiées puis oubliés. Le ton de l’indignation.
Le film a le mérite de souligner ce que comprend la notion de justice au Japon, et ce qui n’y trouve pas sa place. Notamment une rétraction, et l’usage de preuves pour faire marche arrière. Le film suggère que lorsqu’un juge assigne un verdict, il incombe à son successeur de s’assurer que la décision soit maintenue, une décision qui bien que remise en question demeure irrévocable. Une voix finalement tue dans un village qui s’était rendormi depuis longtemps.
Stephen Sarrazin.

Mizoguchi Naomi a tourné sa caméra vers une autre voix, négligée et forcée au silence depuis des siècles, dans son film Ainu – Indigenous People of Japan. Assimilée avec une main de fer sous l’ère Meiji à la fin du XIXe siècle, la communauté Ainu à Hokkaido n’a cessé de voir son nombre réduire. De plus, son mode de vie unique avait été nié par le gouvernement jusqu’en 2008 lorsque ce dernier osait encore clamer qu’il n’y avait qu’une seule ethnie dans le pays. Et pourtant, à ce jour, l’histoire et la culture Ainu demeurent étrangères pour de nombreux Japonais.
Des années de travail au sein de ONG avec les peuples autochtones de la Colombie allaient inspirer la réalisatrice à rentrer au Japon et poser un regard sur le peuple Ainu, à propos duquel elle savait peu de choses. Après plusieurs séjours, elle fut invitée par le Musée Nibutani pour la Culture Ainu à réaliser un documentaire, qui l’orienta vers quatre personnes âgées de plus de 80 ans qui se consacrent à la préservation et la dissémination de cette culture menacée.
Ce documentaire de 80 minutes trouve sa forme en suivant les saisons, dans lesquelles se trament les paysages naturels, l’histoire orale et les archives, les rites, ainsi que le quotidien de ces porteurs de culture (la langue, les chansons, la fabrication de tissus, de canots, la semence) qui vont vers leurs voisins, les écoliers, à la rencontre des touristes. Elle cite le vocabulaire Ainu lorsqu’elle décrit les paysages de leur région et ne se lasse jamais d’ajouter à l’image des notes pour expliquer, voulant montrer son respect pour cette communauté. Le documentaire se penche avec enthousiasme sur tant de découvertes en oubliant parfois de poser les questions nécessaires ou d’approfondir la part de recherches. Néanmoins, en tant que commande de musée, le film remplit sa mission.

Dans une logique semblable, Listening to the Air de Komori Haruka, ne s’inscrit pas dans la forme documentaire traditionnelle. Son objectif tenait à comprendre ce qui s’était produit après le tremblement de terre et le tsunami de 2011 dans le Tohoku, comment les gens de la région se remirent du désastre. À l’époque, Komori était étudiante de média art ; elle se rendit immédiatement sur le site dévasté au lendemain du séisme avec son collaborateur Natsumi Seo. Les deux firent du volontariat pendant qu’ils filmaient ce qu’ils avaient découvert. Plus tard, ils décidèrent de s’installer dans la région afin de poursuivre leur travail. Une décision qui devait produire des séries de photos et vidéos. Leur engagement se poursuit toujours de façons différentes. Listening to the Air étant un des formes qu’il trouva.
Le film suit une personnalité de la radio locale, Abe Hiromi, qui avait perdu son restaurant durant le désastre. Elle se mit à travailler pour la station radio, faisant de petits reportages sur les événements locaux, interrogeant les gens autour, offrant à la fois soutien et accompagnement pour les auditeurs durant ces années qui suivirent le traumatisme. Abe fait preuve d’empathie et d’optimisme, et à travers elle, ce documentaire à la fois simple et chaleureux révèle une communauté qui ne baisse pas les bras, tournée vers l’avenir sans se défaire de ce passé. Une qualité propre à ceux qui vivent aux côtés de tels chocs de la nature.

Tandis que Listening to the Air exprimait des émotions à l’oeuvre dans un cadre physique, The Journalist de Fujii Michihito, s’appuie sur le langage, y compris celui de la mise en scène, afin de créer ambiance et atmosphère. La plupart des scènes ont lieu la nuit, s’appuyant sur des tonalités sombres et une musique mélancolique pour accompagner l’ensemble. Le récit s’inspire de la vie de Mochizuki Isoko, la journaliste la plus controversée au Japon aujourd’hui et qui au cours des dernières années enquêta sur des abus de pouvoir et autres scandales de corruption commis par des membres clés et autres alliés du gouvernement Abe. Le producteur Kawamura Mitsunobu fit le choix de mettre en chantier deux films simultanément sur le même sujet, celui-ci, et I- Documentary of the Journalist, du vétéran Mori Tatsuya, qui s’est spécialisé dans les sujets de société qui font tache et qui trouvait en Mochizuki un personnage encore plus fonceur que lui.
Le producteur Kawamura demanda à Fujii de tourner l’adaptation en reconnaissant que celui-ci appartenait à une génération qui s’intéresse peu à la presse écrite ni à la politique. Ceci pourrait expliquer pourquoi Fujii cherche à faire de son film un thriller politique plutôt qu’un film de causes. Il prend ses distances face aux scandales du viol de Ito Shiori par un politicien ou des dégâts écologiques causés par les bases militaires américaines à Okinawa, avec l’aval du gouvernement du Premier ministre, des sujets auxquels Mochizuki s’est accrochée et qui ont révélé non seulement ses positions politiques mais également ses préoccupations humanitaires.
La version de Fujii ajoute un jeune employé du gouvernement, personnage fictif et pendant masculin (joué par Matsuzaka Tori) qui n’a pas encore perdu tout sens d’une éthique. L’actrice coréenne Shim Eun-kyung tient le rôle de la journaliste. La presse révélait qu’en raison des sujets politiquement sensibles abordés dans le films, aucune agence d’impressarios au Japon n’aurait accepté qu’une de ses clientes tienne ce rôle, ce que le réalisateur nia. Cependant, le producteur précisa que toute publicité du film ne fut jamais autorisée à la radio et à la télévision au Japon, soulignant la complicité de censure chez les groupes médias privés. Cela peut aussi expliquer pourquoi deux réalisations distinctes devaient être tournées en même temps afin de souligner l’urgence des enjeux.
Ces trois films abordent la question de l’engagement social au Japon en explorant des thèmes qui continuent de hanter le pays ; Mizoguchi plaidant pour la communauté Ainu, Komori révélant la tolérance devant un traumatisme collectif, et The Journalist qui, tout en cherchant à flatter dans le sens du poil, arrive à faire l’objet d’un boycott de la part des médias grand public. Ces films nous ont montrés des femmes engagées, responsables, devant et derrière la caméra. Peut-être l’un des seuls genres de portrait féministe que la société japonaise peut accepter. Mais lorsque ces femmes deviennent fortes et agressives comme cette journaliste, elles sont éconduites. Elles deviennent monstrueuses, telle une femelle du gorille, comme on qualifie… affectueusement, la guerrière Motoko dans Ghost in the Shell.
Yangyu Zhang.
À lire aussi :
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 1 : Unforgiven (sur Dans un recoin de ce monde)
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 2 : Dimmer (sur Vers la lumière)
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 5 : Osugi Ren, last man standing
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 6 : Festival des ex, les aléas de Tokyo Filmex
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 9 : L’Enfance Dehors
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 10 : Le Fermier samurai
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 11 : NANG
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 12 : His Lost Name / 21st Century Girl
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 13 : Ikimono No Kiroku (I Live In Fear)
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 14 : Thin Red Line / My Body, My Heat
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 16 : Archéologie d’un Coffret
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang – Chapitre 17 : À Bicyclette
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang – Chapitre 18 : Film/Catastrophe
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang – Chapitre 19 : Kingdom




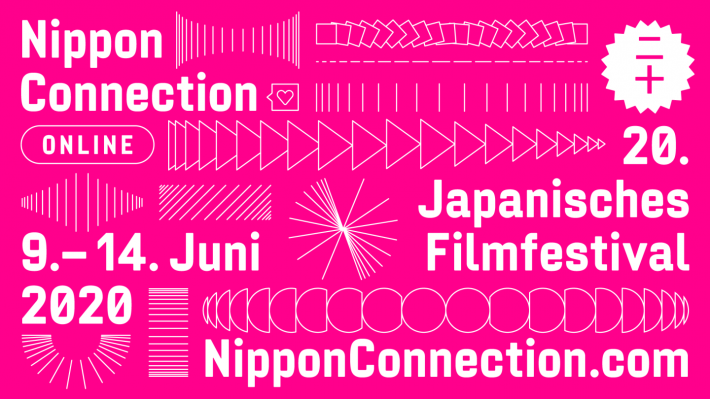
 Suivre
Suivre












