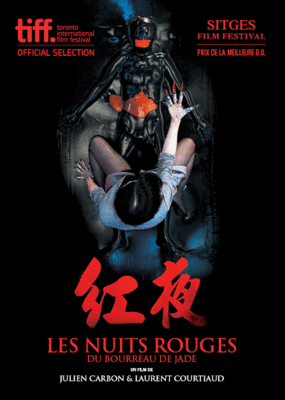Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang présentent dans DC Mini, nom emprunté à Kon Satoshi, une chronique pour aborder « ce dont le Japon rêve encore, et peut-être plus encore ce dont il ne rêve plus ». Ils évoquent ici Complicity (2018) de Chikaura Kei.
Deux films cherchent à exister dans le récit de Complicity, premier long-métrage du cinéaste Chikaura Kei, et celui qui est mis de l’avant n’est peut-être pas le plus méritant. Une co-production Chine-Japon, ce film modeste, au parfum d’une sensibilité proche de celles de Kore-eda ou de Kawase (il a remporté le prix du public lors de l’édition 2018 de Tokyo FilmEx), démarre sur les déconvenues d’un jeune Chinois, Cheng Liang (joué par Lu Yulai) venu au Japon pour y travailler clandestinement. Les premières minutes le montrent entouré d’hommes un peu plus âgés que lui, partageant la même chambre, chacun à la recherche d’une combine. Ils ont des smartphones, ils attendent, anxieux et furtifs. Muni d’une fausse carte d’identité, il atterrit, soulagé, en tant que stagiaire dans un soba-ya dans la région de Yamagata. Son objectif consiste à gagner suffisamment d’argent afin de pouvoir retourner dans sa ville à 1000 kilomètres de Pékin et de reprendre le garage de son père décédé ; c’est du moins le rêve de sa mère qui ne cesse de l’appeler.

Une fois sur place, à Yamagata, il rencontre le chef du restaurant, Hiroshi (Fuji Tatsuya) et le film se laisse prendre par une thématique de filiation par procuration, chère aux films japonais contemporains récompensés hors du Japon. Yamazaki Yukata, chef-opérateur ayant collaboré avec Kore-eda et Kawase (qui est remerciée au générique) signe la lumière de Complicity. Cheng Liang est logé, nourri, il touche un salaire modeste, mais beaucoup plus élevé que ce qu’il gagnerait dans sa région qui appartient à une Chine qui ne saurait mesurer à quoi ressemble les fastes de Pékin et Shanghai. Avant de le laisser devenir apprenti cuisinier, le chef Hiroshi s’en sert comme serveur et livreur de soba. Lors d’une livraison à bicyclette, il fait la rencontre d’une jeune femme peintre, qui apprend le chinois afin de partir étudier à Pékin. Elle lui suggère d’ouvrir un restaurant de soba à Pékin, et par ailleurs, Hiroshi, à l’aise lorsque Cheng l’appelle Otosan, est également né à Pékin et pourquoi n’accompagnerait-il pas son protégé ? Tous ces personnages se mettent à rêver de la Chine.

Les appels de la mère deviennent plus fréquents. Fière et inquiète, elle lui apprend que sa grand-mère se porte mal. Le second film commence à trouver sa place, à travers une série de flashbacks, tournés en Chine, dans lesquels on découvre Cheng, sa mère, sa grand-mère, dans un espace qui rappelle les dimensions de ce qu’on pouvait voir dans À l’Ouest des Rails de Wang Bing. La grand-mère devine déjà qu’il va les décevoir, et pourtant elle lui prête l’argent pour le voyage, lui offre une jolie veste, pleure de le voir monter dans un bus. Elle incarne le versant Chine de l’actrice fétiche de Kore-eda, Kirin Kiki, disparue en 2018. Le réalisateur construit un montage discret de ces séquences, qu’il glisse avec précaution dans son récit, soulignant combien ils sont précieux à son personnage qui se sait traqué et se voit rattrapé par la loi. Le chef Hiroshi l’aide à s’échapper en lui donnant la bicyclette… Ne sachant où aller, il s’arrête le long d’une rive, son portable sonne, cette fois ce n’est pas sa mère mais sa peintre, bien arrivée à Pékin. Il lui révèle son vrai nom. Celui auquel on aurait préféré croire.
Stephen Sarrazin.
Tandis que la Chine est devenue la seconde puissance économique mondiale et que ses citoyens sont les plus nombreux au monde à visiter le Japon, le film Complicity va dans le sens opposé à travers le récit d’une communauté moins prisée, les travailleurs clandestins qui résident au Japon. Ces travailleurs sont souvent jeunes, peu éduqués et sont les principales sources de revenus pour leurs familles. Avant d’arriver chez leur voisin, où les salaires des travailleurs sont plus élevés, où la sécurité sociale fonctionne mieux, plusieurs d’entre eux partagent ce rêve de venir s’y installer, de faire venir leur famille ou de rentrer en Chine les poches pleines, après des années de dur labeur sans dépenses inutiles. Avec un peu de chance, certains y arrivent. D’autres, comme le personnage principal du film, se trouvent au mauvais endroit, au mauvais moment, sont trompés par des agences frauduleuses, ou font un choix sans réfléchir, par désespoir. Ce sont les conséquences d’un coût de la vie qui ne cesse de s’élever dans des grandes villes comme Pékin, Shanghai et Shenzhen, alors que les salaires pour les travailleurs au bas de l’échelle est à peine le quart de ceux au Japon. Au cours de flashbacks, le film nous montre une Chine encore pauvre et perdue, loin de grandes villes, une Chine qui n’incarne pas la minorité. C’est une image du pays que les dirigeants veulent reléguer au passé, mais qui demeure présente dans un avenir rapproché pour de nombreuses régions du pays.

Cela dit, la teneur du film joue du côté de la douceur face à cette réalité sociale. Il s’ouvre sur un groupe de travailleurs clandestins et passe en vitesse du sujet de société à la bonté de l’homme, que rencontre l’un d’entre eux. Le récit trouve son aise dans ce thème incontournable de la nature humaine qui pèse plus que la nationalité, un enjeu plus simple à aborder que celui de l’immigration dans le monde, et au Japon aujourd’hui. Bien qu’il se trouve devant un problème de visa, le ‘héros’ du film est logé et nourri par une famille qui fait et sert des nouilles soba à Yamagata, ce qui ne correspond en rien aux conditions de travail de ces centaines, de ces milliers d’immigrants venus au Japon avec un visa authentique en tant que ‘stagiaires internes techniques’. Cela vaut aussi pour ceux venus du Vietnam, des Philippines… La connexion culturelle entre la Chine et le Japon rend l’exploit moins difficile : le personnage principal arrive à communiquer avec la famille japonaise à travers l’écriture et la lecture de caractères semblables ; par ailleurs les nouilles connotent une dimension symbolique et familière en Chine et au Japon. Si ce personnage a peine à s’exprimer, qu’en est-il pour ceux et celles venus de l’Asie du Sud-Est qui sont encore moins équipés pour communiquer et s’organiser par eux-mêmes.
Le film, situé loin de Tokyo, porte également une dimension nostalgique importante. La chanson thème est un vieux tube célèbre en Chine durant les années 80, de Teresa Teng, populaire au Japon à la même époque, où il sortit d’abord sous le titre de Toki no Nagare ni moi Makase (Give yourself to the flow of Time, 1986) puis en Chine en tant que Wo Zhi Zaihu Ni (I care only about you, 1987). C’était à l’époque du sommet de la prospérité japonaise d’après-guerre, le moment où la Chine s’apprêtait à s’éloigner du traumatisme de la guerre froide communiste. La Chine s’intéressait de plus en plus à la culture populaire japonaise. Pour la première fois depuis ce grand récit de la guerre et de l’occupation, les gens des classes populaires se découvraient au quotidien, comprenant qu’ils étaient de part et d’autre bons et honnêtes. C’était avant que la Chine ne devienne l’usine du monde et le concurrent économique du Japon, avant que les Chinois ne se mettent à voyager autour du monde et s’imposer en tant que ceux capables de déployer leur richesse. La part d’artisanat, la campagne, l’absence d’effets de mise en scène trop voyants s’explique par le budget modeste du film, mais nous ramène aussi à une époque qui précédait l’internet, la mondialisation, lorsque les gens semblaient plus simples, et meilleurs.
Yangyu Zhang.
À lire aussi :
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 1 : Unforgiven (sur Dans un recoin de ce monde)
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 2 : Dimmer (sur Vers la lumière)
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 3 : « Là où c’était, je n’en décollerai plus » (The Exhibition of Shinkai Makoto)
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 4 : « Le temps retrouvé » (Entretien avec Sakamoto Ryuichi et Takatani Shiro)
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 5 : Osugi Ren, last man standing
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 6 : Festival des ex, les aléas de Tokyo Filmex
DC Mini, la chronique de Stephen Sarrazin – chapitre 7 : One Vision, lorsqu’il n’y a qu’un regard « Wowowowo gimme one vision »
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 8 : Asako I&II de Hamaguchi Ryusuke – Alors qu’une seule aurait suffit
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 9 : L’Enfance Dehors
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 10 : Le Fermier samurai
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 11 : NANG
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 12 : His Lost Name / 21st Century Girl
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 13 : Ikimono No Kiroku (I Live In Fear)
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 14 : Thin Red Line / My Body, My Heat
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 15 : TIFF 2019 Une décennie qui s’étire à/vers sa fin
DC MINI, la chronique de Stephen Sarrazin – Chapitre 16 : Archéologie d’un Coffret








 Suivre
Suivre