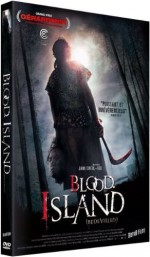La journée de dimanche fut assez involontairement consacrée à trois films en langue espagnole, hormis le coréen Hard Day de Kim Seong-Bun (qui donne lieu à une interview à part). Plusieurs nationalités tout de même, plusieurs sections aussi, mais trois pépites discrètes qui ne feront peut-être pas de vagues aux palmarès, mais qui sont de très belle tenue.
Commençons par le plus fragile, le plus gracieux aussi, Gente de Bien, premier long-métrage de Franco Lolli, vu à La Semaine de la critique. Le cinéaste franco-colombien, auteur des courts Rodri et Como todo el Mundo choisit le sujet casse gueule au possible des inégalités de classes, qui plus est en plaçant au centre du film un gamin de 10 ans. Sans pathos ni larmes, hormis celles partagées par l’enfant et son père, le film enregistre les petites violences quotidiennes, de l’humiliation d’un père obligé de laisser son fils auprès d’une famille bourgeoise « généreuse » jusqu’à la cruauté des enfants entre eux. Au plus près du regard de l’enfant (Brayan Santamarià, excellent petit acteur), Gente de Bien se distingue du tout venant du cinéma social, notamment par une scène : la première balade à cheval d’un enfant, au charme musical évocateur des dangers de « la belle vie ».
 Gente de Bien, de Franco Lolli
Gente de Bien, de Franco Lolli
Jaime Rosales, s’il a tendance à vider les salles, a ses disciples depuis Les Heures du jour, présenté et primé à la Quinzaine en 2003. Fixant de son grain d’image voilé les aléas d’une jeune couple barcelonais démuni dans Hermosa Juventud, le cinéaste semble prendre un tournant inquisiteur de la crise économique, avec des personnages moins nébuleux, plus ancrés que dans son dernier film, Rêve et Silence. C’est dans cette concession au concret que le cinéaste met son art du hors cadre et ses plans resserrés au service d’un scénario peut être classique, mais percutant. Ainsi, ces jeunes espagnols, pas si défavorisés, pas si inéduqués, pas si orphelins et pas si feignants que ça n’ont pas d’espoir de trouver un jour du travail. La seule possession de cette « belle jeunesse » est encore son corps, ultime bastion qu’il sera toujours temps de vendre.
Quant à Jauja, de Lisandro Alonso, il a eu droit à un applaudimètre exalté à la compétition Un Certain Regard, peut-être grâce à la présence de son acteur principal, Viggo Mortensen, acteur polyglotte qui s’est exprimé en pas moins de trois langues différentes durant les cinq minutes de la présentation. Importante pour une coproduction énorme – pas moins de cinq pays impliqués, dont le Danemark, l’Argentine, la France, le Mexique et les États-Unis – la présence de l’acteur l’est aussi par l’ampleur de sa performance dans un film étrange, dont on ne sait pas bien dire encore d’où vient le magnétisme. Un colon danois arrivé en terre sauvage au 19ème siècle (peut-être ?) perd sa fille, qui s’échappe avec un amoureux dans une pampa dangereuse, d’autant plus qu’elle semble hantée par un ancien conquistador devenu une sorte de Colonel Kurtz assoiffé de sang. Le film est un songe constant, où un père dépossédé de son bien le plus précieux part à la conquête d’un territoire. Composé de vignettes visuelles époustouflantes, le film en 4/3 semble réinventer ses propres mythes cinématographiques, déclinaison de western et de films de studio des premiers temps. Une grotte de la connaissance, un saut temporel plus tard et la balade d’une jeune fille d’aujourd’hui aident à sortir du film, à retrouver la lumière au son de ces quelques mots en off : « Qu’est ce qui fait que la vie poursuit et se continue ? ». On pense à Manoel de Oliveira. Jauja s’imprime dans nos mémoires, et l’on espère une sortie française imminente pour le revoir.
En vrac
Vus également ces derniers jours, Foxcatcher de Bennett Miller, thriller sur deux frères champions de lutte en proie à un mécène tyrannique. Inspiré d’un fait divers, le troisième film du réalisateur du Stratège aura plus sa place dans la course à l’Oscar, tant les pastiches et l’aspect performer des interprètes sont visibles. Le manque de rythme, la lourdeur des enjeux n’empêchent pas, quand même, d’être fasciné par le huis clos malsain qui se joue, même s’il est dommage que la monstruosité, physique et morale, du personnage de Steve Carell soit si ouvertement désignée comme résultant d’une homosexualité problématique. Ainsi la vampirisation et la domination d’un homme sur un autre, semble dire le réalisateur, ne serait le résultat que d’une « pulsion » mal assouvie.
 Marion Cotillard, dans Une nuit, deux jours des Frères Dardenne
Marion Cotillard, dans Une nuit, deux jours des Frères Dardenne
Le nouveau film des « frères », comme on les appelle en Belgique est une course contre le licenciement entreprit par Marion « prolo » Cotillard le temps d’un week-end. Les coutures scénaristiques sont si visibles, les dialogues sonnent parfois si faux dans Une nuit, deux jours qu’on peine à y croire. Le film prône évidemment l’entraide et l’humanité face à la machine capitaliste qui broie les hommes, mais il ne fait quasiment que cela, rejouant la partition de Rosetta en moins fluide. Le principe de la même discussion qui se rejoue à degré différent est intéressant, mais jamais la mise en scène n’échappe quelque chose de cette mécanique sociale.
Pauline Labadie.
Cannes 2014 sur East Asia
– Davy Chou, réalisateur de Cambodia 2099 (Qunizaine des réalisateurs)






 Suivre
Suivre