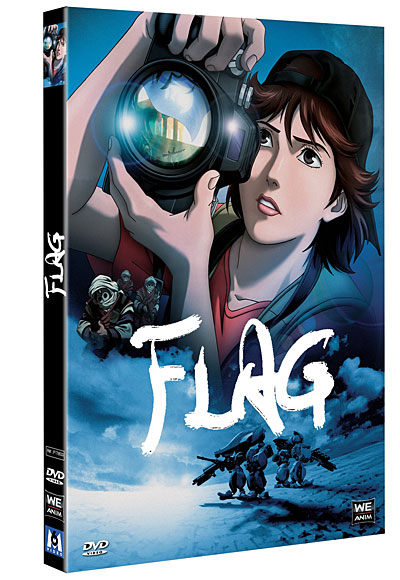Les cinémas arabes du Proche-Orient étaient à l’honneur de la 32è édition du Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul (FICA), avec la projection d’une dizaine de films de Palestine, de Syrie, du Liban et d’Irak, ainsi que l’organisation d’une table ronde avec les réalisateurs Rashid Masharawi et Carlos Chahine.
Parmi les films arabes projetés au FICA, on trouvait notamment des films palestiniens récents : Once Upon a Time in Gaza des frères Nasser, Vers un pays inconnu de Mahdi Fleifel, Songe de Rashid Mashawari ou From Ground Zero, un film collectif de 22 cinéastes tournés à Gaza de novembre 2023 à mai 2024, supervisé par Rashid Mashawari et produit par Laura Nikolo. Un document au plus proche du quotidien des Gazaouis, dans un territoire en ruines où le silence n’existe plus, déchiré par les cris, les pleurs, les bombardements et le bourdonnement incessant des drones. Côté Liban, on trouvait notamment Leila et les loups de Heiny Srour, un classique de 1984, et La Nuit du verre d’eau, premier long métrage de Carlos Chahine, inspiré de son enfance dans un pays qu’il a quitté à l’adolescence.
Dans des pays aux situations certes différentes, plus ou moins dramatiques et invivables, peut-on tisser des liens entre ces cinématographies arabes du Proche-Orient ? C’est l’une des questions posée par cette table ronde animée par Nada Azhari-Gillon, critique de cinéma franco-syrienne, avec les réalisateurs Carlos Chahine et Rashid Mashawari et la productrice Laura Nikolo.
____
Rashid Masharawi : Je n’ai pas l’impression d’avoir quitté mon pays, je voyage et c’est par le cinéma que je cherche mon pays et ce qui me lie à la Palestine. Ces deux dernières années, on a produit 32 films documentaires, réunis dans From Ground Zero et From Ground Zero+. Si j’avais été en Palestine, je n’aurais pas pu faire tout ça. Grâce au Festival de Vesoul, je me rends compte qu’on a une place sur une carte : le continent asiatique.
Laura Nikolo : Deux choses me viennent en tête en ce qui concerne mon travail avec Rashid en Palestine, à Gaza ou en Cisjordanie. Premièrement, ce n’est pas évident de produire des films dans cette région. À Gaza, beaucoup de choses se font à distance puisqu’on ne peut pas entrer sur le territoire. On ne peut pas produire de façon vraiment classique. On doit s’adapter énormément à la réalité sur place : prévoir toujours, un, deux, voire trois plans différents parce qu’on ne sait jamais ce qui va fonctionner. Deuxièmement, beaucoup de jeunes cinéastes se forment à l’étranger avant de revenir au pays. Cela donne des équipes avec des influences multiples. C’est toujours très intéressant comme expérience.

Carlos Chahine : Les films du Proche-Orient sont différents d’un pays à l’autre. Mais s’il y a un point commun, c’est la quête de ce que nous sommes par rapport au cinéma occidental. Moi, je peux parler du Liban. L’argent vient souvent des pays occidentaux, particulièrement de la France. Il y a quelques fonds au Proche-Orient, mais qui ne permettent pas vraiment de faire un film ou alors à très petit budget. Pour le Liban, je dirais qu’il y a une quête d’un paradis perdu.
Rashid Masharawi : Il n’y a pas de production cinématographique en Palestine. Notre cinéma se fait forcément en coproduction avec le reste du monde. Nous, on ne peut pas financer nos films. En plus, notre cinéma n’est pas très commercial donc il n’est pas non plus simple à distribuer, même si des films sont projetés dans des festivals comme Berlin, Cannes ou Venise. C’est un cinéma plus expérimental et artistique.
Nada Azhari-Gillon : Quels liens un réalisateur entretient-il avec un pays qu’il quitte ? Carlos, tu as vécu longtemps en France avant de retourner au Liban pour tourner ton premier film.
Carlos Chahine : Pour un cinéaste, quel qu’il soit, dans son pays ou en dehors de son pays, c’est son regard sur le monde qui joue. Mon paysage intérieur, c’est peut-être ça, l’exil. C’est celui de l’enfance, c’est la terre natale, c’est mon monde imaginaire. Quand je retourne au Liban, je retourne vers des lieux qui me sont familiers pour les faire revivre à ma manière, selon mon désir.
Nada Azhari-Gillon : Rashid, vous aussi vous vivez en France depuis quelques années. Vous ne pouvez pas filmer dans votre pays. Comment gérez-vous cette situation ?
Rashid Masharawi : Ma famille vient de Gaza mais je ne peux pas y tourner. Mon film Songe a été tourné en 2023 en Cisjordanie, sans aucun problème. Cela aurait été impossible à Gaza. Mais je n’ai pas l’impression d’être influencé par la culture française. J’ai bien sûr tourné des films, il y a plus de 20 ans, avec des aides financières d’Arte ou du CNC. Si influence française il y a, ce serait plus d’un point de vue artistique que culturel, dans le travail de post-production, dans le choix d’une musique ou de la photographie. Pendant le Covid, j’ai tourné un film à Paris, Journal de la Rue Gabrielle, mais il parle de la Palestine.

Nada Azhari-Gillon : Si on regarde les films projetés à Vesoul, quelle image a-t-on du Proche-Orient ? La guerre, les problèmes, un certain reflet de la situation actuelle. En regardant La Nuit du verre d’eau de Carlos Chahine [dont l’intrigue se déroule en 1958 au Liban], je me pose une question : le spectateur étranger comprend-il vraiment ce qui se passe ? Parce que la situation est complexe. Quel rôle ont les films pour faire comprendre la situation d’un pays ?
Carlos Chahine : Il y a un cinéaste pour qui j’ai un très grand amour, c’est Abbas Kiarostami, qui disait que plus l’action est resserrée sur un lieu, plus c’est universel. Plus une histoire est intime, et plus je me sens concerné. Bien sûr, le rôle du cinéma est de voir l’intimité d’une histoire à Gaza, en Cisjordanie ou au Liban. Tout le monde peut se retrouver dans cette histoire. C’est ça le cinéma. C’est la seule chose que nous pouvons partager avec des « étrangers » : notre humanité. Nous ne manquons pas d’informations sur les conflits actuels, mais nous manquons d’un regard d’humanité envers ceux qui sont invisibilisés, en l’occurrence, les Palestiniens aujourd’hui.
Laura Nikolo : Je rejoins complètement Carlos. Offrir de l’intime au spectateur, c’est autre chose que de l’actualité chaude. On est sur un autre statut d’image. Avec From Ground Zero, on a voulu casser ce côté « image choc » et entrer dans la vie quotidienne des gens, les voir comme des êtres humains, pour dire : ce sont des gens comme vous, c’est juste qu’ils sont dans cette situation, mais ils ont une famille, ils ont des peurs, ils ont besoin de se nourrir, d’être en sécurité. Il y a aussi une question de diffusion. Ce n’est pas évident de montrer des films qui se passent en Palestine. Dès qu’il y a une projection, on essaie d’y aller, on monte des dossiers pédagogiques pour en parler dans les écoles, dans les lycées.
Rashid Masharawi : Bien sûr, en tant que Palestinien, j’apprécie la solidarité, je veux qu’on soit tous unis et qu’on me soutienne. Mais en tant que réalisateur, je ne veux pas qu’on voit mes films uniquement par solidarité. Je veux être jugé pour la qualité de mes films. Pendant longtemps, je refusais le discours de soutien à mes films pour, de facto, soutenir la cause palestinienne. Je vous donne un exemple. Il y a quelques années, je suis invité dans un festival arabe et on me fait monter sur scène en insistant sur le fait que je suis Palestinien. Le public m’applaudit et scande des slogans pro-palestiniens. Je les arrête et je leur dis : “Vous n’avez pas encore vu le film, aussi bien vous n’allez pas l’aimer, attendez un peu avant de m’applaudir.” Mais bon, forcément, à peine je finis de parler que le public recommence à applaudir.
Nada Azhari-Gillon : Quelles sont les réactions à From Ground Zero ? A-t-il été projeté en Palestine ?
Rashid Masharawi : Le film a été diffusé dans de nombreux festivals internationaux, mais aussi en Palestine : à Gaza et en Cisjordanie. Ça nous semblait impossible de le montrer dans le reste du monde et pas en Palestine. La seule ville où nous n’avons pas pu le projeter est Jérusalem : la police et l’armée israéliennes ont empêché sa projection en disant que c’était un acte terroriste. En tant que cinéaste, si l’on parle de la Palestine, de la Syrie, de l’Irak, de n’importe où, du quotidien, de l’image, la politique finira par changer pour aller mieux. Parce qu’on a aussi besoin que l’image change. En ce moment, je ne choisis pas vraiment mes films. Ce sont plutôt les films qui me choisissent. Les sujets viennent à moi et me disent : “Je suis à toi, vas-y, fais-moi.” Je me retrouve en train d’agir avant même de penser. Mais en tant que cinéaste, je voudrais aussi me confronter à d’autres cultures, pourquoi pas tourner au Japon ou en Inde. Je me considère d’abord comme cinéaste, ensuite comme Arabe, enfin comme Palestinien.

Question du public : Le paysage du cinéma arabe est-il influencé par l’existence de fonds comme le Festival du film d’El Gouna, le Red Sea Film Fund ou le Doha Film Fund ? Ces nouveaux financements permettent-ils plus de liberté créative ?
Rashid Masharawi : Ça aide beaucoup car c’est devenu très difficile de continuer à produire avec l’Europe, où il y a de moins en moins d’aides. C’est très important tous ces fonds et ces festivals arabes qui nous soutiennent, d’autant qu’ils sont un peu moins regardants. Par exemple, si Arte ou une chaîne de télé européenne financent un film arabe, ils vont analyser si le film correspond à leur public. Si c’est un film palestinien, ils se demanderont : est-ce que ça parle du régime actuel ? Est-ce que c’est contre Israël ? Ça va entraîner plein de questions alors qu’au final, on raconte des histoires simples, la vie quotidienne.
Question du public : Rashid Masharawi, vous qui tournez des films depuis la fin des années 80, y a-t-il eu une période où c’était plus simple ou “normal” de tourner des films en Palestine ?
Rashid Masharawi : Dans les années 1990-2000, nous étions cinq ou six cinéastes à travailler à l’international : moi-même, Michel Khleifi, Mai Masri, Elia Suleiman et Hany Abu-Assad. On pourrait penser que cette période était plus calme mais en fait non, c’était même plus dangereux qu’aujourd’hui. Pourquoi ? Parce que pendant toute cette période, nous étions contre l’occupation de notre nation et contre le vol de nos terres. Il n’y a pas eu de cessez-le-feu depuis 1948. Les colonies prennent les terres, construisent des murs, mettent en place des checkpoints. Tous les jours. Nous protégions une identité, une nation, pas seulement pour arrêter les tueries à Gaza. Nous essayions de garder notre mémoire, notre histoire, notre géographie. Nous essayions de construire notre cinéma palestinien.
Question du public : On parle de la réouverture prochaine de la frontière entre l’Egypte et Gaza. Retournerez-vous à Gaza ?
Rashid Masharawi : J’attends ce moment. Plus de 100 cinéastes sont à Gaza. Ils m’attendent pour continuer ce qu’on a commencé à faire à distance avec From Ground Zero. En ce moment, j’organise un festival de films pour enfants à Gaza. Chaque jour, des centaines d’enfants regardent des films. Aujourd’hui même, nous avons deux projections en streaming dans des camps de réfugiés, des écoles, des hôpitaux. Je suis en train de créer la première école de cinéma palestinienne à Gaza. Elle sera installée dans la maison de ma propre famille. Ils ont bombardé ma maison à Gaza, là où je suis né et où j’ai grandi. Je suis en train de la transformer en école de cinéma. Je veux aussi faire mon propre documentaire parce que c’est ce que je suis : un réalisateur de films.
Marc L’Helgoualc’h
Table ronde animée le 29 janvier 2026 au Festival international des cinémas d’Asie de Vesoul.





 Suivre
Suivre