Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang présentent dans DC Mini, nom emprunté à Kon Satoshi, une chronique pour aborder « ce dont le Japon rêve encore, et peut-être plus encore ce dont il ne rêve plus ». Ils évoquent la sélection de cette année du festival Nippon Connection, qui s’est tenu en ligne au début du mois de juin.
Now it’s dark
A propos des films de Toyoda Toshiaki (Wolf’s Calling), Fukada Koji (L’Infirmière), Zeze Takahisa (The Promised Land), Suwa Nobuhiro (Voice in the Wind), Sono Sion (Red Post on Escher Street) et Sabu (Kudakechiru tokoro o misete ageru).
PAR SREPHEN SARRAZIN.
Dans le court métrage remarquable de Toyoda Toshiaki, Wolf’s Calling, plusieurs guerriers se rassemblent dans un temple situé dans une forêt luxuriante. Chacun doit gravir ses collines, puis les marches menant à sa porte. Parmi eux figurent Shibukawa Kiyoshiro (collaborateur régulier de Toyoda), Kora Kengo et Asano Tadanobu, dont la possession du plan rappelle ce qu’il faisait avec Oshima Nagisa dans Tabou et dans Zatoichi de Kitano Takeshi. L’alter ego de Toyoda à l’écran, Matsuda Ryuhei, clôt le film par un plan large où il domine Tokyo depuis un toit. Ce rassemblement pourrait avoir servi à sauver la ville des Jeux Olympiques, mais on aurait préféré qu’il serve à sauver le cinéma japonais.

Les cinq autres réalisateurs cités ci-dessus continuent de figurer parmi les réalisateurs les plus reconnus du Japon, dont des favoris de la France, Fukada Koji et le président de l’Université Tokyo Zokei, Suwa Nobuhiro. Hamaguchi Ryusuke a été pris dans le tourbillon de Venise, Berlin et Cannes et, comme on pouvait s’y attendre, aucun de ses deux titres du festival ne figurait dans les listes de films de la Nippon Connection de cette année. Les lauréats de cette édition comprenaient des œuvres très chargées politiquement qui abordaient les défaillances de la gestion kafkaïenne des réfugiés par le gouvernement japonais, dans Ushiku de Thomas Ash, et les mauvais traitements infligés aux travailleurs étrangers, dans Along the Sea de Fujimoto Akio. Parallèlement, plusieurs des fictions sélectionnées ont servi à mettre en évidence tous les autres maux et malheurs qui tourmentent le Japon.

Dans L’Infirmière, Tsutsui Mariko, la merveilleuse actrice de Fukada Koji, s’attire des ennuis lorsque son neveu enlève une lycéenne dont elle est la tutrice ; elle s’occupe également de la grand-mère de la jeune fille, une peintre réputée qui commence à devenir sénile. La jeune fille est retrouvée saine et sauve et est ramenée chez elle. Et il y a une sœur aînée – jouée par Ichikawa Mikako, qui a été le visage de nombreux personnages de soutien déséquilibrés ou fragiles depuis les années 90 – qui se languit de la tutrice. Presque chaque séquence du film permet à Mme Tsutsui de s’appuyer sur une compétence particulière qui lui a été utile dans l’œuvre de Fukada : la capacité de sourire alors que les yeux souffrent, le visage essayant de raconter deux histoires différentes simultanément.

Dans The Promised Land de Zeze Takahisa , une jeune fille a également disparu, mais cette fois, elle ne revient pas. Son absence hante une petite ville et envenime les relations entre plusieurs de ses membres importants. Tout est là, les yakuzas et les villageois harcelant une mère et son fils coréens, ce dernier étant finalement blâmé par ceux qui n’ont jamais pu tourner la page. Ce nuage sombre poursuit également ceux qui tentent de partir, et Zeze est adepte du glissement et du saupoudrage d’allusions qui font aussi ce qui définit le Japon. Sa construction narrative est exemplaire, tout comme sa mise en scène, mais elle n’est pas exempte de déceptions, notamment les performances des acteurs Sato Koichi et Ayano Go.

Voice in the Wind est un film qui est venu à Suwa Nobuhiro, qui n’était pas le réalisateur initialement attaché au projet. Une lycéenne, dont les parents et le jeune frère ont disparu lorsque le tsunami a frappé la région de Tohoku en 2011, vit désormais chez une tante à Hiroshima. Quelques minutes après le début du film, la tante est victime d’un accident vasculaire cérébral et la jeune fille décide de partir vers le nord ; elle n’y est pas retournée depuis. Il y a une cabine téléphonique qui a résisté au tremblement de terre ; des milliers de personnes ont fait le voyage en croyant pouvoir laisser un message à ceux qu’ils ont perdus. Suwa en profite pour transformer ce road movie en une série de vignettes qui rappellent Sans toit ni loi d’Agnès Varda. La plupart des gens qu’elle rencontre en chemin sont serviables ; lors du seul épisode menaçant – trois jeunes hommes prévoyant d’abuser d’elle dans un parking – Nishijima Hidetoshi arrive pour la sauver, et décide de l’emmener à Tohoku, dont il est également originaire. Nishijima sera le passager de Drive My Car, le film de Hamaguchi présenté à Cannes.

Kudakechiru tokoro o misete ageru de Sabu s’intéresse à un lycéen qui veut croire que son destin est de faire le bien, qu’il a des pouvoirs spéciaux qui attendent d’être utilisés. Une collégienne de la même école est victime d’ijime… et son père la bat et en abuse à la maison. Une longue leçon de transfert et de déni – son histoire d’être poursuivie et enlevée à plusieurs reprises par des extraterrestres dans un OVNI planant au-dessus de la ville – le film de Sabu non seulement repousse les limites de ce que les enseignants et la communauté ne feront pas pour aider une victime, mais laisse entendre qu’un tel récit fournit une étude de cas pour les pouvoirs de l’adolescent. Plutôt que de voir les parents et les enseignants appeler les services pour la protection de l’enfance et la police. Le cinéma japonais contemporain représente tant de formes de harcèlement scolaire depuis près de quatre décennies ; le film de Sabu apporte peu au genre.

Enfin, quelques observations sur Red Post on Escher Street, un film au montage exaltant que Sono Sion a décidé de réaliser alors qu’il animait un atelier avec des étudiants en théâtre et qui a été tourné en huit jours. L’histoire d’un jeune auteur branché, courtisé par tous les festivals, qui fait des castings et des auditions pour son prochain projet. Il est d’une ironie charmante pour Sono Sion d’y inclure un patron du crime faire pression sur le producteur pour qu’il engage sa maîtresse, une idole, afin qu’ils puissent aller en France ou en Italie ; il pourrait même y avoir des fêtes sur des yachts… Sono prend aussi cruellement le temps de considérer la condition ontologique des figurants dans un film, qu’il alterne avec des étudiants jouant des crâneurs et d’autres faisant semblant de passer des auditions. Le film devient rapidement abrutissant, et pourtant c’est tout à son honneur de croire en la jeunesse japonaise et de s’y intéresser comme il le fait, de Suicide Club, Love Exposure à Tokyo Tribe et Tokyo Vampire Hotel. Mais le nihilisme dont il fait preuve dans Escher Street est presque aussi impitoyable que celui de Imamura Shohei.
Stephen Sarrazin.
In search of light
A propos des films de Toyoda Toshiaki (Shiver) et Iwaisawa Kenji (On-Gaku : Notre Rock !)
PAR YANGYU ZHANG
Alors que de nombreux longs métrages affichent une certaine noirceur dans cette édition de Nippon Connection, ces deux titres à thème musical ont apporté un certain réconfort. Tous deux prennent indéniablement leurs distances par rapport à toute question sociale et se concentrent plutôt sur la forme. Dans le cas de Shiver, elle est centrée sur la performance du taiko et la coordination de la performance, de l’effet visuel et de l’environnement ; quant à l’autre, le style du dessin d’animation d’On-Gaku : Notre Rock ! dégage une merveilleuse excentricité.

Le film Shiver de Toyoda a été commandé pour illustrer la collaboration entre la troupe de tambours taiko Kodo et le compositeur Hino Koshiro à l’occasion du quarantième anniversaire de la troupe. Grâce à un nombre considérable de plans fixes et à un travail rigoureux à la caméra, il révèle un style grandiose et solennel semblable à Wolf’s Calling, montrant l’extraordinaire performance de Kodo à travers des tableaux de composition minimaliste. Tourné entre les montagnes et les rivages de l’île de Sado, dans la partie orientale de la mer du Japon, le rythme des divers instruments de percussion est en parfaite harmonie avec la musique et la partition de la nature. La performance incarne intensément les qualités de la culture traditionnelle japonaise, concentrée et puissante, passant de la tradition à la contemporanéité sans un accroc, comme le Butoh arrive à le faire. Réalisé pendant la pandémie de COVID-19 et mis en ligne, il apporte soulagement et vigueur aux personnes souffrant d’isolement, leur permettant d’oublier un instant ce fléau, ainsi que tout ce qui peut les affecter.

L’autre titre impressionnant utilisant le pouvoir de la musique est On-Gaku : Notre Rock !, le premier film d’animation d’Iwaisawa Kenji. Le film est court et attachant, adapté du manga du même nom d’Ohashi Hiroyuki. L’histoire est celle d’un lycéen délinquant sans formation musicale qui monte un groupe de rock composé de deux bassistes et d’un batteur, une idée qui lui vient en un éclair. Les thèmes familiers comme la ferveur de la jeunesse, la lutte et le jeune amour ne manquent pas, mais sont rapidement survolés. La grande partie de l’histoire est consacrée aux sensations bouleversantes que procure la musique, que l’on peut ressentir même sans formation ni pratique professionnelle, ainsi qu’à des scènes lentes et décalées de la vie quotidienne sans lien entre elles. L’animation dessinée à la main affiche un style plutôt négligé, qui contraste avec la sophistication pour laquelle l’industrie de l’animation professionnelle est reconnue. Cependant, ce gribouillis excentrique devient la force du film, avec une excellente musique et un montage subtil, présentant une œuvre hétérogène avec une personnalité singulière – combinant des motifs familiers et une interprétation rebelle de ceux-ci. C’est un film simple mais sincère, qui dit fermement non aux répétitions et aux clichés.
Yangyu Zhang.




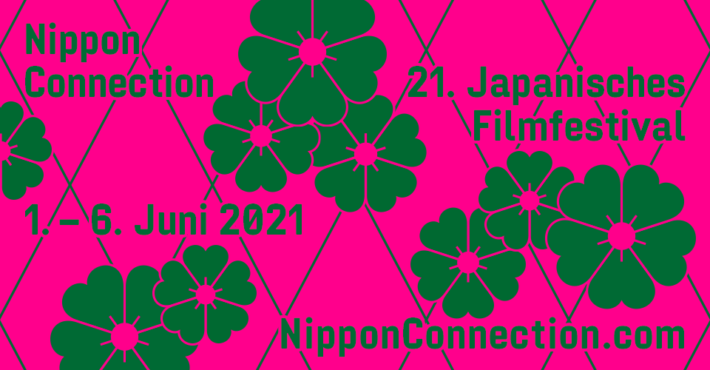
 Suivre
Suivre












