Tsai Ming-liang est un auteur du médium cinématographique qui intéresse les critiques et les commentateurs depuis le début de sa carrière. Cet engouement est presque étonnant, tellement ses partis-pris radicaux, que ce soit l’extrême lenteur du rythme de ses films ou la présence de séquences transgressives entourées d’autres parfois ridicules, vont à rebours de toutes nos habitudes. Son œuvre, très volontiers unanimement qualifiée d’insaisissable, n’a pas connu d’analyse livresque française dédiée depuis les années 1990. Matthieu Kolatte réalise une étude surpuissante de son œuvre aux éditions Mimesis, à travers un ouvrage intitulé Le cinéma de Tsai Ming-liang – le rêve, le réel et l’humain.
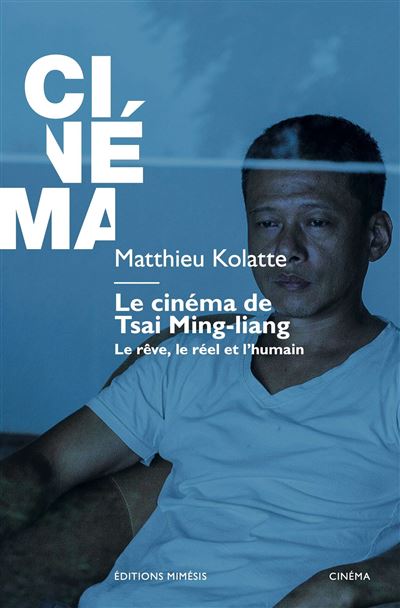
Qui n’a pas été perdu ou perturbé face à Lee Kang-sheng qui embrasse langoureusement pendant de longues minutes une pastèque dans Vive l’amour ? Ou ébranlé par la scène d’inceste très explicite de La Rivière ? Mais aussi enivré par l’atmosphère crépusculaire de Goodbye, Dragon Inn, ou amusé par les chansons comiquo-pornographiques de La Saveur de la pastèque ? Tsai Ming-liang est un auteur du cinéma taïwanais qui a saisi à l’orée des années 1990 quelques éléments représentatifs des films la nouvelle vague taïwanaise de Hou Hsiao-hsien et Edward Yang, à savoir, et respectivement, la faveur du plan long, la distance entre le sujet et la caméra du cinéaste, ainsi que le portrait des mégalopoles aliénées. Loin d’une imitation ou même d’une inspiration réellement directe, Tsai s’engouffre dans les possibilités que les maîtres taïwanais ont ouvert pour offrir une œuvre d’une grande richesse éminemment personnalisée. Ses 11 longs-métrages de fiction à ce jour sont appréciés peut-être d’abord pour leur sensorialité. Les thèmes derrières ses films, en revanche, paraissent elliptiques et se révèlent profondément déroutants ; le spectateur ne sait jamais réellement si l’interprétation qu’il réalise du film de Tsai qu’il est en train de voir, va se trouver corroborée ou complètement diluée dans d’autres couches d’images l’emmenant encore plus loin dans des galeries de questions.
Le cinéma de Tsai s’intéresse à des personnes marginalisées. Il décrit par ailleurs en permanence les frictions qui existent entre ces protagonistes et leur système familial ou la mégapole ultramoderne et aliénante dans laquelle ils vivent. Aussi, de nombreux chercheurs en cinéma ont penché vers l’hypothèse que Tsai s’adonne à un cinéma militant, prenant parti pour les groupes de personnes minorisées et dénonçant un monde moderne capitaliste les privant de bonheur. En interview, Tsai se défend régulièrement d’avoir l’intention d’œuvrer dans un quelconque cinéma engagé, dans le sens d’engagement politique.
Matthieu Kolatte acte cet écart entre la littérature existante et les propres déclarations de Tsai pour nous emmener dans une analyse aussi sophistiquée que parfaitement éclairante. L’auteur prend comme corpus les 11 longs-métrages de fiction pour le cinéma de Tsai, ainsi qu’un ensemble d’interviews auxquelles il se réfère constamment pour justifier l’analyse qu’il opère. Il propose une grille de lecture articulée sur 3 parties successives.
Selon lui, les films de Tsai pourraient fonctionner à partir d’un schéma freudien du rêve, dans la mesure où des éléments au sein d’un film trouvent des renvois plus tard, parfois de manière tellement discrète qu’elle n’est pas perceptible au premier visionnage. Kolatte énonce que les films de Tsai « rêvent » eux-mêmes, c’est-à-dire qu’ils obéissent à une logique onirique telle que Freud l’a décrite. Cette matière onirique permet à ses films de devenir une « matière vivante », dont les nombreux renvois créent des articulations thématiques. Cela offre à Tsai l’opportunité de développer ses personnages de manière dense pour mieux parler, deuxième partie, du réel. Quand Tsai insère des chansons de Grace Chang en interludes musicales de The Hole, qu’il fait référence aux Quatre-cent coups et invite Jean-Pierre Léaud en caméo dans Et là-bas, quelle heure est-il ?, ou qu’il fait vivre à son personnage récurrent Hsiao-kang le deuil de sa mère, avec beaucoup de regrets, dans Visage, tout cela relève du vécu de Tsai, de manière plus ou moins anecdotique. Le torticolis dont souffre Hsiao-kang dans La Rivière est la trace d’une réelle affliction qui touche Lee Kang-sheng, l’acteur qui l’interprète, depuis de nombreuses années. De ces éléments du réel, Tsai établit une sorte de carte du présent, et surtout, de ce qui caractérise l’être humain. C’est la troisième partie du livre : Kolatte estime que Tsai est un réalisateur profondément humaniste, dans la mesure où il décrit les mécanismes qui régissent ses personnages, portraiturés comme les plus simples possibles (classe moyenne ou modeste, peu de dialogues) pour pouvoir être le plus authentique et universel possible.
Ici retranscrit de manière extrêmement sommaire voire grossière, le propos de Matthieu Kolatte est constamment justifié et référencé, de telle manière que s’il n’y a pas de grille lecture communément admise pour « lire » les films de Tsai, celle-ci se révèle pertinente à chaque paragraphe et il ne restera qu’une chose à faire au sortir de la lecture : revoir tous les films de Tsai. Osons le dire : il est difficile de trouver une grille de lecture plus adéquate de la filmographie du réalisateur malaisien (et ce, bien que Matthieu Kolatte rappelle n’en n’avoir pas la prétention).
Maxime Bauer.
Le cinéma de Tsai Ming-liang – le rêve, le réel et l’humain de Matthieu Kolatte. Paru aux Editions Mimesis le 23/09/2025.





 Suivre
Suivre












