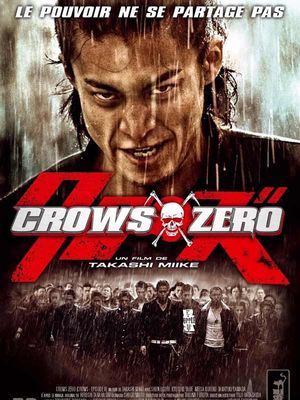Les trois films de la « trilogie de la lame » de Misumi Kenji ressortent au cinéma chez The Jokers Films : Tuer (1962), Le Sabre (1964) et La Lame diabolique (1965). Trois films d’une grande modernité qui mettent à mal le bushido, le code des principes moraux des guerriers japonais.
Deluxe stroke, son move like a ghost
Struck in an instance, unnoticed like a lamp post
RZA, Samurai Showdown (Raise your sword)
Un héros, ou anti-héros, qui marche seul sur une route vers l’inconnu, en toute discrétion, ou qui disparaît tout simplement du film avant la scène finale, mort ou gravement blessé. C’est une caractéristique du personnage principal des films de la trilogie de la lame qui ressortent au cinéma grâce à Jokers Films. La carrière prolifique de Misumi Kenji (67 films en 20 ans) est placée sous le signe du sabre, du Panier du lichen (1954) aux Derniers Samouraïs (1974). L’ethos du sabreur a bien changé en 20 ans et la trilogie de la lame s’inscrit dans une remise en question du bushido, cette voie du guerrier idyllique et traditionnelle pavée d’honneur, de courage, de loyauté et de justice.
.
Mutations du sabreur
.
Un peu de contexte (réducteur et peu subtil) s’impose. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, l’Empire japonais est défait et occupé par les Etats-Unis. Jusqu’en 1952, les films de sabre sont interdits car jugés violents, guerriers et exaltant des comportements anti-démocratiques et féodaux, notamment la loyauté indéfectible et sacrificielle envers les seigneurs. Les films sur la légende des 47 ronins, très populaires, sont ainsi interdits. Après 1952, le film de sabre fait son grand retour mais s’accorde avec les mutations sociales et sociétales du Japon. Le sabreur, et c’est bien normal, s’accorde plus aux enjeux contemporains qu’à ceux de l’époque d’Edo. Les films les plus mémorables cassent les codes du genre comme le brûlot humaniste de Kurosawa Akira, Les Sept Samouraïs. Le samouraï n’est plus le guerrier valeureux et idéal, il est montré dans sa complexité, tantôt couard et faible, tantôt valeureux mais pas invincible. Surtout, il ne se bat pas pour un seigneur mais pour de petites gens démunies.
Dans les années 60, la transformation du film de sabre se poursuit. En 1961, Kurosawa, encore lui, fait du ronin de Yojimbo un fin calculateur sarcastique, cupide et vulgaire. Un portrait que reprend en partie Misumi pour sa Légende de Zatoïchi : le masseur aveugle en 1962. Le sabreur aveugle est lui aussi calculateur et volontiers moqueur et insultant vis-à-vis du seigneur qui loue ses services. Cette mutation d’une figure mythique n’est pas l’apanage du film de sabre japonais. On voit la même chose avec le hors-la-loi du western. Ce n’est pas un hasard si Pour une poignée de dollars de Sergio Leone s’inspire (pour le dire poliment) du Yojimbo de Kurosawa et fait de son « homme sans nom » un justicier solitaire et irrévérencieux en lutte contre la veulerie humaine. On est loin de l’image d’Epinal du mythe de l’Ouest. Suivront les pitreries du western spaghetti, puis la violence nihiliste et existentielle dans des films comme La Horde sauvage de Sam Peckinpah, Le Grand silence de Sergio Corbucci ou Keoma d’Enzo Castellari. Une extrême violence qu’on trouve aussi chez Gosha Hideo et Misumi Kenji, notamment dans la série Baby Cart.

La trilogie de la lame se trouve donc dans la période des années 60, décennie cinématographique faste et fantastique pour le Japon, entre les derniers feux des grands studios, l’essor de la Nouvelle vague et la prolifération d’audaces et d’expérimentations formelles. Tout cela dans une société obsédée par l’individualisme, l’argent, la consommation de masse… et la remise en cause de tout cela. Misumi, réalisateur / artisan du studio Daei enchaîne les films dans des temps records mais peut tout de même y développer ses thématiques et son discours. Être un auteur.
.
« J’ai quitté ce monde »
.
Justement, quel est le discours de Misumi dans cette trilogie de la lame ? Ces films ont des points communs : 1/ ce sont des adaptations de romans (de Shibata Renzaburo pour Tuer et La Lame diabolique, de Mishima Yukio pour Le Sabre) ; 2/ le personnage principal est incarné par l’acteur Ichikawa Raizo ; 3/ le bushido est remis en question. Si Tuer et La Lame diabolique se déroulent à la fin de l’époque Edo, Le Sabre met en scène un étudiant épris de kendo dans les années 60 et fasciné par l’idéal du bushido.
Le héros chez Misumi est un solitaire, un incompris ou un inadapté à son époque.
Dans Tuer, Shingo est un orphelin qui devient invisible au sabre grâce à une technique imparable que lui-même juge déloyale et qui le répugne. N’aimant pas vraiment le combat, il erre sans but de seigneur en seigneur, dans un vide existentiel. Il tire sa puissance de ce vide car il s’estime déjà mort, n’ayant plus rien à perdre. Il le dit lui-même : « J’ai quitté ce monde. » Shingo répond au nihilisme baudelairien : la mort serait pour lui une délivrance dans une époque de transition, de renversement ou de dévoiement des valeurs traditionnelles : ici, la fin de l’époque Edo où les rapports humains sont réduits à la veulerie, la lâcheté, la jalousie et aux rapports économiques entre un shogun et ses samouraïs. En témoigne ce dialogue entre Shingo et un de ses maîtres : « On emploie des gens et on les paie en échange de leurs services. Quelle triste relation ! » Shingo refuse pourtant de quitter cette relation tarifaire et de faire partie de la famille du seigneur, en devenant son « fils » et en épousant sa fille. Dans Mon cœur mis à nu, Charles Baudelaire écrit : « Il n’existe que trois êtres respectables : le prêtre, le guerrier, le poète. Savoir, tuer et créer. Les autres hommes sont taillables et corvéables, faits pour l’écurie, c’est-à-dire pour exercer ce qu’on appelle des professions. » Pourtant, la fin abrupte du film change tout : Shingo rejette le nihilisme car il ne réussit pas à se tuer, comme fasciné et effrayé par la vision morbide du sang sur une peau blanche. La peur fait enfin de lui un être humain.
Dans La Lame diabolique, Hampei est un jardinier, un serf obéissant à son seigneur et souvent sujet de moquerie de la part des autres paysans. Ses capacités physiques (notamment à la course et au sabre) vont faire de lui un être respecté et craint et un assassin professionnel. Profondément naïf et innocent, Hampei se fait manipuler par des intrigants politiques et devient peu à peu l’esclave sanguinaire de ses maîtres. Nulle noblesse dans son art du sabre : il tue tel un autonome sans se poser de question et en oublie toute humanité.

Dans Le Sabre, Jiro est un adolescent fasciné depuis l’enfance par le bushido. En pratiquant le kendo, il espère atteindre une forme de pureté et de béatitude, bien éloignées de la laideur consumériste du Japon des années 60. Il mène pour cela une vie ascétique dénuée de loisirs. Kadagawa, membre du club de kendo, admire et jalouse Jiro, dans une relation de haine et d’amour homo-érotique latente. La quête d’absolu de Jiro est forcément vouée à l’échec. Son rigorisme moral et physique n’est pas adapté à la vie moderne. Et de toute manière, le bushido est un idéal inatteignable. D’autant que Jiro redoute aussi le monde des adultes et la fin de l’enfance innocente. « Le monde des adultes est plein de laideur et de souillure. » En toile de fond, un discours nihiliste, cette fois plus nietzschéen que baudelairien, avec cette idée de décadence et de médiocrité ambiante issue de la démocratie libérale et marchande. Dans une diatribe, Kadagawa dénonce la jeunesse japonaise : « Les pauvres jeunes ! Ils sont futiles et calculateurs. Ils croient s’affermir par une désobéissance timide. Tu parles ! Mais une fois casés, leur seul rêve est de tondre leur gazon le dimanche. Ils ne pensent plus qu’à la retraite et aux gosses ! Je refuse une vie pareille. » Le même Kadagawa qui veut « ne pas penser à l’avenir, vivre uniquement le présent », en bon petit suiveur de la rébellion adolescente, la tribu du soleil, vendue par la société de loisir, en sous-James Dean nippon. À cette révolte de façade, Jiro préfère donc la voie élitiste (aristocratique) et solitaire du bushido. Il y a aussi cette phrase de Jiro, prémonitoire de son funeste destin et très nietzschéenne (et mishimienne) : « Seuls les très faibles ou les très forts se suicident. »
.
Couper le soleil en deux
.
Le soleil, emblème du Japon, est un élément récurrent des trois films. Dans Tuer, il est symboliquement tranché par un sabre lorsque, par ordre de son seigneur, un samouraï doit exécuter sa femme. Un meurtre symbolique du pouvoir féodal de l’époque Edo ou de l’Empire japonais défait en 1945. Le geste est ambivalent : s’il est un acte hostile envers un pouvoir inique et une loyauté absurde, il est aussi, malgré tout, une soumission. En tranchant le soleil, le samouraï sacrifie sa femme pour le bon plaisir de son seigneur. C’est complètement hors contexte mais cette séquence fait écho au poème Zone de Guillaume Apollinaire, précisément son incipit :
À la fin tu es las de ce monde ancien
et son excipit :
Adieu adieu
Soleil cou coupé
Dans Le Sabre, le soleil est aveuglant, dès la scène d’ouverture où un Shingo enfant le fixe par défi et fascination. Le narrateur commente : « À ce moment-là, je vis l’essence du soleil. C’est la Justice absolue. Son éclat est insoutenable. Je voulais m’imprégner de cette lumière pour acquérir la force. La force et la droiture. J’étais convaincu qu’avec le kendo, je pourrais saisir de mes mains cet éclat de vie pure que j’avais découvert. » Quelle foi aveugle (littéralement) en un idéal quasi-mystique ! Une mystique chère à Mishima, et contrepoint nécessaire à son nihilisme précédemment évoqué.
Le soleil est présent dans une scène de La Lame diabolique, dessiné sur un éventail qui sert de cible de tir à l’arc à un seigneur devenu complètement fou. Symbole du shogunat finissant et suicidaire ? En cette fin de l’époque Edo, le parcours du serf Hampei sert d’exemple et son émancipation de fable. Devenu un temps assassin servile et un véritable animal sanguinaire, il recouvre son humanité en considérant le bushido comme un bréviaire et le sable comme un chapelet. Il quitte le film mystérieusement, à l’agonie ? mort ? ressuscité ? et acquiert le statut de Saint, c’est-à-dire un simple être humain dont les gestes serviront d’exemples, dont l’histoire deviendra évangile… et qui ne sera pas là pour rétablir la vérité.
La trilogie de la lame propose trois parcours de vie et trois variations sur des concepts :
Tuer le vide.
Le Sabre la pureté.
La Lame diabolique l’innocence.
Marc L’Helgoualc’h
Tuer (1962), Le Sabre (1964) et La Lame diabolique (1965) de Misumi Kenji. En salles le 24/09/2025, chez The Jokers Films.




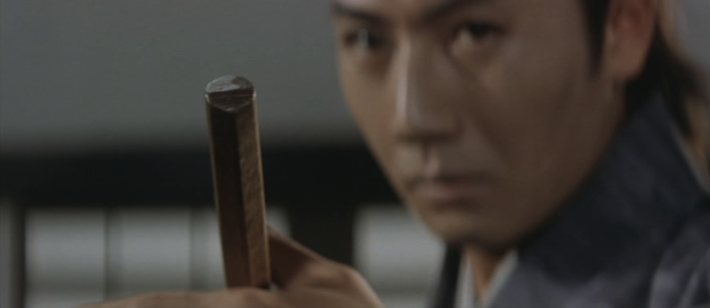
 Suivre
Suivre