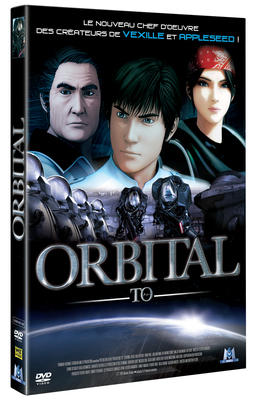Un Hiver à Yanji est le troisième film du réalisateur singapourien Anthony Chen à sortir sous nos latitudes, depuis Ilo Ilo, Caméra d’or en 2013. Nous avons pu nous entretenir avec lui.

Un Hiver à Yanji est votre troisième long-métrage en langue chinoise, après Ilo Ilo et Wet Season. Était-ce très différent de tourner en Chine et à Singapour ?
Davantage que le lieu, la manière dont j’ai appréhendé le film a été très différente de mes précédents films. Wet Season est sorti durant la pandémie du Covid et j’ai fait beaucoup d’interviews avec des journalistes du monde entier qui me parlaient de la précision de mon écriture, de la maîtrise de la direction d’acteur, de la sensation de contrôle qui se dégageait du film. On y revenait toujours et ceci m’est resté en tête. Je n’ai cessé d’y repenser et je me suis demandé ce qu’il se passerait si je n’étais pas autant dans la maîtrise de mon cinéma.
J’ai décidé de faire ce film différemment. Auparavant, je travaillais sur le scénario, deux voire trois ans jusqu’à ce que tout soit parfaitement sculpté sur la forme que j’avais imaginé. Ici, je suis partie de la première ébauche et j’ai construit l’histoire au fur et à mesure. Nous avons commencé à travailler avec les acteurs alors que le scénario n’était pas terminé, contrairement à mes autres films pour lesquels les comédiens recevaient le scénario définitif avant de commencer à tourner.
En outre, le tournage s’est déroulé en Chine, et non dans mon pays natal Singapour, qui plus est, dans une région que je ne connaissais pas. C’est également un film d’hiver, une saison dont je ne suis pas vraiment familier. J’ai utilisé de la musique, absente de mes précédents films, en travaillant très tôt avec le compositeur dès le montage. Je souhaitais défier un peu mes habitudes et mon processus de création en sortant de ma zone de confort.
D’emblée, l’état d’esprit dans la fabrication même du film était très différente. Bien sûr, la partie logistique du tournage différait beaucoup de ce que j’avais pu connaître à Singapour ou même en Europe : sur ces tournages, nous étions en équipe réduite avec une quarantaine de personnes. Pour ce tournage, en Chine, nous étions plus d’une centaine. J’ai bien tenté de réduire à 100, ou même 90 mais nous avons terminé avec une équipe de 110 ! Tous les jours, je demandais à mon producteur : « pourquoi avons-nous besoin d’autant de monde pour raconter l’histoire de trois personnes ?! »
L’expérience de tournage était effectivement très différente mais je pense que la manière d’appréhender le projet était la plus grande différence de toutes. Ce film m’a permis de me laisser davantage aller, de gagner une forme de liberté, de souplesse en acceptant d’abandonner certaines choses pour que d’autres puissent arriver.

C’est peut-être ceci qui contribue à faire d’Un Hiver à Yanji, un film si atmosphérique ?
Avec Un Hiver à Yanji, j’ai tenté de capter une émotion, quelque chose que j’ai beaucoup entendu et lu durant la pandémie. Cette sorte de mélancolie collective ressentie par toute une jeunesse qui se sent perdue dans le monde, déçue par les générations qui l’ont précédée ou par les gouvernements.
J’ai lu des choses de jeunes personnes venant de tous les pays et de tous les horizons. Les problèmes pouvaient varier mais ils exprimaient tous un sentiment très similaire, qui semblait en même temps très abstrait.
Mes précédents films étaient très imprégnés de réalisme social et, pour celui-ci, je voulais aller vers davantage de sensations, de poésie, d’esthétisme aussi pour tenter de capturer ce sentiment, cette émotion que je pense avoir saisi par bribes mais que je ne suis pas certain d’avoir pleinement compris moi-même, même maintenant.
Je ne fais pas partie de cette génération, j’avais 29 ans quand j’ai réalisé Ilo Ilo, j’en ai 40 aujourd’hui, je ne suis plus un jeune adulte. Néanmoins, je voulais quand même tenter d’observer ce sentiment, même si ma réflexion est encore en cours, par le biais de visuels et d’émotions exprimant ce que peut ressentir cette jeunesse qui se sent perdue.
Vous avez réalisé un film en Europe cette année, Drift. Aimeriez-vous réitérer l’expérience ? Quels sont vos prochains projets ?
Je travaille actuellement sur un nouveau film à Singapour. Il bouclera la trilogie commencée avec Ilo Ilo et Wet Season. Je retrouve mes deux comédiens principaux pour un tournage qui débutera l’année prochaine.
J’ai connu Koh Jia Ler enfant dans Ilo Ilo, puis adolescent sur Wet Season. Il a maintenant 21 ans, c’est un adulte. Ces films sont un peu la trilogie de sa vie, ils l’ont vu grandir. C’est un peu mon Antoine Doinel à moi. Je dois tourner ce dernier film rapidement car il sera bientôt devenu bien trop grand.
Concernant Drift, la production est très internationale, avec des financements français, britannique et grecs, mais c’est un film en langue anglaise avec un casting principalement anglophone. J’étais le seul Asiatique sur le tournage et je racontais une histoire complètement différente de mes autres films, et même de ce que je connais. Le film parle des réfugiés venus en Grèce pour fuir la guerre civile au Liberia au début des années 2000. Il est adapté d’un livre qui m’avait beaucoup touché et j’ai travaillé à l’adaptation avec mon co-scénariste pendant deux ans et demi.
Faire des films si éloignés de ma culture et de mon pays d’origine est intéressant car les émotions qui y sont liées sont toujours complexes et demeurent pourtant très personnelles. Je mets toujours un peu de moi dans mes films car la manière dont on se retrouve dans une histoire est toujours très personnelle, fondamentalement très humaine.

Un Hiver à Yanji compte des magnifiques séquences extérieures, montrant la région de Luzhen, en Chine. A-t-il été difficile d’y tourner ?
Il faisait surtout froid. J’ai vécu 15 ans à Londres dans un climat plutôt tempéré et j’ai grandi à Singapour où on est en été 365 jours par an. Je n’avais jamais connu un environnement atteignant les -20/ -30°. Cependant, ce n’était finalement pas si difficile, ce n’était pas impossible : on s’adapte, on prévoit un bonnet, on ajoute des couches de vêtements, on trouve des solutions.
En réalité, les scènes vraiment compliquées n’étaient pas celles en extérieur mais celles en intérieur, les scènes plus intimes car les émotions à invoquer et à transmettre étaient si complexes.
Comment travaille-t-on avec trois des acteurs les plus célèbres de Chine ?
C’était une formidable expérience, sans doute le tournage sur lequel j’ai pris le plus de plaisir. Ils étaient tous les trois plus jeunes que moi et ils m’ont fait pleinement confiance, en tant qu’homme et en tant que metteur en scène. Ils ont cru en cette histoire folle que je voulais raconter. Quand nous avons commencé à travailler sur le projet, ils n’avaient que la moitié du scénario et ils m’ont vraiment suivi dans cette aventure. Je pense vraiment que le film est là parce qu’on y croyait autant, parce qu’il y a eu toute cette confiance.
Ce film, c’est réellement l’histoire de quatre personnes, trois devant la caméra et une derrière. Nous avons vécu ensemble, mangé ensemble, travaillé ensemble… Nous avons créé une alchimie sur le plateau qui a contribué à l’énergie que l’on voit à l’écran car tout était tellement naturel.
Vous vouliez ces acteurs dès le départ ?
Pour Zhou Dongyu, j’avais travaillé avec elle sur un court-métrage, Breakaway, réalisé à distance durant la pandémie. Il fait partie d’une anthologie en réaction à la crise du Covid, réunissant des films de 7 réalisateurs comme Jafar Panahi, David Lowery ou Apichapong Weerasethakul. Il s’intitule The Year of Everlasting Storm et a été projeté à Cannes en 2021. J’ai donc dirigé Zhou Dongyu par Zoom pour ce film. Nous nous sommes très bien entendus et nous avons décidé de retravailler ensemble.
La fille du trio d’Un Hiver à Yanji a donc été castée en premier. Pour les deux garçons, je cherchais deux acteurs qui dégageaient des choses très différentes dans l’apparence et leur manière d’être. Il me fallait un jeune homme un peu timide, assez doux avec un look d’intellectuel sage et un autre plus suave, à l’attitude plus cool, plus immédiatement séduisant. J’ai donc choisi Liu Haoran et Qu Chuxiao qui ont une « texture » très différente.
Un Hiver à Yanji est un film sur la fin de la vingtaine. Qu’est-ce qui vous attirait dans ce sujet ?
Comme je le disais plus tôt, j’ai vraiment vécu une crise existentielle durant la pandémie. J’étais très déprimé : mon deuxième film venait de sortir en pleine crise, ce qui était assez horrible à vivre, les salles étaient fermées, tout le monde s’est tourné vers Netflix… Je n’arrivais pas à savoir si le public voudrait revenir au cinéma un jour, s’il voudrait encore voir le genre de films que je voulais faire. Aussi, quand j’ai commencé à lire tous ces articles et ces posts de jeunes gens, j’ai senti une connexion immédiate et très profonde avec ce que je vivais.
Je suis restée chez moi à ne rien pouvoir faire pendant quasiment deux ans, avec cette anxiété constante. Mon épouse, elle, travaillait à distance, parfois même davantage qu’en temps normal et je ne faisais que m’occuper de notre enfant, de la maison, de la lessive, des courses… J’ai fini par avoir l’impression de perdre une partie de mon identité.
Toute cette frustration a amené à une énorme envie, un énorme besoin de faire un film, même sans avoir exactement quelle forme il prendrait. Simplement cette énergie immense de créer.
C’est un film particulièrement réconfortant. Les personnages dégagent quelque chose de très attachant, de très bienveillant, alors qu’ils s’aident à avancer et à grandir. Était-ce important pour vous de remettre l’humain au centre de l’art ?
L’humain est toujours au centre de mon travail. Tous mes films parlent de la condition humaine. Je pense être un humaniste dans l’âme. Capturer ce qui fait notre humanité, interroger les relations humaines me passionnent. C’est pourquoi je suis si bouleversé par tout ce qui se passe dans le monde, avec deux guerres, tellement de morts, de blessés, de souffrance… Car tout mon travail tourne autour de notre humanité.
Beaucoup de réalisateurs optent pour un réalisme social assez rude, sur l’aspect très violent de l’homme. Votre film n’est pas du tout sur cette tendance, bien au contraire. Il y a une forme de bienveillance et de douceur qui n’est pas si fréquente…
Vous parlez de douceur mais ces trois personnages sont perdus et brisés chacun à leur manière. L’une a dû abandonner son rêve, un autre est plongé dans une dépression et le dernier cache des complexes profonds et cette peur de ne pas être assez bien, sous une apparence assurée. Quand on regarde de plus près, ils sont pétris de douleurs et de traumatismes. Néanmoins, je ne voulais pas réaliser un énième film qui se complaise dans la sinistrose. J’ai l’impression que tous les films dans la veine du réalisme social sont toujours extrêmement déprimants. Les jeunes connaissent tout un tas d’épreuves mais 90% d’entre eux trouvent un moyen de vivre malgré leurs souffrances, leurs angoisses et leurs problèmes. Je souhaitais montrer cette facette de la jeunesse d’aujourd’hui comme je souhaitais une autre perspective de la jeunesse chinoise, qui sorte de la représentation très déprimante et abusive de la Chine, prédominante dans le cinéma asiatique.

Le personnage de Haofeng n’a pas d’origines claires dans le film et ceci contribue à son état. Est-ce que représenter la dépression était important pour vous ?
J’ai lu tellement de choses sur la santé mentale et, dans le monde actuel, de plus en plus de jeunes sont confrontés à des problèmes de santé mentale. Souvent, on le représente de manière très stéréotypée : le personnage s’enferme chez lui, ferme les lumières, et se coupe de tout le monde. En réalité, pleins de gens continuent de vivre leur vie, avec ces problèmes.
Beaucoup de personnes avec qui j’ai discuté en Chine me disaient qu’elles l’avaient vécu, qu’elles avaient même pensé à en finir à certains moments. Sans en arriver là, c’est un discours qui me parle, une émotion que je peux comprendre. Cette sensation de, soudainement, perdre le contrôle de ses émotions sans savoir vraiment pourquoi, est quelque chose qui arrive de plus en plus dans notre société. Et beaucoup d’entre nous choisissent de ne pas en parler, ou même de le reconnaître.
Durant les projections que nous avons faites du film, le public semblait profondément s’identifier à ce personnage spécifiquement, et à la représentation de son état.
Quelle est la réception du film ?
A Cannes, l’accueil a été excellent. J’étais un peu inquiet en y allant car ce film était si différent de mes précédents films mais les gens semblent avoir vraiment bien réagi et j’en ai été très ému. L’accueil a été tout aussi bon dans les nombreux festivals où nous avons projeté le film.
Les avis ont été plus partagés en Chine. Certains ont adoré le film, d’autres pas tellement. Les acteurs sont des énormes stars, aussi le film a bénéficié d’une sortie incroyable, sur 30 0000 écrans, une diffusion gigantesque. La stratégie du distributeur, également producteur du film, a été de le présenter comme un film commercial alors que l’on est davantage sur un film d’auteur indépendant. Beaucoup de spectateurs ont été surpris car ils s’attendaient à autre chose. Le public n’est pas habitué à ce qu’un film d’art et essai ait une sortie aussi importante et ils ont été un peu déstabilisés que le film soit moins sur une réelle intrigue, et plus sur des sensations. J’ai eu de nombreuses questions de diverses personnes, sur des points de cohérence, sur la présence de certaines scènes… Elles cherchaient une logique aux séquences un peu oniriques car elles ne parvenaient pas à y rattacher quelque chose. C’était une expérience intéressante mais je pense que le public art et essai à qui le film s’adresse davantage, a tranché avec cette énorme sortie grand public
Le film se déroule près de la frontière coréenne, comme dans plusieurs films de Zhang Lu. Avez-vous vu ses films et vous ont-ils inspirés ?
Zhang Lu vient de cette région et il est Chinois d’ethnicité coréenne. J’ai vu ses deux derniers films mais je ne m’en suis pas inspiré. De manière générale, j’ai souhaité faire ce film sans avoir de références en tête. Je ne connaissais pas la région et je n’ai pas vécu en Chine depuis des années, j’y suis donc allé sans préconceptions ou préjugés, sans cette imagerie très dure d’une contrée pauvre et industrielle.
J’ai également voulu que les trois personnages ne viennent pas de la région. Ils ne viennent pas d’ici, n’y sont que pour un petit moment. C’était essentiel à mon propos et à ma démarche.
Dernière question : avez-vous un moment de cinéma qui vous a marqué ou contribué à votre construction de cinéaste ?
Il y a deux semaines, je suis allé visiter l’exposition rétrospective sur Edward Yang à Taïwan. Je suis un très grand admirateur d’Edward Yang et de son cinéma. A Brighter Summer Day est mon film préféré de tous les temps et la scène dans laquelle Chang Chen poignarde la jeune fille est gravée dans ma mémoire. Dans une des installations de l’exposition, cette scène repassait encore et encore et elle est si puissante. C’est peut-être une des scènes les plus fortes de l’histoire du cinéma et on n’en parle pas assez. Si vous voulez mon avis, c’est presque criminel que tant de gens n’ait pas vu ce film !
J’ai d’ailleurs ressenti le besoin d’envoyer un message à Chang Chen plus tard dans la semaine pour lui dire !
Propos recueillis par Maxime Bauer via Zoom le 30/10/2023.
Interview retranscrite depuis l’anglais par Claire Lalaut.
Remerciements chaleureux à Anthony Chen et Lélia Saligari de Nour Films.
Un Hiver à Yanji d’Anthony Chen. Chine-Singapour. 2023. En salles le 22/11/2023.





 Suivre
Suivre