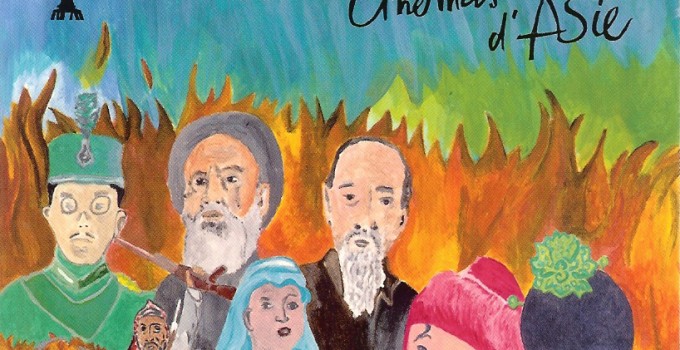The Jokers ressort en salles cette semaine deux chefs d’œuvre du réalisateur japonais Masumura Yasuzo. Arrêtons-nous sur Tatouage, brûlot sensuel et cruel où le fantastique sert des maux bien humains.
Parce qu’on l’empêche de vivre sa passion pour un apprenti, la jeune Otsuya fuit la maison parentale et se réfugie chez Gonji. Après avoir tenté d’abuser d’elle, ce dernier la vend au tenancier d’une maison de geishas. Un jour, un artiste fasciné par la beauté d’Otsuya, lui tatoue une araignée sur le dos. C’est une révélation pour la jeune femme qui décide, dès lors, de se venger de la gent masculine.

Tatouage est une des œuvres les plus emblématiques du style singulier de Masumura Yasuzo. Le réalisateur précède de peu tout en s’intégrant totalement à la Nouvelle Vague japonaise des Oshima Nagisa ou Imamura Shohei. Mais quand ces derniers adoptaient un style ouvertement frondeur afin de bousculer le système, Masumura s’avère plus insaisissable. Son parcours le fait osciller entre le classicisme des grands auteurs japonais tels que Mizoguchi ou Ichikawa dont il fut l’assistant, tout en ayant un pied dans la modernité européenne puisqu’il obtint une bourse d’études pour étudier le cinéma en Italie au début des années 50 avec, comme illustre professeur, Michelangelo Antonioni. Et en parallèle de cet apprentissage cinématographique, Masumura naviguera de ses études de droit initiales à une formation philosophique avec une thèse sur Kierkegaard.

Tatouage illustre à merveille ce parcours. Le postulat (adapté de Tanizaki Jun’ichirō) évoque ainsi autant les mélodrames au féminin de Mizoguchi que les provocations à venir du pinku eiga (la scène de tatouage d’ouverture sera reprise de manière plus sulfureuse encore, plus tard dans La Vie secrète de madame Yoshino de Konuma Masaru (1976)). Formellement on navigue également entre un élégant classicisme et une liberté de ton typique à la fois du cinéma européen mais donc aussi de la Nouvelle Vague japonaise, notamment dans la description crue et sensuelle du corps féminin, du désir charnel. Cette schizophrénie irrigue le récit du cheminement de la jeune Otsuya (Wakao Ayako), tourmentée et tourmenteuse dans son rapport aux hommes. Elle signe ainsi la perte de Shinsuke (Hasegawa Akio), jeune apprenti de son père tombé fou amoureux et qu’elle incite à s’enfuir avec elle. D’emblée, Masumura se débarrasse de tout contexte vaguement socio-historique qui aurait rendu le couple attachant dans ses choix (tout juste apprend-on que le père destinait sa fille à un meilleur parti) pour se concentrer sur leur rapport dominant/dominé.

Shinsuke est rongé par le remord et la culpabilité tandis qu’entre autoritarisme, chantage affectif et vertige des sens, Otsuya lui impose sa volonté. La dualité entre le plaisir charnel et la domination mentale/physique tisse donc pour l’ensemble des personnages des pulsions reposant sur la possession, qu’il en soit tour à tour acteur ou victime. Quand la simple beauté d’Otsuya avive le désir du fourbe entremetteur Gonji (Suga Fujio), c’est la fortune qu’elle pourrait lui rapporter qui excite le tenancier de maison de geisha Tokubei (Uchida Asao) tandis que c’est la peau de porcelaine de la jeune femme qui attire le tatoueur torturé Seikichi (Yamamoto Gaku). Masumura navigue ainsi entre mysticisme, psychanalyse et simple observation du mal inné dans le caractère d’Otsuya, jamais présentée comme une victime dans les situations – alors que le déroulement de l’intrigue le fait. La scène du tatouage est ainsi typique de cette approche, Otsuya subissant l’imposant dessin d’araignée sur son dos, passant de victime à prédatrice au fur et à mesure que la figure marque son corps de façon indélébile. L’alternance entre plan large sur l’artiste et son modèle, le dessin prenant forme, puis la fascination du dessinateur se conjuguant à la douleur/plaisir d’Otsuya marque la bascule de ce rapport dominant/dominé. D’ailleurs, la séquence se termine sur la jeune femme qui, malgré sa chair à vif, semble triompher sur Seikichi pétrifié par le monstre qu’il vient de façonner.

Le mysticisme est alors un prétexte pour céder à ses mauvais penchants pour Otsuya, la malédiction de l’araignée carnivore en elle servant moins une supposée vengeance envers les hommes qu’un plaisir naturel à les malmener de ses charmes. Les plus faibles sont poussés à une violence comme Shinsuke, les plus forts sont exploités pour leur richesse avec l’orgueilleux Serizawa (Sato Kei). Visuellement, Masumura donne dans l’abstraction où le décor studio domine pour tisser un arrière-plan onirique qui nous immerge dans la psyché des personnages, tant dans les supposés « extérieurs » (la scène sur le pont enneigé avec sa nuit ne se cachant pas de sa nature factice, le meurtre dans la forêt) que les intérieurs. Là, les poses alanguies d’Otsuya l’associe littéralement à la mante religieuse quand elle enserre ses amants soumis, son corps constituant une vraie arme d’hypnose avec cette nudité subtilement exposée/masquée, et en premier lieu le fameux tatouage. Il en résulte un spectacle immoral et fascinant, baigné d’un charme sensuel et morbide (la pâleur du corps d’Otsuya aussi cadavérique que désirable) qui culmine dans un final où ce croisement de pulsion, d’onirisme cru et de désir maladif avec ce plan sur le tatouage inondé de sang.
Justin Kwedi
Tatouage de Masumura Yasuzo. Japon. 1966. En salles le 02/11/2022





 Suivre
Suivre