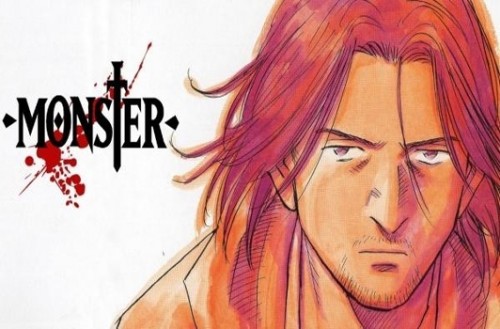Stephen Sarrazin et Yangyu Zhang présentent dans DC Mini, nom emprunté à Kon Satoshi, une chronique pour aborder « ce dont le Japon rêve encore, et peut-être plus encore ce dont il ne rêve plus ». Ils évoquent ici Ainu Mosir de Fukanaga Takeshi, qui vient de sortir au Japon.
Liberté pour les Ours
Ce second long-métrage du réalisateur-scénariste Fukanaga Takeshi affiche une envie de raconter plusieurs récits à la fois et n’hésite pas à interrompre celui en cours afin d’en commencer un autre. Il tente également de se frayer un chemin au travers des risques et autres nids de poule qui attendent ceux/celles qui comptent représenter et parler au nom de la culture Ainu, sur l’île de Hokkaido au nord du Japon.
Tous les récits se rejoignent autour d’un garçon de quatorze ans, Kanto, issu d’une famille Ainu. Sa mère possède un petit commerce d’artisanat traditionnel et ménage habilement les stéréotypes véhiculés par les touristes japonais et étrangers au sein de son village (Akan Kotan, site Unesco). Le réalisateur, qui fit le choix de travailler principalement avec des acteurs non-professionnels, à l’exception de Lily Franky (de Une Affaire de famille de Kore-eda) dans le rôle d’un journaliste régional, a retenu une mère et son fils, des habitants du village, pour jouer ces rôles. Le film s’ouvre sur la possibilité d’un regard porté sur la réalité socio-économique du lien entre le Japon et cette première nation.
Survient un premier changement de cap. Kanto nous est présenté en tant que garçon doué et sensible. Son père, un artisan de renom, est décédé et le garçon n’hésite plus à signaler combien il se sent détaché désormais du village ; il est prêt à le quitter. Le film rassemble quelques séquences qui confirment cette rupture, cette rébellion, y compris celle d’une répétition de Johnny B. Goode de Chuck Berry, avec des instruments électriques et encore une autre dans laquelle il annonce à une conseillère pédagogique, qui explique à sa mère le talent de Kanto, qu’il souhaite que sa prochaine école soit n’importe où sauf dans ce village.
Ce récit d’un départ qui s’annonce freine subitement avec l’arrivée de Debo, incarnation habile et opportuniste de cette identité autochtone et médiateur de la communauté, qui décide de remettre le garçon sur le bon chemin. Il lui révèle, lors d’une randonnée en forêt, l’entrée d’une grotte qui mène, selon les croyances, vers une vallée des esprits ; il lui montre ensuite un ourson qu’il a mis en cage et demande à Kanto de s’en occuper. Le réalisateur s’en sert comme appât afin d’introduire le rituel Iomante au cours duquel un ours est sacrifié afin de protéger les membres du village. Cette pratique fut bannie dans la région de Hokkaido en 1975. Lorsque Kanto découvre le projet de Debo, de tuer l’ourson une fois l’hiver venu, il tente de le libérer. Il échoue et abandonne. Ces séquences d’anthropologie compressée ne font qu’illustrer plutôt qu’explorer et expliquer. Le spectateur a droit aux avis divergents des membres de la communauté au sujet de ce rituel, mais non au rôle de l’ours dans la taxonomie de leurs traditions. Le garçon refuse d’assister au tir de la flèche perçant l’ours mais retrouve sa mère à la fête où l’animal, dont la tête est la pièce maîtresse, est remercié. Son esprit repère Kanto et lui offre un cadeau : le garçon retourne à la forêt, à l’entrée de cette grotte, et le fantôme de son père l’y attend, et l’enlace. Une scène qui fait écho à celle dans laquelle il se retrouve avec le musicien principal du village, qui fut un ami proche de son père. Ils regardent ensemble les forêts d’automne et les montagnes avant de se tourner vers Kanto et lui dire « autrefois, tout cela était à nous ».

Debo avait demandé au garçon, lors de leur promenade, s’il avait déjà vu un hibou ; « dans un zoo » lui répond-t-il. Son père en avait croisé un, immense, dont il avait fait une puissante sculpture en bois. Le film se termine avec Kanto qui marche vers sa nouvelle école et croise un hibou blanc perché sur la pointe d’un arbre. C’est tout simple, Kanto se dirige vers Hogwarts.
Ainu Mosir a remporté quelques prix dans des festivals de cinéma indépendant. Fukanaga Takeshi fut formé en Amérique et a démontré un nouveau savoir-faire au Japon pour le financement de son film et dans la constitution de réseaux internationaux qui firent grande impression sur le gouvernement. Ce dernier lui a offert de créer de nouveaux programmes d’ateliers d’écriture et de développement de scénarios originaux qui manquent cruellement au Japon.
Stephen Sarrazin.
L’Ours de sens
Ces dernières années ont vu apparaître divers titres cinématographiques, documentaires et fictions, autour de la culture Ainu. Ainu Mosir rassemble des aperçus du cadre social de cette communauté à travers un récit d’adolescence, écrit et réalisé par Fukanaga Takeshi. Derrière ce projet se trouve le désir ardent du réalisateur, né à Hokkaido, d’aborder cette communauté avoisinante (Fukunaga est Japonais, ou wajin selon le mot Ainu). Il est à la fois motivé et prudent, en évitant les excès de part et d’autre. Le film entre et sort de la vie de différents membres du village où l’histoire se déroule. On passe du mode de vie aux rituels, aux croyances sans fournir de questions plus précises qui permettraient de dépasser les apparences. Son geste de cinéaste ressemble à celui de l’adolescent dans le film ; il est à la fois curieux et respectueux de cette culture, mais ne sait pas trop quoi faire de cet étranger qui lui est familier, notamment lorsque cet étranger n’est ni un individu ou un objet mais une culture, une civilisation.

Les bonnes intentions et l’enthousiasme du réalisateur lui amenèrent l’aide et le soutien du village Akan Kotan. Cependant, puisque le film rassemble de nombreux citoyens japonais qui vivent dans cette région ainsi que des résidents Ainu, des négociations entre l’étranger venu de l’extérieur et cette communauté locale devinrent inévitables ; elles le furent également entre les villageois Ainu. Ce peuple vieux de plusieurs millénaires a une histoire à la fois riche et méconnue. Entre la tradition et le contemporain, entre le combat pour préserver la culture et les nouvelles opportunités que livre la promotion de la culture Ainu par l’Etat, et la montée du tourisme « ethnique », certains membres de la communauté émergent en tant que puissants médiateurs représentant leur culture tout en étant préoccupés par leurs intérêts personnels qui ne se plient pas toujours à ce que nous, de l’extérieur, imaginons être pour le bien de cette culture autochtone. Un tel dilemme est abordé avec franchise et ne cherche pas à accentuer une dimension dramatique. Il peut aider le public qui espère découvrir quelque chose d’enfoui, de secret, à mieux mesurer les conditions de vie parfois difficiles de la communauté Ainu et comment elle se retrouve marginalisée dès qu’elle devient l’objet d’un récit, comment elle existe encore à part. D’autre part, le film montre bien l’aspect ordinaire de la vie de tous les jours en soulevant la questions « mais qu’attendiez-vous? ». Il n’y a rien que vous ne connaissiez pas.
Le sacré demeure latent. Entre une tradition lourde de sens qui appelle à un sacrifice et la globalisation qui s’infiltre dans cette culture, on ressent une bouffée d’air frais à travers le point de vue subjectif de l’ourson mis à mort.
Yangyu Zhang.
Ainu Mosir de Fukanaga Takeshi. Japon. 2020. En salles le 17/10/2020 au Japon.





 Suivre
Suivre