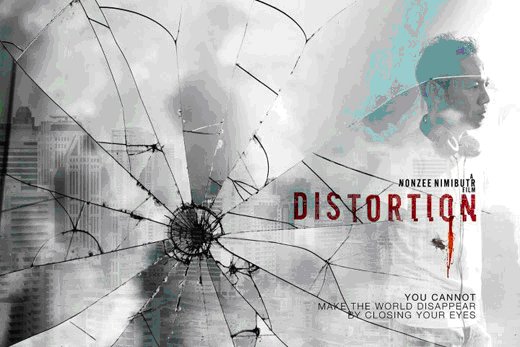Elle fut la grande révélation de l’année cinématographique coréenne 2016. Son premier long métrage The World of Us, a reçu en Asie une moisson de récompenses. Yoon Ga-eun, lors sa présentation au FFCP, a enchanté les spectateurs grâce à la justesse de son regard sur l’enfance. Une réalité racontée sans ambages, ni artifices, mais filmée avec une bienveillance sincère pour ses jeunes personnages. Nous avons pu découvrir au cours de son portrait l’éclosion d’une jeune cinéaste, talentueuse et prometteuse, qui au fil de ses courts métrages jusqu’à son premier long, a fait preuve d’un regard singulier et d’un don particulier pour diriger ses acteurs précoces. Le FFCP a de nouveau souligné dans sa programmation l’émergence et l’importance de femmes cinéastes, qui au sein d’un pays et d’une industrie patriarcaux, parviennent à monter des films personnels qui montrent la société coréenne sous un autre jour. Yoon Ga-eun a quant à elle le profil de la jeune auteure susceptible de séduire le grand public. Espérons que les distributeurs français auront suffisamment de flair et de courage pour la révéler. Nous avons eu la chance de nous entretenir avec elle.
L’enfance est un thème qui est au cœur de votre œuvre. Que vous inspire cette période de la vie?
C’est en effet, une thématique qui ressort dans mes films et notamment dans mon premier long The World of Us, mais cela ne veut pas dire que je vais forcément continuer à traiter de l’enfance dans mes prochains films. Je suis une jeune cinéaste. Je ne sais pas… cela vient peut être de mon vécu personnel, c’est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C’est récemment que j’ai commencé à me poser la question : pourquoi je traite de cette période de la vie, l’enfance ? J’ai beaucoup de souvenirs encore présents dans ma mémoire. Plus encore que le stade de l’adolescence et des autres période de ma vie, j’ai été plus marquée par mon enfance. Je pense que c’est dû à la sensation de découverte, de première fois, on ressent de nouveaux sentiments, de nouvelles expériences. Des nouvelles émotions, de nouvelles relations, et de nouvelles interactions avec les autres, on passe son temps à apprendre, c’est peut-être la raison pour laquelle cela marque autant. Quand on devient adulte, il y a des problèmes que l’on ne parvient pas à résoudre et qui prennent leurs origines dans l’enfance.

Y a-t-il des cinéastes que vous admirez dont le travail vous a inspirée pour traiter du sujet de l’enfance à l’écran ?
Oui en effet, Kore-eda Hirokazu ou François Truffaut sont des cinéastes qui m’ont beaucoup marquée. Toutes ces œuvres sont un peu comme une addiction pour moi. Il y a aussi les films des frères Dardenne ou Ken Loach qui ont plus fait des films sur les ados. Ce sont des réalisateurs très importants pour moi.
Dans vos films, les liens se tissent souvent autours de petits gestes anodins : un pansement pour soigner un bobo, les jeunes filles qui se maquillent les ongles. Comment faites-vous pour rendre avec tant de justesse cet âge à l’écran ?
Avant de travailler comme réalisatrice, j’ai occupé des petits boulots dans le domaine de l’enseignement et de la petite enfance. J’ai passé beaucoup de temps entourée d’enfants. C’est devenu tellement naturel pour moi de les observer, de les voir évoluer, apprendre à vivre et de voir comment les liens se tissent entre eux. Je ne les considère pas différents des adultes. Je ne les met pas dans une autre catégorie d’êtres humains. Ils sont pour moi des humains d’un certain âge et d’une certaine maturité qui sont à un stade d’apprentissage de leur vie. Cela se résume à des expériences. Nous, en tant qu’adultes, en avons plus qu’eux, mais dans des situations similaires, ils réagissent de la même façon que nous. Je ne souhaitais pas au stade de l’écriture du scénario prétendre, sous prétexte que mes personnages principaux étaient des enfants, qu’ils allaient avoir tel type de comportement ou s’exprimer de telle manière, Non ! Ce sont des êtres humains comme nous, ils expriment à leur échelle ou à leur manière des sentiments, des actions ou des réactions qui nous sont familiers.

Dans Sprout, le quotidien d’une jeune fille prend des allures d’aventure. Comment avez-vous conçu l’itinéraire de la jeune Bory ?
Sprout est un projet de fin d’études. Il fallait que je réalise un court pour obtenir mon diplôme. Il s’avère que mon précédent film Guest (2011) avait obtenu à ma grande surprise le premier prix au Festival du court métrage de Clermont-Ferrand en 2012. Cela aurait pu avoir un effet positif et entraîner une forme d’émulsion créative, mais au contraire, cela a été un facteur de stress, et je ne parvenais pas à trouver d’idées pour la suite. J’écrivais des centaines d’histoires qui finissaient toutes à la poubelle. J’avais du mal à gérer la pression, et je perdais confiance en moi. La date butoir approchant, je me demandais ce que j’allais bien réaliser. J’ai commencé à feuilleter mon petit carnet que je conserve toujours sur moi. En effet, j’ai tendance à prendre beaucoup de notes et faire des croquis. Je suis tombée sur une idée qui racontait l’histoire d’une petite fille qui part faire une course que lui demande sa maman et son chemin prend des allures d’aventure et elle revient bredouille. L’idée m’a marquée au point que j’épouse le point de vue de cette petite fille. Le but de la course n’est pas importante, c’est le périple qui compte vraiment. On a toujours une appréhension avant de faire quelque chose de nouveau, on ne sait pas si c’est bien ou pas, si on va réussir ou non. Je me suis un peu identifiée à mon personnage : je suis une jeune cinéaste, on me demande de réaliser un court, je ressens la pression, je ne sais pas si je vais y parvenir avec succès, mais ce n’est pas très grave, je me donne à fond et il faut profiter de l’aventure qu’offre une telle opportunité. Je me suis lancée, c’est cela le plus important.
J’ai été enthousiasmé par votre film, mais je ne veux pas vous mettre de pression… (rires)
Merci, je me suis inspirée de mes expériences personnelles pour écrire ce film. La petite fille Bory a peur des gros chiens, et il s’avère que moi aussi. Je n’ai pas le sens de l’orientation, et il m’arrivait de faire trois fois le tour du pâté de maisons avant de retrouver le chemin de ma maison. Ou bien lorsque j’avais l’impression que quelqu’un me suivait, une personne que je ne connaissais pas et que cela me faisait peur, je faisais semblant que ma mère était à côté et je l’interpellais pour faire croire que je n’étais pas seule.

Kim Su-an
On retrouve en effet une scène similaire dans votre court The Taste of Salvia (2009), dans laquelle deux jeunes filles se trouvent au piège avec un prédateur sexuel et s’en sortent grâce à leur jugeote. Y a-t-il dans vos films une intention de transmettre au jeune public quelques astuces pour se débrouiller dans ce type de situations ?
En effet, cela pourrait avoir un effet éducatif, même si ce n’était pas l’intention au départ. Je pense surtout qu’en tant que femme, on est amené, souvent plus que les hommes, à nous retrouver en position de victime. Et depuis que nous sommes petites, nous apprenons à nous protéger. Ce genre de choses, on l’apprend soi-même, mais aussi en échangeant avec des copines, notre entourage proche, nos sœurs et nos mères. Et même en tant qu’adulte. On se transmet des astuces, si un homme louche te suit, tu dois allumer ton téléphone.

Dans The Taste of Salvia, on trouve l’ébauche de votre premier long métrage. Comment s’est déroulé le stade de l’écriture ? Quelles furent les différentes étapes d’écriture ? Et de quelles expériences personnelles s’est nourrie cette histoire ?
Les sujets sur les difficultés dans les relations et du harcèlement à l’école me touchent parce que les ai vécus personnellement. The Taste of Salvia est mon premier film que j’ai réalisé en 2009 et The World of Us est mon premier long métrage, réalisé en 2015. Il y a 6 ans d’écart entre les deux films, et entre temps, j’avais essayé de traiter ce sujet d’autres façons, j’avais même écrit une nouvelle. J’avais besoin de raconter une histoire dont je maîtrisais bien le sujet étant donné que c’était une première fois. C’est rassurant pour moi. Arrivé au terme de mon court The Taste of Salvia j’avais un sentiment d’inachevé, de ne pas être allée au bout de ce que je souhaitais raconter. J’avais toujours gardé en moi cette idée que je reviendrai dessus plus tard pour approfondir les thèmes abordés dans ce premier court. C’est ainsi qu’a germé mon idée de long pour The World of Us.

Dans vos films et je pense plus particulièrement à The Guest et à votre premier long, on remarque que les problèmes des adultes ont de terribles répercussions sur le quotidien des enfants. Comment les traduire en langage cinématographique sans tomber dans les pièges du mélodrame lacrymal ?
Ce que souhaitais monter est une certaine réalité. On représente souvent les parents comme des êtres responsables qui doivent prendre soin de leurs enfants, et ces derniers sont des êtres qui se nourrissent de cet amour parental et grandissent. Je ne vois pas les choses de cette manière. Les enfants peuvent eux aussi apporter d’énormes soucis et de complications dans la vie des adultes et inversement, les problèmes des adultes peuvent aussi avoir de graves répercussions sur la vie de leurs progéniture. Ce que je souhaitais démontrer c’est la responsabilité partagée dans les relations qu’entretiennent les parents et les enfants. Les enfants, dans la société coréenne, vont avoir la charge et la responsabilité de leurs parents en grandissant. Il ne s’agit pas selon moi d’une relation à sens unique.
Entretien enregistré au FFCP le 31 octobre 2016 par Martin Debat.
Traduction : Ah-ram Kim.
Remerciement: Marion Delmas et toute l’équipe du festival.
The World of Us. 2016 .Corée. Projeté au FFCP en 2016.





 Suivre
Suivre