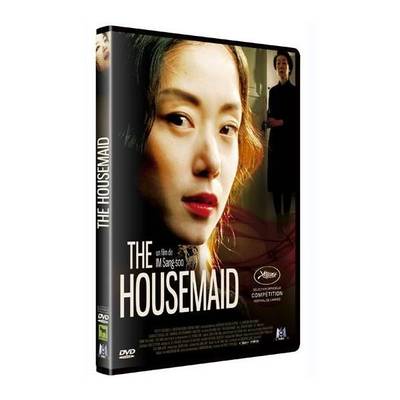En ce mois d’octobre 2025, la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, dédiée à la programmation du cinéma muet, offre une carte blanche à la National Film Archive of Japan (NFAJ) pour proposer au public parisien des films nippons de l’ère du muet, rares et de styles variés. Aux côtés de redécouvertes de réalisateurs méconnus, on peut croiser de grands films peu diffusés de cinéastes d’envergure, à l’instar de Naruse Mikio avec Après notre séparation, sorti sur les écrans japonais en 1933.
Kikue exerce l’activité de geisha pour payer des études à son fils Yoshio. Ce dernier a honte du métier de sa mère et sèche le lycée pour traîner avec une bande de voyous. Désemparée, Kikue demande à son amie Terugiku, geisha comme elle, de faire entendre raison à Yoshio. Au détour d’un séjour dans le village de pêcheur d’origine de Terugiku, les deux jeunes gens découvrent leurs sentiments…
En 1933, Naruse Mikio est un réalisateur d’expérience, qui signe plusieurs films par an, estimés aussi bien par la critique que le public. Dans Après notre séparation, on retrouve son style fin si caractéristique, une expression juste des sentiments qui a de quoi émouvoir sans effusion extrême – en somme, à rebours d’œuvres jusqu’au-boutistes comme Le Fil blanc de la cascade de Mizoguchi, sorti la même année.

De nombreux cinéastes se sont emparés de la condition des geishas. Après notre séparation évoque cette situation comme contrainte et forcée, mais un moyen de subsistance incontournable des familles portraiturées, qu’elles soient monoparentales (Kikue et Yoshio) ou lorsque les parents – souvent le patriarche – « vendent » leurs filles aux maisons closes. Le père de Terugiku l’a envoyée exercer cette activité et s’apprête à faire de même avec sa cadette, ce qui rend furieuse Terugiku et lui donne l’occasion de traiter son géniteur de feignant alcoolique. Si la prostitution est devenue inévitable pour Kikue, qui veut plus que tout que son fils fasse des études, le parcours de Terugiku est le fruit d’une immense lâcheté de son père, un personnage décrit de manière bien peu flatteuse. Le discours de protestation de Terugiku face à son paternel témoigne d’un tempérament courageux, dans une société japonaise conservatrice et phallocrate et où les geishas sont mises au ban. Dans ce film écrit par Naruse, qui scénarise le film en plus de le réaliser, la plainte de Terugiku est une émanation du parti-pris d’un grand nombre de cinéastes japonais, au premier rang desquels on retrouve Naruse, pour la condition de la femme.

L’écriture minutieuse met en valeur le couple en devenir de personnages principaux, Terugiku et Yoshio, dans toute la complexité qui caractérise les thématiques traversant leurs histoires personnelles et communes. Si on considère Naruse comme le maître des films de portrait de la classe moyenne japonaise, Après notre séparation s’intéresse à des individus bien plus démunis d’un point de vue matériel, dans un Japon qui n’a pas encore été lourdement appauvri par la défaite militaire de la Seconde Guerre mondiale. Après notre séparation peut presque être perçu comme un travail néoréaliste avant l’heure, certes mâtiné d’un style mélodramatique. Le film parle d’amour en effet, filial entre Yoshio et Kikue, et romantique entre Yoshio et Terugiku.
Avec une écriture au plus proche des sentiments profonds des personnages, la frustration, la honte, la résilience, la colère face à l’injustice, la sensation de tomber amoureux, Naruse montre ses sujets faire pourtant preuve de retenue dans l’expression, ce qui fait arborer au film une belle élégance. Les péripéties du métrage ne participent à aucune réelle originalité, puisque les romances impossibles, la misère des geishas et la délinquance rampante demeurent des thématiques universelles. Naruse a seulement le don de ne pas pouvoir montrer tout cela de manière plus juste et authentique.
Maxime Bauer.
Après notre séparation de Naruse Mikio. Japon. 1933. Projeté à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dans le cadre de la carte blanche proposée au NFAJ.





 Suivre
Suivre