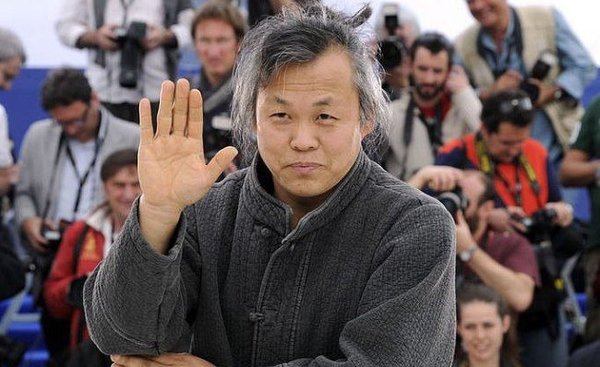Plus productif et exalté que jamais, le cinéaste kazakh Adilkhan Yerzhanov a retrouvé L’Étrange Festival de Paris pour cette édition 2025. Outre une carte blanche qu’il a animée, il a présenté au public du Forum des images, auquel il est habitué, deux films, Cadet et Moor, et les trois premiers épisodes de sa dernière série télé, Kazakh Scary Tales. Il nous a fait l’honneur de nous accorder une interview exclusive dans laquelle il est revenu longuement sur ses inspirations et on pourra constater, s’il fallait en douter, qu’il est extrêmement cinéphile.
Cette année à L’Étrange Festival, vous présentez trois sorties, deux films (Moor et Cadet) et une compilation d’épisodes d’une nouvelle série (Kazakh Scary Tales). Cela fait des années que vous vous adonnez à différents genres, différentes histoires, différents effets de style. D’où vous vient cette inspiration continuelle qui semble en plus progresser avec les années ?
Je pense que quand on fait des films qui se ressemblent trop, c’est là qu’on commence à s’ennuyer, non ? Je cherche toujours à revitaliser l’amour pour la vie, et c’est le cinéma aussi, ça. Si je ne prépare pas un nouveau film, c’est que je n’aime plus la vie. Je suis toujours en train de préparer un nouveau film. Je cherche des thèmes ou des motifs qui fonctionnent comme des impulsions ou des sources d’inspiration qui vont me donner envie d’en refaire un nouveau. Ça peut être des genres, de l’horreur ou du western, mais ça peut être plein d’autres choses. Vous savez, en cinéma, je suis omnivore, j’ai des goûts très éclectiques. Ce que j’aime c’est le bon cinéma, quel qu’il soit. J’aime la poésie dans les films.

Dans Rio Bravo d’Howard Hawks, il y a cette séquence où les deux personnages se baladent avec leur revolver. J’ai revu récemment ce film et j’ai compris que cette scène, c’est celle qui a fait naître Sergio Leone. Sergio Leone tout entier est sorti de cette séquence. En l’ayant revue, je l’ai trouvée incroyable et me suis dit que c’était la vraie musicalité cinématographique et ça m’a donné envie de faire Steppenwolf. C’était l’endroit d’où était originaire tout le western spaghetti et je me suis dit que je voudrais faire quelque chose un peu comme ça dans mon œuvre. Pour Cadet, c’est le cinéma de Kurosawa Kiyoshi qui m’a beaucoup intéressé. Je pense que le sens de la vie, on le trouve dans la vie mais aussi dans le cinéma des autres ; je suis amoureux de la beauté de leurs œuvres. Quand je vois quelque chose au cinéma qui m’inspire, j’ai envie de le digérer et de le recomposer pour en faire quelque chose qui m’appartient.

Moor est une rupture dans votre filmographie, car le décor est planté dans une grande ville. Auparavant, une grande partie de votre filmographie se passait dans les steppes et dans les espaces naturels, ce qui caractérisait vos films. Comment avez-vous abordé de tourner dans ce genre de décor ?
Quand on filme dans une ville, une histoire semble devenir une histoire purement individuelle. Alors que quand on filme dans la steppe, on bascule dans un autre registre, on est dans le folklore. Le choix du lieu est une question d’ampleur et d’universalité du récit. J’avais peur de tourner en ville, car je craignais que ça ne rétrécisse mon propos, au fond. La ville correspond moins à ma conception cinématographique du monde. Il y manque la géométrie, les espaces… La ville d’Almaty, deuxième ville du Kazakhstan, là où vivent tous les cinéastes, est une ville très éclectique, très discordante. Il s’y trouve à la fois beaucoup de bâtiments de l’époque soviétique – et pas les plus jolis – et beaucoup de constructions plus nouvelles mais qui ne vont pas bien les unes avec les autres. C’est un drôle de lieu, sans aucun style harmonieux et cohérent. Je n’aime pas filmer en ville et je ne voulais pas le faire à la base. La steppe est plus cohérente, plus harmonieuse. Mais effectivement, nous avons décidé de faire une exception avec Moor parce que c’est un film néo-noir et il fallait quand même que ça se passe en ville. On a cherché comment filmer la ville pour obtenir quelque chose qui ressemble au parti pris qu’on a pu avoir plus tôt dans la steppe. Par exemple, je ne suis pas très fan des plans de drone qui sont devenus une banalité, mais il nous a fallu en faire pour avoir ce genre de vue générale de la ville noyée dans la brume. On a cherché des lieux qu’on pourrait qualifier de « steppiques » : le parking, avec de grands espaces par exemple. Avec mon directeur artistique, Yermek Utegenov, mon chef opérateur Yerkinbek Ptyraliyev, on a cherché à recomposer quelque chose de l’ordre des endroits en extérieur comme la steppe, bien que cela se déroule en ville. Il y a des exceptions bien évidemment, comme l’ascenseur qui est oppressant, tout comme le lieu du dernier combat… On avait de toute façon un tout petit budget sur ce film, il demeurait quelques limitations liées à ça. Dans l’ensemble, je trouve qu’on a réussi à créer une esthétique de la ville harmonieuse et à donner une image originale d’Almaty dans le cinéma, on ne l’aura pas filmée comme les autres.

L’étalonnage dans vos films est très subtil. Par exemple, dans La Tendre indifférence du monde, le bleu du ciel et le rouge de la robe de l’héroïne semblent discordants. On voit ça dans un peu toute votre filmographie. Moor est plutôt « gris lumineux » mais l’héroïne a les cheveux rouge vif. Dans L’Education d’Ademoka, le jaune, le bleu et le rouge-orange des cheveux est également très marqué. Comment imaginez-vous la fonction de l’étalonnage dans vos films ?
On prépare tout et on pense très en amont à toutes ces questions avec mon équipe. Pour ces couleurs spécifiquement, je pense que ça vient de mon enfance. Quand j’étais gamin, je dessinais des BD et les crayons que j’épuisais en premier, c’était le jaune, le rouge et le bleu ! C’était mes couleurs favorites. Si tu mets sur ton personnage du jaune vif, ça attire l’attention sur lui et ça le rend principal, mais aussi, ça lui confère une force vitale. Ça donne envie de vivre. J’ai toujours aimé l’association du rouge et du jaune et si on peut rajouter un peu de bleu, c’est encore mieux. Mais je ne suis pas sûr que ça veuille dire quelque chose de spécifique. Ça se joue au niveau de la sensation et ça vient de mon enfance. J’ai lu bien évidemment Johannes Itten sur les couleurs, que ce sont des couleurs opposées au niveau du spectre, que ce sont les trois couleurs primaires… Mais je ne le savais pas quand j’étais enfant. Cet attachement à ces couleurs est instinctif et vient de loin.

Dans tous vos films, il y a une charge politique. Dans L’Education d’Ademoka, il est question d’immigration et d’éducation. Dans The Owners ou Yellow Cat, il y a l’idée que des gens malhonnêtes en bande organisée se trouvent à tous les échelons de la société. Est-ce que vous pensez que le monde est malade ?
Pour dire les choses clairement, je pense que le monde a toujours été comme ça. La vie en commun des êtres humains est une chose à la fois merveilleuse et abominable. Le rapport de l’individu à la société est un éternel problème. Si les êtres humains savaient cohabiter harmonieusement, on ne les aurait probablement pas chassé du jardin d’Éden. Je vis au Kazakhstan, c’est la société que je connais et je la connais très bien, donc je parle de cela précisément. Je n’ai pas vécu dans d’autres sociétés donc je ne vais pas parler d’elles. Ce que je vais refléter dans mon film, c’est ce dans quoi je vis.
Je trouve qu’il est très important de ne pas filmer de mensonge. C’est vrai pour tout le monde, pas uniquement pour les cinéastes ; c’est vrai pour Flaubert, pour Cervantès : dans toutes leur œuvre, on va trouver des éléments de la société dans laquelle ils ont vécu, de la politique qui les a entouré. Pour qu’une œuvre soit vivante, elle doit être en lien avec la vie réelle. C’est ce qui m’excite dans l’art : c’est toujours le reflet de la vie. On peut faire un film sur Mars, ce serait quand même un reflet de la société réelle dans laquelle vit son auteur ! Tous les cinéastes qui font du fantastique parlent du monde dans lequel ils vivent réellement.

La première partie de votre filmographie est plutôt dédiée à la comédie absurde. Vous semblez vous orienter de plus en plus vers le genre ; le néo-noir, l’horreur, des registres plus spectaculaires. Qu’est-ce qui vous a décidé à aller dans cette direction ?
J’aime le genre. Je pense que le cinéma d’auteur seul, c’est ennuyeux. J’aime que dans les films il y ait un univers, un héros, un but, et qu’il y ait une lutte pour aller vers ce but. S’il n’y a pas tout cela, je vais m’ennuyer, même s’il y a beaucoup de style ou de profondeur psychologique. J’ai besoin qu’il y ait des conventions de genre et – je n’ai pas peur de mot – du divertissement ! Kitano, Chaplin, Melville, Haneke, Todd Haynes, tous ces réalisateurs sont profonds et divertissants à la fois. Il y a un art dans le fait de passionner et d’intéresser le spectateur. Peut-être que j’y suis allé progressivement, mais j’ai toujours aimé le genre et je me suis toujours dirigé vers ça. Mon rêve, c’est qu’un jour on me traite d' »auteur vulgaire », c’est-à-dire un cinéaste à la limite du cinéma d’auteur et du cinéma commercial. Ce à quoi j’aspire, c’est faire mon cinéma à moi sur le territoire du genre. Si on lit les vieux philosophes comme Euripide, Sophocle ou Aristote, ils sont aussi convaincus qu’il faut des conventions de genre pour raconter la moindre histoire. On ne peut pas raconter une histoire sans ça.
Plusieurs de vos acteurs vous sont loyaux, on les retrouve dans plusieurs de vos films. Comment vous les avez rencontrés ? Comment les choisissez-vous pour un rôle ?
Quand je vois une personne, que ce soit un acteur professionnel ou non, je vois tout de suite s’il ou elle a du charisme, la capacité à être intéressant à l’écran. Peu importe le texte qu’on lui donne. Je vois qu’il a la capacité d’intéresser le spectateur quand il va être filmé. Ce n’est pas moi qui les rend intéressantes, ces personnes, ils sont déjà des « attractions » selon la terminologie d’Eisenstein. Au fur et à mesure des essais, je ne leur fais que faire quelques ajustements, mais c’est seulement pour les aider à sortir l’or déjà en eux. En revanche, si je ne vois pas que la personne a ces capacités, même si elle est capable de les déployer chez d’autres cinéastes, alors je ne pourrai rien y faire et je ne pourrai pas travailler avec. Dans les rares cas où on tombe sur un acteur professionnel et qui possède ce charisme, ce sont des perles rares, je m’accroche à eux et je ne les lâche plus ! Ce sont eux, d’une certaine manière, qui permettent de créer le style de mes films.
Kazakh Scary Tales est votre nouvelle série d’horreur. Vous avez parlé de Kurosawa Kiyoshi tout à l’heure. Quelles sont vos inspirations en matière d’horreur ? L’aspect sériel de genre rappelle The Twilight Zone…
Oui, j’adore Rod Serling ! Selon le chercheur Thomas Foster, il y a quatre sources d’inspiration d’où sont originaires toutes les œuvres de fiction de tous les genres : la Bible, Shakespeare, le folklore et la mythologie antique. Eh bien moi j’en rajouterais une cinquième, The Twilight Zone ! Pour moi c’est une œuvre incroyable et je ne comprends pas comment une personne a pu imaginer tout cela à elle seule. Chaque épisode est un concept complètement différent à chaque fois. Le cinéma lui doit énormément. Terminator, Un Jour sans fin, Saw, Retour vers le futur, toutes ces franchises sont issues de The Twilight Zone. C’est un phénomène dans la culture mondiale, et quand j’ai fait cette série, je l’ai pensée comme un hommage.

Quels sont vos prochains projets ?
Je viens de terminer un film qui est au stade de la post-production. Il s’intitule Torguud, du nom des gardes du corps mongols de Gengis Khan. L’histoire est la suivante : il y a à Karatas un dictateur qui a très peur ; on essaye d’attenter à ses jours et il rassemble auprès de lui une horde de gardes du corps. Le chef des gardes du corps est interprété par Berik Aitzhanov, l’acteur principal de Steppenwolf, mais une tueuse à gage arrive en ville, c’est Anna Starchenko, et s’engage un duel muet entre ces deux personnages. La question éthique sous-jacente est complexe : faut-il protéger un dictateur ?
Quel est votre moment de cinéma, un film ou une scène qui vous inspire et à laquelle vous pensez maintenant ?
Il y en a beaucoup ! Je vais en citer une : une séquence de 2001, L’Odyssée de l’espace. La mort de Hal montre que l’intelligence artificielle devient plus humaine que l’être humain face à elle puisqu’elle demande qu’on ne la tue pas. Je trouve ce moment extrêmement émouvant, il me retourne l’âme à chaque fois. Dans notre quotidien, nous parlons tous les jours avec ChatGPT . Nous y sommes, ce moment où la question peut se poser de savoir qui est le plus humain de nous deux.
Propos recueillis par Maxime Bauer au Forum des images de Paris le 13/09/2025.
Traduction : Eugénie Zvonkine.
Remerciements : Clara Ollier.
Cadet, Moor, Kazakh Scary Tales d’Alidkhan Yerzhanov. Kazakhstan. 2024-2025. Projeté à L’Etrange Festival 2025.





 Suivre
Suivre