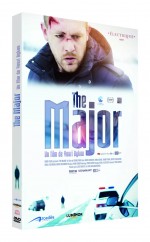2019 aura marqué l’avènement du cinéma coréen auprès du grand public, notamment grâce au succès populaire de Parasite de Bong Joon-ho. Le Festival du Film Coréen à Paris (FFCP) aura donc eu à cœur d’être à la hauteur en termes d’invités. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut le cas : le rôle principal de Parasite, probablement le plus grand acteur coréen contemporain, Song Kang-ho, était un invité de la section focus, accompagné du non moins célèbre réalisateur de la nouvelle vague coréenne : Kim Jee-woon. Ils sont tous deux venus présenter auprès du public 3 des 4 films qu’ils ont tourné ensemble : The Quiet Family (1998), Le Bon, la Brute et le Cinglé (2008) et The Age of Shadows (2016). Nous avons pu nous entretenir avec ces deux monstres sacrés du cinéma coréen.

Votre cinéma est constamment en mouvement : la caméra, les objets, les personnages, les éléments, se meuvent dans une chorégraphie cinétique. Comment abordez-vous votre mise en scène et quels sont les cinéastes qui vous ont influencés ?
Kim Jee-woon : Le mouvement de la caméra relève effectivement du style. Il y a 2 façons de montrer le changement de caméra : le process d’une part et lorsque la caméra suit les personnages d’autres part. Par exemple, dans The Foul King et The Age of Shadows, le mouvement de caméra suit les personnages. Dans Le Bon, la Brute et le Cinglé également et d’autant plus que le concept des 3 personnages est central. C’est comme cela que l’on arrive à montrer certains espaces à travers la caméra. J’utilise la caméra de telle manière à pouvoir retranscrire une scène de manière unique, à l’image de A Bittersweet Life, dans lequel les scènes de combat accentuent le côté film noir. Le mouvement de caméra sert à accentuer l’aspect esthétique et visuel.
Il y a un film dans lequel je mélange ces 2 procédés. Dans The Age of Shadows, on voit dès le début un mouvement de caméra très rapproché sur le personnage, pour découvrir qui il est et ce qu’il va se passer après. Par la suite, pour évoluer dans l’histoire de manière plus objective, j’utilise un plan de caméra plus détaché, de loin. Une fois que tous les personnages sont bâtis, je peux insérer un mouvement différent, beaucoup plus rapproché, pour suivre l’intérieur de chaque personnage. C’est avec The Age of Shadows que vous pouvez le plus analyser mon cinéma par le biais des mouvements de caméra.
Je pourrais citer des tonnes de cinéastes qui m’ont inspiré. Pour vous parler des cinéastes français, j’ai en tête Henri-Georges Clouzot, pour sa façon de filmer de manière assez grotesque ; Robert Bresson, pour ses côtés les plus basiques mais non moins fascinants ; Jean-Pierre Melville pour sa mélancolie. ; Jacques Deray, qui est l’exemple type du cinéaste de films policiers à la française ; ou plus récemment, Leos Carax qui a cette capacité de montrer du classique de manière fraîche.
Vous avez joué pour 3 des réalisateurs les plus éminents de Corée, probablement les plus connus en France : Kim Jee-woon, Park Chan-wook, Bong Joon-ho. Comment décririez-vous votre approche d’acteur vis-à-vis de leurs films ? Est-ce différent de travailler avec l’un ou l’autre ?
Song Kang-ho : (rires) De façon imagée, imaginons que l’on soit sur un terrain vague et qu’il y a un couple en train de s’embrasser. Si la scène est filmée par Park Chan-wook, on verrait un gros plan sur le couple en train de s’embrasser, ils se mordraient la langue et il y aurait du sang qui dégouline… Si elle l’était par Bong Joon-ho, on les verrait s’embrasser de façon romantique puis on apercevrait un serpent géant passer derrière… Et à la manière de Kim Jee-woon, ils seraient en fait en train de se lécher le nez. (rires)

Hormis ces trois grandes collaborations, y’a t-il des cinéastes avec qui vous avez aimé travailler particulièrement ?
Song Kang-ho : Il y a effectivement un réalisateur auquel je pense, qui est d’une génération plus ancienne que ces trois-là : il s’agit de Lee Chang-dong. Je l’ai connu il y a une vingtaine d’années à l’époque où j’étais comédien de théâtre. Il y a beaucoup de collaborations que j’ai appréciées dans ma carrière mais c’est peut-être avec Lee Chang-dong que j’ai envie d’aller un peu plus loin, avec qui j’ai plus de connexions, de manière artistique.
Pour vos films Le Bon, la Brute, le Cinglé et J’ai rencontré le diable, vous avez utilisé des montages différents pour la Corée et l’international. Pour quelle raison ? Qu’apportent ces plans de plus ou de moins au montage ?
Kim Jee-woon : Comme pour des auteurs qui réitèrent des publications, on peut songer à effectuer des petites modifications ou corrections sur son travail. C’est ce que j’ai voulu faire : corriger des choses qui ne me plaisaient pas au premier montage. Aussi, je fais partie de la génération DVD, un média où l’on peut sortir, dans des éditions dites collector, une version director’s cut. Je m’étais fixé de faire un montage pour la sortie DVD en Corée, et une fois que la sortie était vendue à l’étranger, pourquoi ne pas imaginer une autre fin ? Toutes ces versions émanent de mon esprit, ce sont donc toutes des versions director’s cut.
Quand le film sort en DVD en Corée, je me dis que je peux ajouter des idées en plus dans le montage. On fait alors le montage du DVD d’une autre façon. Et c’est à ce moment que des festivals à l’étranger me contactent pour que je leur propose mon film. Je leur envoie donc cette version du film, celle du DVD, et c’est celle-ci qui est montrée à l’étranger ! C’est arrivé quelques fois.

Vous êtes capable d’interpréter un large éventail de rôles : personnalités historiques, homme du peuple, baron de la drogue, policier désabusé, des rôles dramatiques, des rôles comiques. Comment choisissez-vous vos rôles et comment les abordez-vous une fois que vous avez lu le script ?
Kim Jee-woon : Tant qu’il a l’argent, il est obligé de le faire ! (rires)
Song Kang-ho : (rires) En fait il n’y a pas vraiment de secret. Quand je reçois le scénario, j’essaie de m’imprégner au maximum du personnage pour comprendre quelle est la personnalité recherchée. Ce qui est primordial, c’est de comprendre la volonté du réalisateur, de savoir ce qu’il a envie de raconter comme histoire. Et ce que vient de dire Monsieur Kim Jee-woon est très central ! (rires)
Malgré tout, vous avez la volonté de vous conformer à la vision du réalisateur et ne pas imposer la vôtre ?
Song Kang-ho : En réalité, il n’y a pas de relation de supériorité/infériorité entre le réalisateur et moi. C’est une question d’équilibre, de s’accorder sur le personnage et assez rapidement. Il n’est pas nécessaire de passer par des heures de répétition ou de dialogues pour savoir si on est d’accord sur l’angle à adopter. On est dans une même atmosphère et on le ressent rapidement. C’est cela qui me pousse à me mettre au même niveau que le réalisateur.
Kim Jee-woon : Ce qui est hallucinant chez Song Kang-ho, c’est qu’il a ce côté monstrueux, qui va toujours de pair avec un aspect familier, passe-partout. Le cinéma raconte l’histoire des gens, c’est un média construit de la sorte, et on peut y apporter une touche d’ironie. Song Kang-ho a un côté double, oui, mais comme tout le monde. Il sied très bien à l’universalité du cinéma.
Vous avez tenté l’expérience américaine avec Le Dernier rempart. Comment cela s’est-il passé ? Quelles différences dans une production américaine ? Vous avez eu un temps le projet d’adapter le comics Criminal au cinéma, qu’est devenu ce projet ?
Kim Jee-woon : Pour Criminal… ça s’est cassé la gueule, le projet n’existe plus. Je l’appréciais vraiment et je suis désolé que ce soit tombé à l’eau. J’avais rencontré Josh Brolin et les autres acteurs, ils étaient complètement partants pour le faire, mais au final, ça ne s’est pas fait. Ça aurait été super de le faire dans la foulée d’Avengers. À l’époque, on était encore des acteurs et des réalisateurs de films d’auteur, je n’étais pas vraiment mis en avant devant tout le monde. C’est pour ça que ça ce n’est pas fait.
Quand je suis allé à Hollywood, je ne suis pas parti avec l’idée de tout révolutionner. C’était une période de ma vie où j’avais besoin d’un air nouveau. Je venais de terminer J’ai rencontré le diable et il me fallait un changement de décor. J’avais une approche humble : je savais bien que personne ne me connaissait là-bas. Je me doutais bien que je ne pourrais pas faire tout ce que je voulais, donc j’allais commencer par accepter ce que l’on me proposais. Quand je suis arrivé, j’étais étonné par les méthodes de travail, car en Corée, on pouvait travailler jusqu’à 16h par jour. Aux États-Unis, on m’a prévenu : c’est 12h maximum. Ça m’a coûté cher car je n’avais pas l’habitude de travailler de cette manière-là. Une fois que j’avais terminé mon projet aux États-Unis, je me suis dit que c’était terminé avec cette histoire hollywoodienne, je rentre en Corée et je tourne à ma façon. Je rentre donc en Corée et là, changement du cadre légal : on n’a plus le droit de travailler que 12h également ! (rires)

Vous avez traversé 3 décennies de cinéma, des années 1990 aux années 2010, de votre posture d’acteur et de réalisateur, diriez-vous que le cinéma coréen ait beaucoup changé, que ce soit dans le rapport aux réalisateurs, à la production, au public ?
Kim Jee-woon : Pour répondre à votre question, il faut parler de toute l’histoire du cinéma coréen moderne. Pour abréger, on peut dire que la Corée du Sud était un pays très méconnu jusque dans les années 1980. Peu de monde voyageait sur son sol, que se soit pour des raisons politiques, économiques ou culturelles. Il y avait jusque-là deux camps : le camp pro-démocratie et le camp anti-démocratie. Dans les années 1990, la démocratie s’est enfin installée avec le gouvernement du président Kim Dae-jung. Des formes d’oppression ont ainsi disparues, notamment au niveau de la culture. Les jeunes militants y sont pour beaucoup. La politique de Kim Dae-jung a permis aux réalisateurs de s’exprimer. Il y a 25 ans a aussi été abolie la forme de censure qui consistait à bannir certaines thématiques dans le cinéma. En 1998, le top 10 du box-office coréen comportait 7 ou 8 films d’un réalisateur débutant, dont c’était la première œuvre. Vous voyez à quel point le cinéma coréen était en ébullition. C’est à cette époque que j’ai rencontré Song Kang-ho, sur The Quiet Family. À ce moment-là, on a parlé de nouvelle vague, de la renaissance du cinéma coréen. Le cinéma coréen est devenu quelque chose de fort, d’iconique, mais cet état de fait est très lié au contexte historique de la Corée. 1998 est vraiment une année charnière, avec l’apparition d’une nouvelle génération de réalisateurs, de producteurs et d’infrastructures aussi. C’est cela qui a apporté un vent nouveau.
Propos recueillis par Martin Debat et Maxime Bauer à Paris le 30/10/2019.
Propos retranscris par Maxime Bauer.
Traduction : Kim Ha-ram.
Remerciements : Marion Delmas ainsi que toute l’équipe du FFCP.





 Suivre
Suivre