Deux parutions universitaires importantes à signaler, dont le premier mérite est celui de proposer d’autres axes de lectures de films et d’installations venues de Thailande et du Japon, privilégiant le rôle du cadre et contexte chez David Teh (Thai Art : Currencies of the Contemporary), professeur à l’Université Nationale de Singapour et celui des genres et des systèmes de production chez Alex Zahlten (The End of Japanse Cinema Duke) qui enseigne à Harvard.
L’ouvrage de Teh, Thai Art : Currencies of the Contemporary, porte sur l’art contemporain thai, et consacre quelques pages lumineuses au travail d’Apichatpong Weerasethakul, qu’il perçoit comme une incarnation contemporaine de l’esthétique Nirat. Il explique que loin de nombreuses traditions narratives qui vantaient les mérites du voyage, de l’exploration, de périples en haute mer, le récit thai, sa poésie, s’accomplissait à l’intérieur de ses frontières et s’adressait à un amant, un être cher. Ce n’est qu’au cours des années 90 que l’art thai est véritablement repéré à l’étranger, à travers les œuvres de Navin Rawanchakul et de Rikrit Tiravanija, qui chacune, avec le concours de commissaires tels que Hans Ulrich Obrist et Nicolas Bourriaud, qui en fit des exemples phares de son esthétique relationnelle, affichèrent un désir de globalisation. Leurs installations, leurs performances et déplacements racontaient leurs parcours, Tiravanija, enfant de la diplomatie ayant grandi dans le monde entier, et Rawanchakul, enfant pakistanais dont le père fuit la partition avec l’Inde et se pose en Thaïlande.
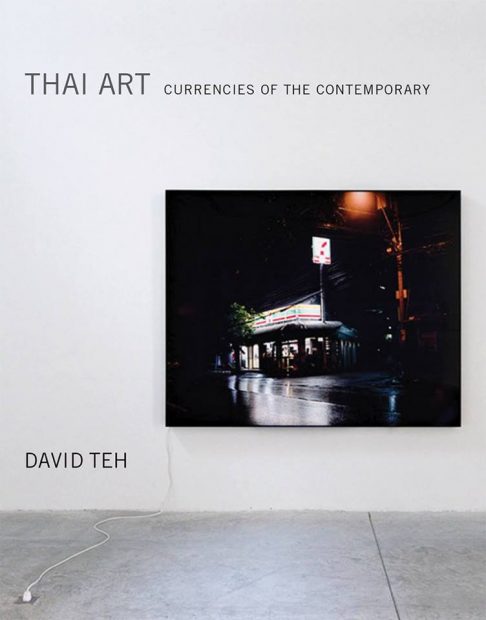
Apichatpong Weerasethakul est indissociable de ce moment. Ses films, ses vidéos, ses expositions parcourent le monde. Il est aussi lié à la maison de production française Anna Sanders, et donc aux côtés d’artistes comme Pierre Huyghe, Philippe Parreno, ou encore Dominique Gonzalez-Foerster. Pourtant, son œuvre, à ce jour, ne parle que de la Thaïlande, construisant une topographie, notamment celle des classes plus modestes du nord est qui doivent souvent se déplacer pour travailler, et à travers ces trajets, en camion, bus, scooter, une identité de lieu et de récit se révèle d’un film à une vidéo à ses photos, et aura signalé aux artistes thai l’intérêt que lui prête désormais la scène internationale, confirmé par la Palme d’Or pour Oncle Boonmee (celui qui se souvient de ses vies antérieures) en 2010.

Si le livre de David Teh traite d’un essor, celui d’Alex Zahlten décrit une chute, celle du cinéma japonais ‘noble’, et ce qui lui succéda. Il décèle un moment dont il fait le point d’origine de sa thèse, lorsque Kurosawa Akira refusa de serrer la main du producteur Kadokawa Haruki lors de la première de Kagemusha au Japon. Kurosawa l’accusait d’être responsable du déclin du cinéma d’art et d’essai au Japon, de préférer soutenir une série de films commerciaux, adaptés de bestsellers ou mangas publiés par la maison Kadokawa. Zahlten, qui fit autrefois partie de l’équipe du festival de cinéma Japonais Nippon Connection, à Francfort, avance qu’avec le concours du film pinku et plus tard l’émergence du V-Cinema, les films qui sortaient directement en cassette, dont quelques titres marquants furent signés par Mikke Takashi, Kurosawa Kiyoshi, Kadokawa, mettait un terme à l’ambition esthétique du cinéma japonais.
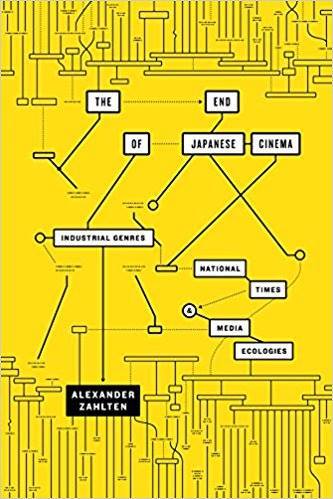
L’argument de départ peut cependant sembler fragile. L’ouvrage fait de Kurosawa Akira l’incarnation de l’art cinématographique nippon, le maître à succès, puis renié, qui tente de se donner la mort, qui s’exile le temps de quelques films car plus aucun producteur japonais ne le soutient… Une histoire écrite par les grands festivals internationaux qui ont récompensé l’ampleur de l’œuvre de Kurosawa, par la critique européenne, et par les cinéastes américains qui l’ont produit, qui se sont inspirés de lui. Mais c’est ne pas tenir compte d’une autre chronique qui s’écrivait au Japon, celle des studios Nikkatsu, Toei, ou encore Shintoho, celles de cinéastes issus de ces studios qui mettront des décennies avant d’exister à l’étranger, y compris lorsqu’ils ne tournent plus depuis des années.
On l’aura compris, cette fin dont parle Zahlten tient à celles des studios, comment les indépendants prennent le dessus et dévoilent un autre visage du Japon. D’ailleurs, Alex Zahlten, qui reprend parfois du service pour Nippon Connection, aime concevoir des programmes consacrés aux films des années 80 produits par… Kadokawa.
Et pourtant, il existe bien une fin du cinéma japonais…
Stephen Sarrazin.
David Teh, THAI ART, Currencies of the Contemporary, MIT Press, 2017.
Alexander Zahlten, The End of Japanse Cinema, Duke University Press, 2017





 Suivre
Suivre












