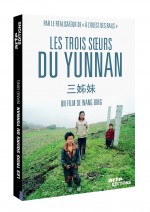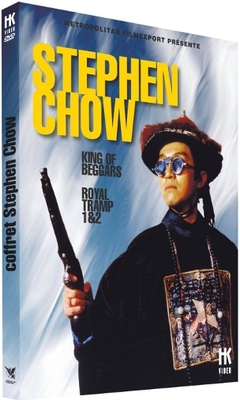Un nouveau Hong Sang-soo sort en salles ! HSS pour les intimes, c’est ce cinéaste sud-coréen, à l’extrême bord de la marge industrielle qui, en adaptant l’économie de ses budgets à la sobriété de ses productions, a réussi à composer depuis 1996 une Œuvre de 33 longs-métrages. S’il fait passer ses pairs pour des paresseux, il n’en connaît pas la même renommée institutionnelle. Néanmoins, par sa radicalité, la transparence de son style qui permet à celles et ceux qui aiment ses films de s’y projeter pour y composer un amour d’artifice, grâce à cette faculté à nouer une relation étroite avec son public, Hong a construit des fidèles. Et le cœur du problème de ses derniers films, y compris de Ce que cette nature te dit, on peut le présumer, vient de là : des aficionados de Hong Sang-soo.
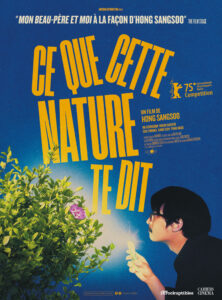
Pour son nouveau film, le cinéaste de 65 ans suit Donghwa, un jeune poète de Séoul. Il conduit sa petite amie Junhee chez ses parents, aux alentours d’Icheon. Émerveillé par la beauté de leur maison nichée dans un jardin vallonné, il y rencontre son père qui l’invite à rester. Au cours d’une journée et d’une nuit, il fait la connaissance de toute la famille et la nature de chacun se révèle.
Depuis plusieurs productions, La Voyageuse, In Water, La Romancière, le film et le heureux hasard, Hong traite un récit de révélation. Procédé de dévoilement qui a toujours été à l’œuvre chez lui, notamment dans ses scènes d’ivresse où tombent les masques sociaux et où, soju aidant, les vérités se délivrent. Dans ses derniers films, à l’épiphanie plus explicite, ses protagonistes sont, comme le roman chez Stendhal, un « miroir qu’on promène le long du chemin » , des anges divulgateurs ou une baguette de sourcier qui révèle la nature des personnes satellites. Le procédé a séduit lors de ses premières occurrences (la meilleure restant la grande actrice Lee Hye-hyong dans La Romancière, le film et le heureux hasard). Or, au bout de la quatrième mouture du même motif, le plaisir de l’idée et la saveur de son exécution s’épuisent. Décalquant de Claude Monet son goût pour les variations décuplées du même motif, Hong advient au même résultat : la lassitude, dont l’effet d’échos produit non pas une duplication sensible mais un sentiment de reprographie, aussi artificiel qu’industriel. Ainsi, à force de décliner les récits de révélateur, son cinéma et ses coutures finissent eux-mêmes par se révéler.
Des éléments du film viennent comme signaler une sorte d’arthrose du dispositif du cinéaste. La vieille voiture que conduit le jeune poète Donghwa, datant de 96 (année de réalisation du premier long de Hong, Le Jour où le cochon est tombé dans le puits), représente sans détour la machine-cinéma que conduit, cahin-caha, le cinéaste depuis près de 30 ans maintenant. Conscient de la grippe mécanique de sa propre mise en scène, comme la voiture souffre de problèmes d’embrayage, Hong inclut dans son scénario-même son impuissance à varier les vitesses et à embrayer de nouveaux récits vers des affects singuliers.
Le sens du sens chez le cinéaste reste intact. Sa faculté, dans une économie à l’extrême, de produire de la signification à partir d’éléments simplistes, reste immaculé. Ainsi, également, dans la 2e partie, les hommes pérorent à l’extérieur tandis que les femmes se confient en chambre. Comme chez Pedro Costa qui parlait « du cinéma des hommes » et du « théâtre des femmes » dans Dans la chambre de Vanda, Hong ordonne dans cette partie « l’extérieur des hommes » et « l’intérieur des femmes ». Et toute la lecture du récit, en suivant les passages obligés de son cinéma, ce que le cinéaste offre en partage de sa vision du monde, se joue à l’aune de ces tropes. Comme en art, on le sait depuis Logique de la Sensation de Deleuze, tout n’est qu’affaire de sens et de sensation, dans Ce que cette nature te dit, la propension à la signification est là, inchangée.
La sensation, c’est autre chose…

Le sens de la sensation pèche parce que, comme le dit le protagoniste lors d’une scène de dîner nocturne arrosé (un must have dans chaque film de HSS) : “J’essaie de vivre avec le strict nécessaire”. En œuvrant dans un réalisme à l’os, strictement nécessaire, qui tâche d’intervenir le moins possible sur la technique, sur le montage, sur la direction d’acteurs (sur le scénario-même, en apparence), Hong a depuis longtemps inventé un néo-néoréalisme Or, comme le disait Fellini : « Le néoréalisme est un acte d’humilité devant la vie… et devant la caméra. (…) Mais cela a fini par produire une humilité impersonnelle« . Certes « les choses sont là, pourquoi les manipuler ? » (dixit Rossellini) or faut-il encore que les choses valent le coup, soit qu’elles soient fascinantes de vérité par leur complexité, soit qu’elles soient puissantes de beauté par leur enchantement plastique. Si parmi les meilleurs films de Hong, d’aucuns réussissent à trouver les deux (Un jour avec, un jour sans, Conte de cinéma, La Femme qui s’est enfuie…), cela fait plusieurs films maintenant que ces deux quêtes nobles sont largement abandonnées, produisant cette signature impersonnelle.
L’absence apparente d’enjeux dramatiques permet bien au cinéaste de créer un rapport détendu, relaxé, sans appréhension face au réel. Il peut par là, dans le meilleur des cas, réussir à produire un effet de présence, une intimité avec les personnages. Or c’est sans compter, malheureusement, l’artificialité patente que produit le laisser-aller technique de la réalisation. En abandonnant sciemment la photographie à une piètre qualité, avec des blancs “cramés” dans une majorité de plans et le point flou sur plusieurs séquences, le cinéaste fait œuvre de noble intention : face aux productions en 8K HFR qui fleurissent dans l’industrie sud-coréenne, opposer un cinéma résistant en basse résolution. En ça, Hong poursuit sa quête de l’’anti-cinéma » (comme Yoshida Kiju qualifiait le cinéma d’Ozu). Mais, par-delà l’intention intellectuelle, le rendu impressionniste n’atteint pas le moindre degré d’émotion et fige les personnages dans une plasticité mécanique, à l’opposé d’un mouvement de vie auquel appellerait le naturalisme du cinéaste.

On peut trouver dans ce récit d’un jeune poète qui vient rendre visite à la famille de sa compagne le même intérêt que pour un K-drama, on peut imaginer que cette confrontation manquée entre un homme de culture et un environnement baigné par la nature puisse produire un choc des concepts et un conflit de rapport au monde. Il y aurait mille films à faire, même avec la plus grande économie de moyens comme la cherche l’auteur. Mais il n’approche ça que depuis sa note d’intention, absente, en rendu, à l’écran.
Enfin, pourquoi donc Hong Sang-soo s’entête à produire des films aussi médiocres, aussi rapidement faits que mal vus dans le monde ? Certainement, par opiniâtreté (on change difficilement un homme de 65 ans – encore que…, leurs auteurs avaient près de 65 ans quand ont été réalisés Fanny et Alexandre, Shutter Island, Impitoyable, Smoking/No Smoking, The Assassin, Kagemusha, etc.).
Et par confort, sachant qu’une petite Internationale Honguienne jalonne le monde. En continuant à aimer ses films, non pas pour ce qu’ils sont, non pas pour ce qu’ils donnent à sentir du réel, mais par principe, par l’application la plus littérale d’une Politique des Auteurs à la logique intellectuelle désormais fanée, les thuriféraires de Hong le laisse continuer à sévir avec la même, paradoxale, prolixité de quantité et paresse de qualité.
Flavien Poncet
Ce que cette nature te dit de Hong Sang-soo. Corée du Sud. 2026. En salles le 29/10/2025





 Suivre
Suivre