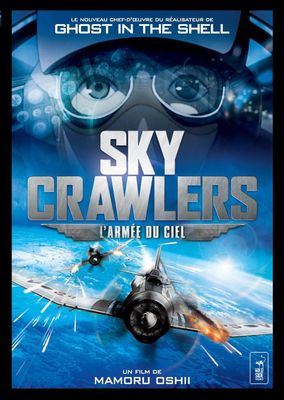La carte blanche de la NFAJ à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé était l’occasion de rediffuser Le Fil blanc de la cascade de Mizoguchi Kenji. Ce film du grand réalisateur que l’on ne présente plus est rarissime : non seulement il est l’un des quelques rescapés de sa période muet (aujourd’hui presque entièrement invisible), mais il est en plus complet. Et comme toujours à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, les séances sont accompagnées musicalement par des artistes. Ici, la séance était accompagnée au piano par Thomas Lavoine.
Une artiste de spectacle ambulant tombe amoureuse d’un jeune étudiant en droit et lui paie ses études, année après année.
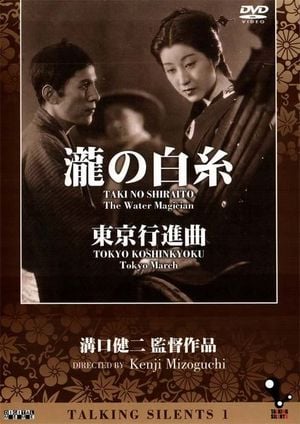
Le Fil blanc de la cascade est le fruit d’une collaboration très étroite avec son actrice principale Irie Takako. Grande star du cinéma japonais des années 30, elle ouvre sa propre boîte de production en 1932 qu’elle nommera à son nom. Ayant collaboré plusieurs fois avec le cinéaste, et Mizoguchi étant connu pour son cinéma très féminin, cette collaboration pourrait sembler toute naturelle rétrospectivement. Mais finalement, l’expérience ne sera pas très concluante entre les deux comparses puisque, peu de temps après ce film, Mizoguchi rompt sa collaboration avec Irie Productions pour retourner sur la voie des grands studios traditionnels. De manière assez paradoxale vis-à-vis de son œuvre, mais plutôt habituelle dans la vie de l’artiste, il dénigrera les capacités d’Irie à être productrice sous prétexte que ce métier ne conviendrait pas à une femme, puis dénigrera son jeu d’actrice. En parallèle, la carrière de l’actrice se dégradera jusqu’à l’affaire L‘Impératrice Yang Kwei-Fei dans les années 50 où le cinéaste refusera sa participation au projet, tandis qu’Irie Takako ne fera plus que quelques films entre cet épisode et sa mort, marquant définitivement la fin de sa carrière. Cette contradiction chez Mizoguchi est peut-être centrale dans l’appréhension de son œuvre ainsi que de sa vie : s’il a dépeint de manière très avant-gardiste des portraits de femmes fortes, indépendantes et qu’il s’est souvent rangé du côté des souffrances féminines liées à la société japonaise, il a aussi imposé sa force, une force masculine assumée, vis-à-vis des femmes de son entourage. On peut ainsi penser à Tanaka Kinuyo qu’il n’a pas voulu aider dans sa carrière de réalisatrice, tout comme on pourrait nuancer ce constat en remarquant que, d’un autre côté, beaucoup de pionnières de l’industrie, dans la question de la représentation féminine dans les différents corps de métier du cinéma, proviennent de son entourage proche, à l’instar des deux premières réalisatrices du pays étant souvent considérées comme Sakane Tazuko, son assistante réalisatrice de longue date, et Tanaka Kinuyo. Loin d’affaiblir la force de son œuvre, même lorsqu’il est question de ses œuvres les plus marquées par la question de la place de la femme dans la société japonaise, cette apparente contradiction vient la nourrir, faisant simplement du cinéma de Mizoguchi non pas un cinéma féministe comme cela est souvent clamé, mais un cinéma se nourrissant du féminin.

Son rapport contradictoire aux femmes s’expliquant en partie parce qu’il est un moyen de nourrir son œuvre, est finalement quelque chose d’assez propre au réalisateur : Mizoguchi est un cinéaste adepte du paradoxe. Ce qui marque premièrement au visionnage du film, est le placement assez libre du métrage vis-à-vis des standards de l’industrie cinématographique japonaise de l’époque. Alors qu’il semble s’inscrire dans l’héritage des productions shinpa (désignant des productions théâtrales puis filmiques des débuts du cinéma japonais généralement mélodramatiques et dont les thématiques sont actuelles et se situent dans un cadre contemporain), Mizoguchi semble y injecter non seulement une visée assez classique, mais aussi une ambition plastique qui est généralement associée à des franges du cinéma bien plus périphériques et presque expérimentales. De plus, son inscription dans une visée proche du shinpa apparaît de fait comme très paradoxale, puisqu’il adapte un livre datant de la fin de Meiji, près de 40 ans avant sa propre production. Ce trouble entre deux industries profondément marquées dans le cinéma japonais (le jidaigeki et le gendaigeki, respectivement les films historiques et les films du présent) n’est pas récent dans son œuvre, ses films historiques ayant, notamment, souvent un écho très fort et volontaire avec son époque, tout en s’amusant formellement (et notamment musicalement) à composer de manière contemporaine le jidaigeki. Mais cette grande force est ici présente de manière tout à fait brillante, où son mélange habile aux propriétés alchimiques apparaît de manière bien plus évidente comme étant la raison du caractère fondamentalement intemporel de son œuvre, et ce, malgré toutes les démarcations historiques du film qui en font, en plus d’un chef-d’œuvre, un document assez fascinant.

Dans Le Fil blanc de la cascade, le cinéaste s’inscrit donc complètement en phase avec son époque : nous suivons Kin, un jeune garçon de campagne gagnant sa vie comme il le peut et rêvant d’étudier en ville le droit, précisément à Tokyo. Il fait la rencontre de l’artiste Tomo, enracinée dans la périphérie japonaise et survivant à l’aide de spectacles itinérants si typiques de l’ère Taisho et populaires en ce temps-là (mais qui dans les années 30, en concurrence directe avec un cinéma de plus en plus attractif, s’affaiblira). L’on pourrait donc presque voir le film comme une sorte de drame évoquant de manière assez troublante la fin de l’ère Taisho à travers Tomo et le début de l’ère Showa (avant la période militaire et donc un peu avant la sortie du film) à travers Kin. Mais à cette couche très réaliste et de son époque – presque naturaliste dans sa manière de faire – Mizoguchi injecte un caractère universel, intemporel et très classique à son œuvre. Car dans le même temps, le film se veut aussi efficace et infernal qu’une tragédie grecque : dans une très brève introduction, le cinéaste met ses pions en place en indiquant, le temps d’une scène, la trajectoire que Tomo et Kin suivront. Lorsque Kin brise le fiacre qu’il conduit à cause de Tomo lui promettant de l’argent s’il va plus vite, puis qu’il l’emmène sur son cheval et l’abandonne sur la route, impossible de ne pas y voir là l’annonce de la grande tragédie qui pèse sur nos deux personnages. Et c’est bien là que se trouve l’une des grandes forces du film, tirée des possibles du paradoxe comme esthétique que le cinéaste affectionne tant : il est à la fois cette peinture du Japon crépusculaire des années 30 (tout comme possiblement de la fin crépusculaire de Taisho et de l’arrivée de la nuit, Showa), mais aussi d’une grande tragédie amoureuse universelle et aux accents de grands récits classiques. On ne sait alors plus si nous sommes face à une chronique contemporaine saupoudrée de tragédie, ou bien une grande tragédie faisant écho à son époque. Il est même possible que ce ne soit ni l’un ni l’autre, plutôt un peu des deux, ce qui ferait de l’entreprise quelque chose d’encore plus impressionnant dans son efficacité. Puisque si Mizoguchi se révèle en tout point fidèle au roman qu’il adapte, son action se situerait alors durant l’ère Meiji.

Non content d’avoir une construction narrative assez brillante, autant dans les thèmes abordés que dans la manière dont ils le sont, la mise en scène de Mizoguchi se veut, elle aussi, libre et contemporaine. Lorsque la caméra reste fixe, le cinéaste se laisse aller à son talent de portraitiste ainsi que de paysagiste. Il injecte aussi au film un grand effet de réel, qui est possiblement dû à la qualité de la copie ne permettant plus de distinguer les réels décors des faux, mais qui est surtout dû à une volonté exprimée à l’image (comme lorsque l’on s’attarde sur les numéros de la troupe assez longuement pour finalement en faire une entité à part entière dans le métrage, à la manière d’une entracte, d’un petit numéro de spectacle assez réjouissant dans la tragédie en cours). Mais le cinéaste se laisse aussi aller à des fulgurances stylistiques et plastiques, de ses gros plans somptueux sur le visage d’Irie Takako à faire pâlir Jean Epstein aux mouvements (ainsi qu’aux placements) de caméra incroyables, notamment lors des séquences de train pendant la fuite de Muto et qui ne sont pas sans rappeler La Roue de Gance. Le Fil blanc de la cascade a tout du grand spectacle cinématographique et réunit en un seul métrage les deux tendances les plus fortes esthétiquement du cinématographe : il est à la fois un grand récit aux accents mythologiques et tragiques, une grande histoire d’amour et de remords et donc un simulacre total, mais conscient qu’il puise dans le réel et se servant de lui par la même occasion afin de construire cette fiction projetée sur toile et de lui donner une toute autre profondeur. Et comme souvent chez Mizoguchi, il ne s’enferme pas hermétiquement dans les grands schémas narratifs pour leur beauté pure, il y apporte un contrepoint quasi-critique et souvent grinçant permettant de redoubler le tragique de la chose. Si la fin présente un sacrifice magnifique de la part de Muto, personnage presque christique dans son don de soi tout au long du récit, elle est aussi un commentaire cynique sur la position de Kin, fraîchement promu procureur grâce à elle et qui sera son bourreau. Le sacrifice de soi pour le bien de l’ordre social deviendra alors très amer, aussi beau le sacrifice soit-il dans la trajectoire purement individuelle de Muto. La reprise finale du double suicide venant boucler la boucle du système Mizoguchi : la tragédie y apparaît comme aussi belle que ces causes et l’ordre social sont détestables.

Si l’état de la copie (du fait de sa conservation miraculeuse) pourrait faire peur au premier abord, l’image étant très abîmée et constamment parsemée de sautes d’images, la grande qualité du film l’emporte puisqu’il agit tout de même comme un puissant chef-d’œuvre. Possiblement que cet aspect chaotique de la copie renforce le film : dans cet état, nous sommes plus que reconnaissant d’avoir au moins accès à ce qui est l’un des plus grands films du cinéaste, tout en nous peinant sur les autres muets de Mizoguchi probablement à jamais perdus. Il faut aussi saluer la qualité des séances de la Fondation Jérome Seydoux-Pathé invitant des musiciens à chaque projection. Ici, le pianiste Thomas Lavoine a remarquablement accompagné le film, notamment lors de son climax durant lequel il utilisera le piano de bien nombreuses manières, toutes plus surprenantes, et donnant une tonalité unique à la prestation, tonalité embrassant totalement Le Fil blanc de la cascade.
Thibaut Das Neves
Le Fil blanc de la cascade de Mizoguchi Kenji. 1933. Projeté à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé dans le cadre de la carte blanche proposée au NFAJ.





 Suivre
Suivre