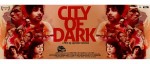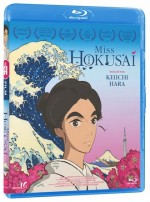Fantasmes de Jang Sun-woo, film sulfureux et ultra censuré, a été finalement restauré en 4k par la Korean Film Archive en 2023. C’est pour nous l’occasion de redécouvrir, près de 25 ans plus tard et grâce à Carlotta Films, l’un des films coréens les plus sulfureux, adapté d’un roman tout aussi scandaleux et qui aura même valu plusieurs mois de prison à son auteur.
Y, lycéenne de dix-huit ans, s’est promis de perdre sa virginité avant d’entrer à l’université. Sa meilleure amie, Ouri, a le béguin pour J, un sculpteur marié de trente-huit ans. Immédiatement séduite par le son de sa voix au téléphone, Y lui propose de se retrouver pour faire l’amour. Une forte attirance naît entre eux dès leurs premiers ébats. Auprès de sa jeune maîtresse aux désirs insatiables, J va laisser libre cours à ses pulsions sadomasochistes…

Le titre original du film, Gojitmal (Mensonges), vaut presque comme note d’intention, comme clé centrale pour appréhender un film aussi mal-aimable au premier abord. Fantasmes se regarde premièrement (et possiblement malgré lui) dans son geste volontairement provocateur comme un film souhaitant repousser les limites de la morale, du représentable au cinéma, le synopsis n’arrangeant rien à l’axe exclusivement provocateur offert au spectateur : relation illicite, immorale, entre un homme âgé et une jeune fille (lycéenne, tout juste majeure) avec, en plus, un focus sur l’aspect sadomasochiste de cette relation. La domination sociale déjà multifactorielle (elle une lycéenne précaire, lui un relativement riche sculpteur ; elle une ado, lui un adulte ; elle une femme, lui un homme…) se redouble alors d’une domination sexuelle tout aussi mal perçue moralement. Et pour conclure en beauté ce cocktail sulfureux, le cinéaste adopte une forme elle-même propice au rejet : sexe cru filmé sur le mode d’un cinéma ultra réaliste à la lisière du cinéma-vérité (au point où les acteurs sont des miroirs déformés de leurs personnages) avec une volonté ostentatoire d’aller titiller le système de censure en place à l’époque, garant politique de la morale coréenne.
Pourtant, dès sa première séquence, Jang Sun-woo semble déjouer de nombreuses craintes (aussi bien que de nombreuses attentes). Si le format cinéma-vérité est effectivement offert au spectateur dès le début, le lieu de subversion, lui, semble dès lors se déplacer. Il débute donc son métrage par une très courte interview de son acteur principal expliquant, face caméra, que le fantasme, par sa force immatérielle, aurait la capacité de guérir. Ce à quoi le réalisateur, ou la personne derrière la caméra, répond en rigolant « c’est parfait ! » introduisant, cette fois-ci, le réel générique du film (et sa musique techno-trot inoubliable). Un double renversement s’opère dès ce premier plan puisque, loin des provocations soixante-huitardes sur l’activité sexuelle prépubère et adolescente, il est tout compte fait question de fantasme pur, de fiction pure, d’irréel total permettant, à terme, de « guérir » dans le réel. L’acteur nous annonce donc quelque chose d’assez lointain de l’expérience dérangeante de cinéma-vérité promise. Il n’y a finalement pas vocation à remettre en cause des normes morales, il y a vocation à remettre en cause des normes formelles. C’est peut-être dans cette optique que dans Fantasmes, pas une seule fois le cinéaste ne cherche à condamner ou bien défendre son couple de protagonistes : il ne filme qu’un fait, l’union étrange d’Y et J. Un fait d’ailleurs égal à l’impossibilité pour cette relation de n’être autre chose qu’un fantasme, puisque le film n’ira jamais dépeindre un véritable couple en eux et opposera de manière quasi systématique leur espace mental (mis en image par l’espace de la chambre et donc celui du fantasme) où leur existence est possible et le réel, où ils ne sont rien d’autre qu’une anomalie vouée à disparaître.

L’autre renversement opéré des attentes, au contraire, est formel et concerne la porosité entre fiction et réel au cinéma. Le mensonge évoqué dans le titre original, c’est celui du cinéma, celui des images cinématographiques. Le dispositif de cinéma-vérité est en fait ici, avant tout et contre l’usage contemporain du réel au cinéma, un dispositif de soulignement du mensonge, de cinéma-mensonger. Quand le cinéaste s’amuse à interroger les acteurs et intégrer ces interrogations au montage, ce n’est pas pour faire des liens évidents entre les acteurs et les personnages qu’ils incarnent, mais plutôt pour imposer une distance entre ce que l’on voit, ce qu’ils représentent et ce qui est. Et le cinéaste ne s’arrête pas là : il va jusqu’à intégrer au montage une séquence du film qui se transformera en une répétition filmée de cette séquence. Ainsi, même le réel du cinéma-vérité est fictionnalisé par le cinéaste. Cette bascule de la séquence à la répétition vient introduire définitivement dans le film que les images ne sont pas fiables, qu’elles sont, en premier lieu et surtout dans un film, la fonction d’un mensonge, celui de la fiction et celui du montage. Finalement, tout ce dispositif imposant du film n’est pas simplement là pour rejouer l’éternel duo réel/fiction qui semble hanter tout un pan du cinéma et de son image. Il est là pour affirmer et marteler que, dans ce duo au cinéma, c’est toujours le mensonge qui gagne, puisque les images ne peuvent qu’attester d’un réel qui a existé au moment où elles ont été prises, et c’est à peu près tout. De la distanciation brechtienne il reprend le trouble, mais en opposition (ou en reflet) à elle, il affirme cette fois-ci la toute-puissance de la fiction et l’illusion totale du réel au cinéma. Dans le trouble, le mensonge est toujours vainqueur.
Ce n’est qu’une fois libéré de ces a priori (immoralité revendiquée et cinéma-vérité du film) qu’il est alors possible de se plonger et de profiter entièrement de ce fantasme filmique lui-même tout aussi trouble et ne semblant n’obéir à aucune règle. Jang Sun-woo utilise le fantasme pour expérimenter, tout comme Y et J l’utilisent pour expérimenter et jouer entre eux. Il va ainsi faire un usage du 35mm tout comme de la caméra vidéo, alternant les deux, leur donnant un sens (dans leur rapport au réel et au sexe) pour le renverser la séquence d’après, puis encore celle d’après… Finalement, même quand il utilise la caméra du réel, le caméscope, il s’en sert surtout pour s’amuser avec le faux, le mettre en scène. Mais c’est dans ses scènes de sexe que la mise en scène du faux (et le ludisme qu’il en tire) sera le plus souligné. Fantasmes, surtout en Europe et aux États-Unis, a cette réputation sulfureuse de mettre en scène du sexe non simulé (légitimant par ailleurs plus facilement l’accusation facile de film porno et tout aussi facilement son érection au rang de subversion intégrale). Pourtant, dans le film, il est montré par trois fois et de manière assez frontale que les actes sont simulés : une première fois lors d’une scène de fellation où l’on voit l’actrice s’occuper d’un faux pénis avec, juste au-dessus, le réel pénis de l’acteur (qui n’est pas en érection). Deux autres fois lors d’une scène de pénétration où les dialogues affirment, insistent et décrivent cette pénétration, où les mouvements des acteurs la soulignent aussi, mais où la caméra prend soin d’intégrer, dans le plan, un endroit où, une fois de plus, est visible le pénis de l’acteur pour que le spectateur puisse constater qu’aucune pénétration n’est filmée. L’image a beau être limpide, ou illusoirement limpide, le réel semble donner raison au cinéaste dans sa défaite face au mensonge et au fantasme (on retrouve encore cette information du sexe non simulé sur les pages Wikipédia des films par exemple). Et de manière tout aussi ludique, on peut voir un point d’opposition dans la première scène de sexe où la caméra filme en très gros plan J en train de mordiller le téton d’Y. Cette fois-ci, l’acte a bien eu lieu. Sexe simulé ou non simulé ? La réponse est trouble dès lors qu’on ne jure pas uniquement par la pénétration, critère uniquement réservé aux censeurs de pornographes. Jang Sun-woo, plutôt que de chercher une expérience radicale et totale du réel, préfère jouer avec ce trouble provoqué par le dispositif cinématographique (en le redoublant d’un aspect documentaire afin de rendre la toute puissance de l’illusion de réel pour la détruire aussitôt au profit de la force esthétique du mensonge et de la fiction).

Ce jeu du réalisateur (qui est tout aussi bien adressé aux spectateurs) se retrouve lui-même au centre de la relation d’Y et J et c’est peut-être là qu’est la réelle provocation ultime de Jang Sun-woo. Alors que tout le film se vend pour ce qu’il a d’immoral et de sale, le cinéaste fait du cœur de cette relation quelque chose de proprement amoral et aucunement sale. La relation sadomasochiste qu’il dépeint entre les deux personnages est à ce titre emblématique de ce qu’il cherche faire et à contre-courant de la représentation du sadomasochisme au cinéma. Loin des relations BDSM du grand écran (comme du petit) qui, au-delà du jeu, cherchent avant tout à rejouer le fantasme du viol (autant le viol des interdits que le viol en soi), ici le BDSM est relégué au rang de jeu dont les règles sont établies, acceptées et scrupuleusement respectées par nos deux personnages. La gradation dans l’intensité des actes n’est pas exploitée dans l’optique d’un ratio appréhension/plaisir, mais uniquement et purement dans la recherche de plaisir et l’exploration du désir de nos deux personnages. Peut-être se niche aussi ici un des autres grands scandales de Fantasmes : Jang Sun-woo ne sacralise jamais le sexe, il en fait quelque chose de totalement et purement banal. Pendant la grande majorité de ces scènes (et principalement dans la première partie du film), nos personnages parlent, rigolent, demandent à l’autre si tout va bien… La mise en scène ne cherche pas à esthétiser l’acte façon porno chic, mais ne cherche pas non plus à le montrer crument et bestial à la manière d’un porno gonzo. Il cherche à le montrer simplement.
Le jeu au centre de leur relation est aussi au centre de la grande complicité (étrangement communicative) d’Y et J. Autre moyen pour le cinéaste de faire de cette relation repoussoir car en apparence purement provocatrice une simple relation narrative, un enjeu, un point d’encrage pour le spectateur dans sa manière d’aborder les images du film. Non seulement cette relation ne semblera plus étrange car, dans l’espace mental de nos personnages et dans le film en lui-même, elle ne pose aucun problème pour Y comme pour J, mais en plus, quand ils sortent de cet espace fantasmatique et que cette relation se percute au réel, le spectateur pourrait se prendre d’empathie pour le couple (puisque lui, n’étant que face aux images, ne vit pas le réel mais n’assiste uniquement à une représentation abîmée de ce dernier). L’ambiguïté du film est donc sa principale force et son moteur esthétique névralgique mais elle est aussi ce qui permet au spectateur de ne pas être trop bouleversé par des questions annexes à la question formelle, si tant est qu’il comprenne et accepte le fragile fil tendu sur lequel se tient le cinéaste constamment, de sa première séquence qui annonce sans annoncer, à sa séquence finale, très puissante, qui y répond sans répondre.

Fantasmes est un film complexe qui ne peut être réduit qu’à son aspect sexuellement déviant et sulfureux. Il est premièrement un jeu, un jeu brechtien sur les limites du cinéma qui épuise les possibles du medium pour en montrer les impossibles. Il est aussi un jeu purement mental, où la principale excitation se révèle rapidement intellectuelle malgré le sujet proprement charnel du film. Il est un jeu sur la toute-puissance aussi salutaire que tragique du mensonge. Il est aussi beaucoup de choses que nous n’avons pas pu aborder : Jang Sun-woo étant un cinéaste très politique, et même s’il propose ici un objet filmique tout à fait mental et fantasmatique, Fantasmes est aussi un film éminemment politique dans son opposition entre l’espace mental de nos personnages et le réel (et comment les deux peuvent parfois communiquer étrangement, notamment par perversion). Réduire Fantasmes au sexe cru et au cinéma extrême, tant il s’en éloigne rapidement et ne le convoque que par touches, serait malheureusement passer à côté de l’ambitieuse entreprise du cinéaste qui propose un film d’une rare profondeur et aux couches de lectures multiples. Un objet fascinant du cinéma coréen de fin de siècle.

BONUS
Antoine Coppola à propos de Fantasmes (15min) : ce court bonus vidéo d’Antoine Coppola, auteur de l’incontournable Le cinéma asiatique et spécialiste du cinéma coréen, nous permet de remettre en contexte Fantasmes. Certes le film est un objet de provocation, objet permis par certaines circonstances de l’industrie cinématographique coréenne (nouvelle censure plus libre, bulle du cinéma provocateur en cette fin des années 1990s), mais Coppola permet aussi de resituer ce geste dans la filmographie de Jang Sun-woo dépassant le simple geste libertaire gratuit. Un document précieux dans l’appréhension d’un film aussi complexe et peu accessible en France.
Thibaut Das Neves
Fantasmes de Jang Sun-woo. Corée du Sud. 1999. Disponible chez Carlotta Films le 01/07/2025.





 Suivre
Suivre