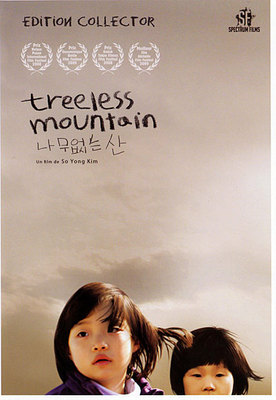L’éditeur Carlotta Films, après avoir proposé de (re)découvrir les plus grands films d’Ozu Yasujiro il y a de cela deux ans, met à la disposition des cinéphiles amoureux du cinéma du maître six de ses longs-métrages, aussi rares qu’invisibles jusqu’à maintenant, et ce dans des copies restaurées. Parmi ces trésors, se trouve Récit d’un propriétaire, chronique sociale douce-amère, aussi tendre qu’émouvante.

Lorsque est évoqué le cinéma d‘Ozu Yasujiro, le thème récurrent de la famille japonaise est l’une des premières choses nous venant à l’esprit, ainsi que le regard à la fois tendre, juste et parfois subtilement critique qu’Ozu peut poser dessus. À travers une filmographie parsemée de chefs-d’œuvre, le cinéaste n’aura eu de cesse de montrer l’évolution du schéma classique de la famille nippone archétypale, avec en fond une autre évolution, celle de la société japonaise, et plus particulièrement celle de l’après-guerre, période charnière de bouleversement social s’il en est. Pour autant, se focaliser sur le thème clé d’Ozu dans sa filmographie, c’est oublier que dans certains de ses longs-métrages, le cinéaste a su se montrer bien plus critique et observateur de la société japonaise qu’il n’y paraît, mais non sans émotion ni tendresse. Et Récit d’un propriétaire en est un magnifique exemple.
Tokyo 1947. Le Japon, affaibli par la Seconde Guerre mondiale, panse ses blessures et est en pleine reconstruction. Si la vie reprend difficilement mais tranquillement son cours, le quotidien de certains habitants est encore précaire. Dans un quartier de Tokyo, un enfant, Kohei, erre dans les rues. Un homme (l’incontournable Ryu Chishu) l’embarque et le dépose sur le pas de la porte de Tane, veuve acariâtre qui apprécie très modérément de devoir servir de foyer d’accueil pour le bambin. Après concertation et tirage au sort avec les autres résidents du quartier, Tane est désignée pour ramener l’enfant chez lui.

À première vue, le film pourrait aisément se présenter comme un drame on ne peut plus classique, avec son lot de misère et de détresse sociale fournies par le sujet. Sur le fond, il est tout de même question ici d’adultes faisant peu de cas de la sensibilité du garçon perdu et qui n’attendent qu’une chose, se débarrasser d’un enfant encombrant. Mais le cinéma d’Ozu, même lorsqu’il aborde des sujets plus graves, n’est jamais misérabiliste ou larmoyant. Le scénario du film a beau prendre pour base le triste sort des enfants laissés pour compte à la sortie de la guerre, et littéralement abandonnés en place publique (le plan final du film est d’ailleurs assez évocateur à ce sujet), Ozu Yasujiro va pourtant en tirer un touchant portrait de femme brisée devenue ignoble par la force des choses, mais qui va se redécouvrir une humanité et des sentiments qu’elle ne pensait plus ressentir.
A posteriori, on pourrait penser que le script va dérouler une histoire qui a été vue et revue au cinéma sous toutes les formes possibles, un récit qui va voir une vieille femme sévère, colérique, misanthrope être obligée de partager sa vie avec un enfant aussi mutique que perdu, visiblement abandonné par son père. À son contact, elle va commencer à baisser sa garde et se prendre d’affection pour le bambin. Et c’est assurément la belle et touchante remise en question de son héroïne qui intéresse Ozu ainsi que la relation quasi filiale qui va se nouer entre la femme et l’enfant. Si le petit est perdu, la femme semble aussi avoir subi quelque chose de fort et triste qui l’a laissée aussi amère que fondamentalement déçue par la vie. Et si les premiers instants de cohabitation sont compliqués et que Tane atteint les limites de l’infect avec Kohei, il va se nouer un lien aussi fragile que sincère entre les deux individus. C’est dans ces petits instants de complicité entre eux ou dans les échanges entre Tane et sa belle-sœur que tout l’humanisme d’Ozu et l’amour pour ses personnages transparaissent le plus. La dureté de Tane s’avère rapidement être feinte, comme lui fait remarquer sans détour son amie, mais c’est le seul moyen de communication qu’elle semble avoir trouvé, après avoir renoncé au bonheur. Une agressivité qui ne trompe personne à part Kohei, et qui explosera en morceau après le coup de sang de trop, parfaitement injustifié. Et dès lors que les barrières commencent à tomber, Ozu va filmer le nouveau quotidien de Tane et Kohei avec douceur et bienveillance, comme deux personnes perdues qui vont développer leur propre manière de communiquer et partager leurs sentiments.
C’est après ces précieux petits moments de vie à deux que le film se montre aussi touchant que bouleversant, lorsqu’à la faveur d’un retournement de situation, Tane va se découvrir une fibre maternelle. Un sentiment qu’elle ne pensait pas pouvoir un jour éprouver, qui plus est pour un enfant qui n’est pas le sien. Si le dénouement de l’affaire est aussi touchant que cruel pour l’héroïne, Ozu filme Tane avec juste ce qu’il faut de pudeur et de sensibilité, au détour d’une scène où les larmes d’un personnage servent autant à exprimer la tristesse de ne pas pouvoir complètement se reconstruire que la joie de voir l’être aimé enfin trouver ce qu’il lui manquait.

Concernant la mise en scène, on a souvent tendance à croire que le cinéma d’Ozu se cantonne à des séquences filmées dans des intérieurs, à hauteur de tatami ou de comptoirs, voire de bureaux. Force est de constater que dans Récit d’un propriétaire, la caméra d’Ozu n’a jamais été aussi mobile et libérée dans l’espace. Qu’elle s’aventure sur une immense plage déserte à la faveur d’une séquence de tentative d’abandon d’enfant aussi tragique que drôle, ou qu’elle suive de près Tane, désemparée, dans un quartier tokyoïte qui n’a jamais paru aussi immense, la solitude de ces personnages n’en est que plus palpable et touchante.
Le film se conclut, pour ses personnages en tout cas, sur une note douce-amère, et le cinéaste se montre lucide sur un des sujets sociaux de l’époque, évoqué plus haut : le sort des enfants dans l’après-guerre. Le dernier dialogue et le plan final sont d’ailleurs sans équivoque : il y a tellement d’enfants livrés à eux-mêmes que n’importe qui souhaitant adopter ou recueillir un enfant perdu n’a qu’à aller en centre-ville. Le Kohei de Tane a juste eu un peu plus de chance que les autres. Mais ce constat amer final n’entachera en rien la puissance émotionnelle et l’infinie tendresse de ce qui a précédé.
Romain Leclercq.
Récit d’un propriétaire d’Ozu Yasujiro. Japon. 1947. Disponible dans le coffret « 6 films rares ou inédits » d’Ozu Yasujiro chez Carlotta Films le 19/03/2024.





 Suivre
Suivre