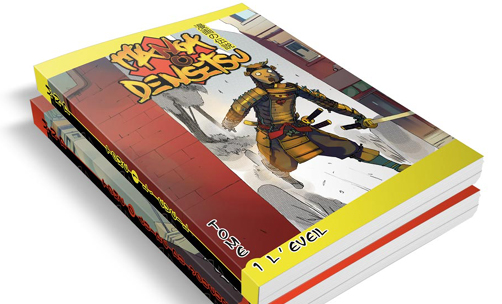Le FICA, Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, s’est lancé ce 6 janvier 2024 au Théâtre Edwige Feuillère, en présence des principaux invités de cette 30ème édition : la réalisatrice taïwanaise Zero Chou (Cyclo d’Or d’honneur), l’un des maîtres du cinéma iranien Mohsen Makhmalbaf, président du Jury international, et les réalisateurs indiens Rajesh S. Jala et Indhu V.S.. Accompagné d’une danse hindie et d’un concerto d’une musicienne taïwanaise, pour célébrer la région indienne du Kerala et Taïwan, mis à l’honneur dans la programmation 2024, s’est ouvert sous les couleurs de la diversité, un des axes moteurs de cet événement unique en France.

Après ce lancement qui, comme à l’accoutumé, mêle la simplicité bon-enfant des organisateurs aux merveilles que les bandes-annonces des nombreux axes de la sélection nous promettent, s’en est suivi un documentaire sur les 30 ans de l’événement, FICA, nos 30 ans, signé par 3 membres du festival : Jean-Claude Boisseaux, Jules Gouillon et le défunt et regretté Marc Haaz. S’y succèdent les nombreux invités prestigieux venus ou ayant incarné le festival (Kore-eda Hirokazu, Pema Tseden, Bastian Meiresonne, etc.) et le rayonnement de celui-ci à l’international, notamment au prestigieux Festival de Busan où la directrice du FICA, Martine Thérouanne, a été récompensée d’un prix honorifique en même temps qu’elle a présidé le jury Kim Jiseok en 2023.
Au-delà de l’auto-congratulation, dont la modestie et l’honnêteté intellectuelle ne verse jamais dans l’orgueil mal placé, ce documentaire permet de remémorer l’importance de l’événement, dont le statut reste factuellement unique. Il est heureux que la France contienne de nombreux festivals dédiés à des cinématographies asiatiques (Kinotayo, Allers-Retours, FFCP, Cinéma(s) d’Iran, etc.). Mais un festival qui embrasse les productions de ce continent (EastAsia reste le bon endroit pour le rappeler : le plus prolifique, en quantité et en qualité, du monde) dans toute leur multitude, tant sur un plan géographique que de registres de films, avec cette longévité et ce niveau de fréquentation, c’est unique en France !


L’entrée, généreuse, ayant eu lieu mercredi 7 février, s’est entamé le festin. Un tour d’horizons en 4 films :
Wednesday, May 9 (Iran, 2015) de Vahid Jalivand

Au sein du cycle hommage aux films primés par le jury NETPAC (le Network for the Promotion of Asian Cinema) lors des précédents FICA, cette 30ème édition re-programme un best of de 10 films. Dans ce cadre était diffusé le premier long du réalisateur iranien Vahid Jalilvand (auteur de Cas de conscience (2017) et de Beyond the Wall (2023), avec Navid Mohmmadzadeh). En étendant l’effet-Rashômon (le récit d’un fait divers à partir de plusieurs points de vue différents) à plusieurs jours, le réalisateur dresse le portrait d’un Iran où la résolution des rapports de classe (notamment par le partage des richesses) semble pouvoir résorber la sclérose du patriarcat.
À travers le sort d’une mère corsetée par le handicap de son mari (interprété par le cinéaste lui-même), d’un jeune couple au mariage interdit et d’un notable soucieux de partager son argent pour se laver de ses fautes, Jalivand invoque les modèles de Ibsen et Gorki pour déployer des problématiques éminemment téhéranaises. Là où le film réussit son coup de force (comme souvent avec les films iraniens, implacables pour la grande majorité), au-delà de l’académisme de son style simili-documentaire, c’est dans l’ampleur que prend très progressivement le récit, faisant finalement se recouper les points de vue des 3 histoires ; dans la faculté du montage et du mixage sonore à alterner silences tragiques et moments de grands fracas et dans l’interprétation des comédiens, notamment l’interprète de Setareh, remarquable d’intensité dans la douleur, Sahar Ahmadpour, et celui de Jalal joué par Amir Aghaee qui donne une leçon d’underplaying exemplaire.
Dounia et la Princesse d’Alep (Syrie / Canada, 2022) de Marya Zarif et André Kadi

Avec ce premier film, sorti en France en février 2023, de deux cinéastes canadiens, autour de la beauté bafouée de la culture syrienne, difficile de ne pas penser à Persepolis (2007) ou, plus récemment, à Parvana (2018). De fait, le ressort est le même, notamment avec le film de Satrapi & Paronnaud : adapté d’un roman graphique, le film conte l’histoire d’une jeune fille dont la construction personnelle et imaginative va se confronter à la destruction de son propre pays, contrainte à l’exil. Le charme inoxydable de ce long d’animation, projeté à Vesoul devant un jeune public et en VOSTFR, tient à ce qu’il égraine des particularités méconnues et passionnantes de la Syrie multi-séculaire. À travers les yeux de la petite Dounia, fille d’un poète et sous la tutelle d’une grand-mère et d’un grand oncle truculents, à mesure que sa famille fuit le pays pour regagner le Canada en passant par la Turquie, se déploient les mythes, légendes et trésors culinaires de ce pays souillé par la guerre. Un must see pour les spectateurs de 6 ans et pour les parents qui veulent les sensibiliser à la condition des enfants heurtés par les conflits internationaux.
Inch’Allah un fils (Jordanie, 2023) de Amjad Al Rasheed

Après sa diffusion à la Semaine de la Critique 2023 et avant sa sortie en salle le 6 mars 2024, ce premier film jordanien a été projeté dans le cadre des avant-premières proposées par le FICA. À travers le portrait de cette mère, propulsée veuve par le décès soudain de son mari, qui souhaite conserver l’intégrité de son indépendance et son appartement, sans tomber sous le joug de ses beaux-frères, Al Rasheed a un message à faire passer. Le film touche juste par la force de son actrice principale, la Palestinienne Mouna Hawa, et par la beauté en demi-teinte de sa photographie. Toutefois le film souffre de l’univocité assez grossière de son propos. Sur une thématique similaire, le premier film de l’Iranien Jalilvand travaille l’architecture de son scénario par une dramaturgie romanesque et insuffle de la nuance aux situations en multipliant les points de vue. Al Rasheed, enamouré – à juste titre – de son interprète principale et par son sujet (l’indépendance des mères de famille monoparentale), oppose clairement deux camps et manque d’ampleur (pour ne pas dire de générosité) dans son regard. D’autant qu’on peut tout à fait être un cinéaste à la forme radicale sans céder aux facilités d’un discours monosémique.
The Spark (Inde, 2023) de Rajesh S. Jala

La compétition « Visages des Cinémas d’Asie » s’est ouverte le soir du 7 février avec ce film indien, première fiction du cinéaste Rajesh S. Jala, auteur de plusieurs documentaires. De cette forme de cinéma, la réalisation conserve le sens de l’observation, la faculté à saisir le réel pour en encapsuler l’esthétique réaliste. Et la première partie qui déploie la réalité des travailleurs du crématorium de Bénarès, la capitale spirituelle de l’Inde, relève de cette écriture documentaire. C’est lorsque le récit se déplace vers le portrait d’un terroriste islamique (dont le cinéaste a été victime en 1990) que le film perd sa beauté expérimentale au profit d’un récit un peu maigre, malgré son réservoir romanesque et formel. Le cinéaste a l’intelligence de ne rien céder au spectaculaire (tant sur le portrait morbide de ces « brûleurs de corps » que sur le chemin de croix du terroriste préparant son attentat) mais il souffre d’un manque de fermeté rythmique. Sans dire qu’il aurait gagné à plusieurs coupes, le montage aurait en tous cas profité d’une élaboration mieux structurée, de façon à ce qu’on ne ressorte pas avec le sentiment qu’il y a deux films en un et dont la rime évidente (résumable par : nous sommes tous des cadavres en sursis) ne semble malheureusement jamais se transformer en expérience sensible.
Flavien Poncet





 Suivre
Suivre