Après sa récente sortie sur grand écran, Kuroneko, un des incunables de la J-horror moderne signé Shindo Kaneto, trouve le chemin des foyers grâce à son édition DVD et coffret Blu-ray par Potemkine Films. Film d’épouvante de 1968, inspiré d’un conte folklorique japonais, Kuroneko (“chat noir” en traduction littérale) offre l’occasion de (re)découvrir, agrémenté de deux bonus, cette incursion dans le surnaturel, quatre ans après Onibaba. Film par Marc L’Helgoualc’h ; Bonus par Flavien Poncet.

Dans un Japon féodal rongé par la guerre, une femme et sa belle fille sont violées et tuées par un groupe de samouraïs. Au moment de leur mort, elles nouent un pacte avec des esprits maléfiques et renaissent sous la forme de deux chats noirs. Leur but : charmer et tuer tous les samouraïs qui se trouvent sur leur chemin. Après plusieurs meurtres de samouraïs, les autorités décident d’enquêter. Mais le samouraï chargé de résoudre l’enquête, Gnitoki, n’est autre que le fils de la femme, et donc le mari de la jeune femme, tuées au début du film. Découvrira-t-il qui se cache réellement derrière les meurtres ? Les chats noirs continueront-ils leur œuvre macabre ou épargneront-ils le jeune samouraï ?
Socialiste
Shindo a déjà réalisé plus de vingt films avant Kuroneko. À part Onibaba en 1964, sa filmographie est très réaliste et s’attache plutôt à décrire la lutte de désœuvrés dans le Japon post-1945 : la misère (et l’espoir) des habitants d’Hiroshima, l’abnégation et le désespoir d’une geisha pour sauver sa famille, des chômeurs qui s’essaient au braquage, des ouvriers en grève ou une prostituée au bord de la folie. À l’instar des films à courant contestataire de la fin des années 1920 (keiko eiga), d’inspiration socialiste, Shindo utilise le cinéma pour dénoncer les injustices et mettre en lumière les vies désespérées et tragiques des petites gens, exploitées par les classes dominantes. Ce courant très bref dont l’exemple le plus marquant est peut-être Le Geste inexpliqué de Sumiko de Suzuki Shigeyoshi (1930) a perduré dans certains films de Mizoguchi Kenji, notamment grâce à ses portraits de femmes comme Les Sœurs de Gion (1937). Dans les années 1950, dans un Japon en pleine reconstruction, Shindo, comme Mizoguchi, met en avant la misère et l’abnégation personnifiées, en grande partie, par des femmes (souvent interprétées par Otawa Nobuko). C’est particulièrement évident dans Epitome en 1953 avec le parcours tragique d’une geisha, et dans Dobu (littéralement « le caniveau ») en 1954 avec sa cohorte d’ouvriers, de chômeurs et de voyous vivant de bric et de broc dans un bidonville. Ce film n’est pas sans rappeler le néo-réalisme italien et cette volonté de montrer sans phare la misère et l’humanité cruelle des banlieues.
Dans Ningen (1962), littéralement “humain” ou “genre humain”, Shindo conceptualise les rapports humains dans un microcosme bien particulier : quatre personnes prises au piège sur un bateau de pêche à la dérive en plein océan pacifique. Dans ce huis clos maritime, les personnages sont soumis aux différents péchés capitaux : orgueil, avarice, jalousie, colère, luxure, gourmandise et paresse. Ningen est un bon prétexte pour questionner des thèmes existentiels déjà abordés dans ses précédents films : peut-on être libre ? Est-on responsable de ses actes ? Peut-on vivre avec autrui ? Ici, les quatre humains « prisonniers » sur un bateau à la dérive sont étudiés comme des animaux en cage. C’est presque une expérimentation scientifique sur le béhaviorisme. Comment peuvent réagir des êtres humains dont le corps est momentanément réduit aux fonctions les plus élémentaires : boire, manger et dormir ?

Avec Onibaba, Shindo fait sa première incursion dans le surnaturel mais garde un canevas social évident : les personnages sont des pauvres réduits au meurtre et au pillage de samouraïs pour survivre. Une misère cachée derrière les roseaux et hautes herbes. Un procédé qu’il réutilisera dans Kuroneko. Dans le livre d’entretiens avec des réalisateurs japonais, Voices from the Japanese Cinema de Joan Mellan publié en 1975, Shindo explique sa volonté de filmer les gens du peuple et non les puissants ou seigneurs de guerre : “Oui, les grands roseaux qui se balancent sont mon symbole du monde, de la société qui entoure les gens. Dans Kuroneko, les buissons sont utilisés dans le même but symbolique. Les roseaux hauts et denses qui se balancent représentent le monde dans lequel vivent ces roturiers et que les yeux des seigneurs et des politiciens n’atteignent pas. Mes yeux, ou plutôt ceux de la caméra, sont fixés pour voir le monde depuis le niveau le plus bas de la société, et non depuis le sommet.”
Il poursuit : “L’idée du chat m’est venue parce que l’histoire originale était basée sur un vieux conte populaire japonais intitulé « La vengeance du chat ». C’était au moins en partie basé sur cette histoire. J’ai aimé l’idée d’utiliser le chat car je pouvais ainsi exprimer la position très basse dans la société qu’occupent certaines personnes en utilisant un animal aussi inutile et aussi bas que le chat.”
Comme Onibaba donc, Kuroneko porte donc un sous-texte social mais atténué par la dimension surnaturelle du film.
Horreur / épouvante
Kuroneko commence par une scène d’effroi : le viol et le meurtre de deux femmes par des samouraïs réduits à l’état de bêtes sauvages. Cette scène introductive, sans parole, est sidérante. Shindo filme en gros plans les visages de ces bêtes sauvages qui se ruent sur la nourriture avant de s’attaquer aux femmes. Ironie du sort : c’est en animal que vont se métamorphoser les deux femmes. Se transformer en animal pour se venger d’humains qui se comportent comme des bêtes. Voilà un bon concept.
L’horreur de la scène initiale fait pourtant place à un certain raffinement. Les chats se métamorphosent à volonté en jeunes femmes pour amadouer les soldats en vadrouille et les charmer avant de les exécuter. Après un long chemin à travers les bambous, les soldats sont emmenés dans une maison illusoire digne des hautes sphères économiques et sociales de la société. C’est grâce à un pacte avec des esprits maléfiques que les deux femmes quittent leur classe laborieuse pour vivre, certes fallacieusement, dans la richesse et l’opulence. Mais ce raffinement n’est que le maquillage des meurtres les plus crapuleux.

La « belle vie » d’assassinats et de vengeance se trouve perturbée quand Gnitoki, un samouraï prometteur, est diligenté pour mettre fin à ces meurtres irrésolus. Le samouraï en question s’avère être le fils et le mari des chats assassins. Lui-même a finalement fait fortune grâce à ses exploits meurtriers pendant la guerre. Mais étant samouraï (et transfuge de classe), il est maintenant considéré comme un ennemi. Kuroneko prend une nouvelle tournure, quasi-psychanalytique : Gnitoki peut-il vraiment tuer sa mère ? Sa mère peut-elle vraiment tuer son fils ? Gnitoki peut-il aimer le spectre de sa femme… qui est, rappelons-le, un chat ?
Humanité, bestialité, vengeance, pardon, libre arbitre : Kuroneko aborde les mêmes thématiques que dans les précédents films de Shindo mais le surnaturel embellit et lisse la cruauté ambiante. Il est d’usage de classer Onibaba et Kuroneko dans la catégorie « film d’horreur ». Horreur est un mot qui sied plutôt aux films réalistes de Shindo. L’horreur humaine. « Épouvante » est un mot qui caractérisait mieux ces deux œuvres.
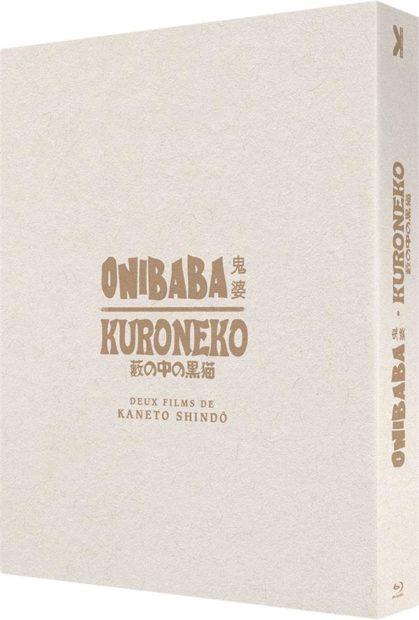
BONUS
Dans le cadre du combo Blu-ray de deux films de Shindo Kaneto, l’éditeur Potemkine agrémente chacune des deux galettes d’une analyse de Stéphane du Mesnildot, spécialiste du cinéma japonais, et d’une présentation plus copieuse du réalisateur ou de l’actrice principale. Pour ce Blu-ray de Kuroneko, Pascal-Alex Vincent présente en détaille la carrière de l’actrice Otowa Nokuko et sa collaboration avec le réalisateur et époux Shindo Kaneto.
Dans son analyse de 7min du film, intitulé « La malédiction des femmes-chat« , du Mesnildot rappelle que le film se situe à l’ère de Heian (entre 795 et 1185 après J.-C.), où le Japon est alors ravagé par les guerres de clan et où, dans cette période de chaos, « la frontière est ténue entre l’homme et l’animal« . Il explique le folklore légendaire du bakeneko, sorte de yokai (esprit spectral) sous forme de chat qui, en léchant le cadavre d’une femme morte, reprend à sa charge l’exécution de sa vengeance. Il décrit la femme-chat comme l’équivalent des vampires (titre sous lequel le film est initialement sorti en France), des loups-garous ou de la Catwoman de Burton. L’analyse se poursuit ensuite principalement par le biais des études de genre, pertinent en l’occurrence au regard du récit et des engagements sociaux du réalisateur.
Dans le deuxième complément, dédié à l’analyse de Otowa Nobuko par Pascal-Alex Vincent, l’actrice est présentée comme importante parce qu’au centre et à la marge. Au centre parce que, d’abord, actrice au studio majeur de la Daiei ; à la marge lorsqu’elle a intégré ensuite la Kindai Eiga Kyokai, société de son mari Shindo Kaneto.
On y apprend, dans cette analyse de 18min, qu’elle s’est faite connaître du grand public dans la revue takarazuka, théâtre musical exclusivement féminin, et que l’un de ses premiers rôle majeurs fût chez Mizoguchi Kenji, dans Miss Oyu, aux côtés de Tanaka Kinuyo avec qui elle collaborera à plusieurs reprises.
Enfin, Pascal-Alex Vincent nous apprend que l’un des éléments représentatifs du goût de l’actrice pour l’indépendance est le moment où elle s’échappe de ses engagements à l’égard de la Daiei pour préférer s’accomplir dans une compagnie indépendante, fondée par celui qu’elle a rencontré alors qu’il était assistant pour Mizoguchi et qui deviendra son époux.
L’analyse copieuse du parcours de la comédienne permet, en complément de ce que Onibaba et Kuroneko nous témoignent, de prendre la mesure de sa place cardinale dans l’Histoire du cinéma japonais moderne.
Kuroneko de Shindo Kaneto. Japon. 1968. Disponible en DVD et coffret Blu-Ray le 05/03/2024 chez Potemkine Films.





 Suivre
Suivre












