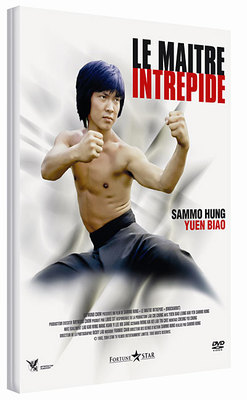Après avoir signé une foule de films dans la série C’est dur d’être un homme, célébrant la légèreté plébéienne d’un citoyen moyen et symbole d’un Japon au bonheur recouvré, Yamada livre pour la Shochiku une œuvre plus intime où se mêlent les contraires. Placée sous le signe de la fable dès les premières notes cuivrées du générique, l’entrée en matière se poursuit par le plan d’un homme en pleurs, inconsolable en apparence après une rupture. Cette figure du raté, évoluant dans le cinéma nippon de la fin des 70s encore marqué par la virilité « nécessaire » des hommes, nous présente, dans toute sa vulnérabilité, l’une des 3 gueules cassées du récit : Kinuya (interprété par Takeda Tetsuya qui joue là son tout premier rôle).
Sur le seuil d’un nouveau départ affectif, il se rend alors sur l’île d’Hokkaido, la péninsule la plus au nord parmi les quatre qui composent l’archipel du Japon. En guise de monture, pour un film qui peut se voir aussi bien comme un « eastern » que comme un road-movie, Kinuya conduit une Mazda Familia première génération ; modèle devenu iconique au Japon après le succès populaire du film, marquant l’inconscient collectif au point où Hamaguchi en invoque explicitement le souvenir dans son Drive My Car. La traversée entreprise par les personnages embrasse la force principale des road movies : faire œuvre documentaire des paysages parcourus, en chargeant ce prélevé d’une doublure romanesque.

Arrivé sur place, le doux-dingue Kinuya rencontre Akemi (Momoi Kaori), timide et frénétique, peu sûre d’elle mais indépendante. En contraste avec ces personnalités libres, s’agrège au binôme Yusaku, figure du père à l’ancienne, tout droit issu du « cinéma de papa », interprété par Takakura Ken. À trois, ils composent un trio d’opposés digne des meilleurs buddy movies, dont la dialectique triangulaire sert de moteur à l’énergie vitaliste et sentimentale du récit. L’allure marmoréenne de Yusaku s’oppose au côté clown du premier et à la part enjouée et ultra dynamique d’Akemi.
Au fil de leur pérégrination, l’intrigue s’ouvre sur une seconde partie, amorcée par quelques éclats de séquences très brèves intercalés dans le montage de la première partie. Yusaku y confie son passé dans la voiture, à travers plusieurs flash-backs, le visage en gros plan nimbé par la lumière dorée du crépuscule, pendant que défile derrière la verdure d’Hokkaido. Dans cet épisode où le ton de l’œuvre bascule dans le mélodrame, les personnages se révèlent, dévoilent leur fêlures passées, métamorphosant le voyage bucolique en une errance tragi-comique de trois solitudes blessées. C’est dans cette dimension-là, où le titre révèle son sens, que Yamada brosse un portrait pétri de nuances et d’humanisme de ses contemporains. Tandis que ses pairs (Oshima par exemple, avec lequel il est rentré en même temps comme auteur-maison à la Shochiku) traînait une vision cynique de l’humanité, Yamada a préféré la montrer avec commisération, sans rien cacher de ses tares ni se refuser au pardon.

Marqué par l’empreinte plastique du Nouvel Hollywood (le grain 16mm, la musique pop folk, les ellipses qui impulsent une vitalité, le côté beatnik des personnages), on retrouve aussi la sueur, les intérieurs décrépis, la ruine en marche qui manquait parfois au réalisme poétique des films tokyoïtes des années 60. La musique jazzy et enlevée (façon Nat King Cole) prête à l’atmosphère un air de balade libre, donnant le sentiment que les errances juvéniles de Yoshida et Suzuki croiseraient celles de Schatzberg et Ashby (avec une pointe poétique et profonde proche de Varda).
Cette liberté formelle se retrouve également dans le fond des sujets. Au détour d’une scène chez le pharmacien sont évoqués ouvertement les préservatifs. Des images érotiques affleurent également sans la semonce cruelle des films d’Imamura, où le désir est toujours une affaire de mort. Une scène de tentative d’agression sexuelle rompt également le charme allègre, à la manière du Nouvel Hollywood, où le vitalisme libertaire bascule rapidement dans son excès moribond. Scène salutaire in fine parce qu’elle extirpe le film du marasme sirupeux et le teinte d’une complexité véritable.
L’étau émotionnel opéré par la fuite en avant du récit est l’œuvre d’un auteur, 46 ans alors, en pleine possession de ses moyens. Le film commence comme une comédie de pieds nickelés et glisse vers la charge dramatique, avec une subtilité d’orfèvre. Tant et si bien que la joie finale ne se goute pas sans une certaine douceur amère. Dans le final, par sa musique, la beauté naturelle évoque même le sommet de quelques John Ford (tendance Qu’elle était verte ma vallée). Et ce n’est pas peu de chose !

Bonus
 Le Blu-Ray n’est accompagné que d’un bonus : la présentation tranquille mais profondément érudite par Claude Leblanc du film et de tous ses contextes (esthétiques, politiques, culturels, économiques). Grand spécialiste de l’auteur et connaisseur véritable du pays du Soleil-Levant, il présente Les Mouchoirs jaunes du bonheur au sein de l’œuvre du stakhanoviste Yamada Yoji et notamment comment ce one shot singulier se situe au cœur de sa série des Tora-san. On y apprend que l’œuvre est inspirée d’une chanson de Chieko Baisho, inspirée elle-même d’une série publiée dans le New York Post.
Le Blu-Ray n’est accompagné que d’un bonus : la présentation tranquille mais profondément érudite par Claude Leblanc du film et de tous ses contextes (esthétiques, politiques, culturels, économiques). Grand spécialiste de l’auteur et connaisseur véritable du pays du Soleil-Levant, il présente Les Mouchoirs jaunes du bonheur au sein de l’œuvre du stakhanoviste Yamada Yoji et notamment comment ce one shot singulier se situe au cœur de sa série des Tora-san. On y apprend que l’œuvre est inspirée d’une chanson de Chieko Baisho, inspirée elle-même d’une série publiée dans le New York Post.
En écoutant Leblanc, on se rend aussi compte que le récit n’est autre que l’histoire d’un Ulysse criminel qui rejoint sa Pénélope, substituant à la tapisserie une ribambelle de mouchoirs jaunes.
D’Abashiri (où se situe une des prisons les plus violentes du pays) à Yubari (une des villes les plus grandes en superficie), l’analyse de Leblanc traverse la topographie du film et du pays, et nous dévoile, par l’analyse, que cette traversée est aussi une ascension vers l’amour et le pardon.
Il souligne la dimension profondément humaniste de l’auteur sur tous ses personnages. Là où d’aucuns (les petits juges de la pureté sociale) auraient condamné d’emblée ce criminel sorti de prison et cet homme au désir mal dégrossi, Yamada les donne à voir avec une humanité forte (c’est-à-dire essentiellement boîteuse). Et ce notamment grâce à la figure d’Akemi qui charge tout autour d’elle d’une joie sans faille.
Leblanc, avec une générosité du partage sans bravade, développe ainsi, dans cet unique bonus, toute le richesse culturelle, historique, sociétale, géographique et économique sous-tendue par Les Mouchoirs jaunes du bonheur.
Flavien Poncet
Les Mouchoirs jaunes du bonheur de Yamada Yoji. Japon. 1977. Disponible en DVD et Blu-Ray chez Carlotta Films le 23/08/2022





 Suivre
Suivre