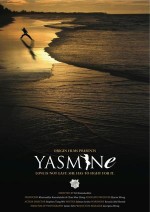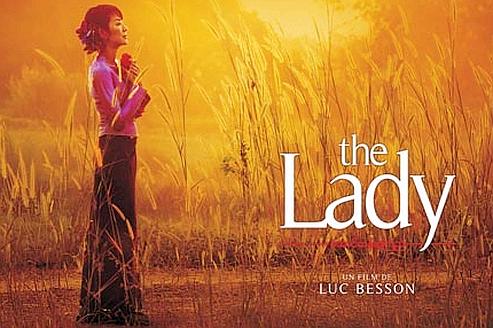Egalement connu sous le pseudonyme de Run, Guillaume Renard est l’une des figures emblématiques des éditions Ankama. En 2003, il intègre le collectif Semper-Fi pour lequel il montre déjà ses talents d’illustrateur et de designer. Il rallie Ankama trois ans plus tard et donne naissance à Mutafukaz, sa première bande-dessinée. Il en lance l’adaptation cinématographique en 2009, fruit de l’association d’Ankama Animation et du Studio 4°C, l’une des plus prestigieuses sociétés d’animation japonaises. En parallèle, il crée le Label 619, toujours au sein d’Ankama, et lance en 2010 la série horrifique DoggyBags. Après plus de huit ans de conception, Mutafukaz est présenté pour la première fois en juin dernier au Festival international du film d’animation d’Annecy, puis en septembre à L’Étrange Festival. Guillaume Renard revient sur sa première expérience de metteur en scène sur Mutafukaz, partagée avec son homologue Nishimi Shôjirô.

Comment adapte-t-on sa propre bande dessinée en un scénario de long-métrage ?
Mutafukaz est constitué de six tomes et d’un volume supplémentaire sous forme de spin-off intitulé «Méta Muta». Cela fait au total 700 pages de bande dessinée. Adapter tout ce contenu en quatre-vingt-dix minutes n’était pas chose facile. Le processus était compliqué et j’ai même failli abandonner à un moment donné. Je pensais qu’il serait judicieux de partir vers une autre idée, un autre univers. Au final, je me suis dit que le défi consistait à rester concentré sur les protagonistes et leurs aventures. Dans la bande dessinée, je pouvais me disperser et traiter d’autres groupes de personnages. En restant focalisé sur mes héros principaux, je pouvais arriver à extraire la substantifique moelle de ma création. En respectant cet angle d’attaque, le travail d’adaptation a été plus serein à aborder. Même moi, je trouvais que la bande dessinée comportait des éléments cryptiques et cela m’a permis de les clarifier. Dans la BD, on a tendance à faire les choses à l’instinct, à l’intuition. Ici, j’ai pu me donner le temps de la réflexion et j’ai abouti à une histoire solide qui fonctionne. Les connaisseurs de la BD constateront de grandes différences. Mais je suis très satisfait d’avoir fait cet exercice sur mon propre univers.
Combien de temps a pris la fabrication du film ?
La matérialisation du film dans son ensemble a duré huit ans. Mutafukaz a été tourné hors-circuit et a été autofinancé par Ankama. Nous n’avons eu aucune aide du CNC. Le chemin a été jonché de nombreuses difficultés. Vu que le projet était déjà avancé, nous avons refusé de reculer, nous voulions aller jusqu’au bout. Mais nous avons eu des périodes positives, d’autres beaucoup moins. Le projet a été momentanément arrêté plusieurs fois. Il y avait des impératifs du côté de l’équipe d’Ankama en France, et d’autres chez les gens du Studio 4°C au Japon. Nous devions également assurer un roulement constant du financement. Entre-temps, Ankama a sorti le film Dofus Le Film : Livre 1 – Judith (2015). La franchise Dofus constitue la vitrine d’Ankama donc ce film était prioritaire par rapport à Mutafukaz. Tout ceci a donc pris beaucoup de temps. De leur côté, les équipes du Studio 4°C ont travaillé pendant quatre ans. Après nous avoir rendu toutes les images, deux années supplémentaires se sont écoulées. J’ai déjà mentionné le chapitre Dofus, mais la post-production a également été très longue. Le scénario a été aussi écrit en japonais et la synchronisation des dialogues a été faite en japonais. J’ai donc dû rédiger une nouvelle adaptation française et la faire correspondre au lip sync japonais. Cela ajoute fatalement du temps supplémentaire. Si j’avais su au préalable que cela allait durer huit ans, je ne me serais probablement pas engagé (rires). Je suis également directeur de collection chez Ankama donc j’étais également pris par d’autres impératifs. Il faut être capable de faire jongler ces deux projets. Mais quand vous exercez un métier-passion, on laisse toujours un peu de soi dans le processus.
Le choix du studio 4°C semble couler de source. Mutafukaz s’apparente à une prolongation logique des univers urbains et colorés de Mind Game et Amer Béton. On y retrouve également l’élasticité des personnages qui caractérise leur style.
Impliquer le Studio 4°C était une évidence mais il y avait également une forme d’impossibilité. Le souhait est très fort même si l’on n’y croit pas totalement. Dès que nous avons commencé à réfléchir au film Mutafukaz, il a été tout de suite fait mention du Studio 4°C. Même avant que le film ne soit en projet, j’ai vu le long-métrage Amer Béton (2007) et le parallèle était évident. De plus, je ne connaissais pas le manga Amer Béton avant que Tot (Anthony Roux), le directeur artistique d’Ankama, ne me le montre. Il y a des accointances évidentes entre les deux univers. Tot m’a donc offert le manga. Bien sûr, l’auteur Matsumoto Taiyô possède un style supérieur au mien. Mais les similitudes sont bien là. A cette époque, Ankama a ouvert Ankama Japan dans le but d’entamer une collaboration entre la France et le Japon. En ouvrant cette nouvelle société, ils ont pu rencontrer des acteurs forts, et pas seulement des créateurs locaux. Ils ont notamment rencontré Moebius. Mais cela leur a surtout permis d’entrer en contact avec Tanaka Eiko, la directrice du Studio 4°C. Tot lui a présenté les différents projets d’Ankama Editions, à savoir Dofus, Wakfu et Mutafukaz. Elle a jeté son dévolu sur Mutafukaz car l’univers lui semblait proche de l’ADN du studio. Ils voulaient débuter la collaboration sur ce projet en particulier. Tot a toujours voulu faire du cross-media donc il a donné son feu vert. Il m’a appelé du Japon le lendemain de mon anniversaire. Il m’a fait le plus beau des cadeaux : nous allions travailler avec le Studio 4°C sur Mutafukaz. Je pensais qu’il plaisantait (rires). Quand il m’a confirmé le sérieux de l’entreprise, j’ai eu une sorte de vertige. Je ne me sentais pas prêt à collaborer avec ces poids lourds de l’animation japonaise. De fil en aiguille, j’ai rencontré les gens du Studio 4°C et je me suis bien entendu avec Nishimi Shôjirô, le co-réalisateur. Au départ, c’est un scénariste japonais qui devait se charger du scénario. Tanaka m’a conseillé de m’en charger moi-même.

Votre co-réalisateur Nishimi Shôjiro a travaillé sur plusieurs classiques de la japanime (Akira, Mind Game, Amer Béton) et sur plusieurs productions pour Warner Animation («Batman», «Tiny Toons», «Superman»). Comment avez-vous organisé votre travail de création et de mise en scène ?
Nous parlions beaucoup de la mise en scène et de la volonté de respecter le scénario et l’univers. Au début, il avait quelques difficultés à saisir la direction dans laquelle nous souhaitions aller. Etant japonais, il était d’autant plus complexe pour lui de saisir cette culture west coast américaine. Par conséquent, notre traductrice a tenu un rôle-clé. Elle ne se contentait pas de transmettre nos paroles. Elle devait accomplir un véritable travail d’adaptation culturelle. C’est une Japonaise qui a grandi en France. Je voulais également que Nishimi comprenne les personnages et qu’il y mette de sa propre sensibilité. Il a apporté de nombreuses idées, des petits éléments drôles et absurdes. Il voulait en rajouter davantage et j’étais très ouvert à ses propositions. Mais la cohérence du projet devait être maintenue. Je souhaitais imposer mes volontés de rupture graphique et il voulait injecter encore plus de composants décalés. J’étais content car, encore une fois, je voulais qu’il s’accapare le projet. Il devait faire vivre les personnages mais je voulais que cela devienne son projet. S’il devait respecter l’univers, je voulais en retour lui laisser toute liberté pour la mise en scène, la narration et les idées qu’il pouvait proposer. Il s’agit de son premier film en tant que réalisateur. Je sais qu’il est en train d’en achever un au Japon. Peut-être que celui-ci sortira d’abord là-bas. Il devrait s’intituler L’Enfant de la mer. Dans la chaîne de production japonaise, tout est extrêmement protocolaire. C’est moins organique et désorganisé que chez les Latins. Tant mieux sans doute. Je me rendais souvent au Japon, où nous subissions des réunions de sept heures. Notre traductrice était mise à rude épreuve. Il fallait tout structurer, déterminer le périmètre d’action de chaque équipe, de chaque personne. Quand je rentrais en France, il fallait passer par des instances de validation. Il fallait inspecter chaque détail, le moindre écriteau dans chaque arrière-plan. Mais en ce qui concernait la direction de l’animation, je m’en remettais totalement à Nishimi. C’est son métier et il est en contact direct avec les équipes. Je ne voulais pas interférer. Pourquoi faire ça ? J’ai affaire au meilleur dans sa spécialité. Je devais faire attention cependant à ce que le « jeu » des personnages ne fasse pas japonais. Par exemple, dans les films d’animation japonais, les personnages ont une façon spécifique de se lever de table, ce genre de choses. Il y avait un langage corporel à éviter. Je lui ai montré de nombreuses vidéos YouTube de gangsters, de cette vie « west coast », toujours pour m’assurer du respect de l’univers et de bien cadrer la cohérence du projet. Ma direction s’orientait surtout sur la psychologie des personnages, sur leur manière d’agir.
Le découpage des séquences d’action est lisible et énergique. Pouvez-vous nous parler de leur élaboration ?
Elles sont issues de la bande dessinée. Nishimi s’est appuyé sur le matériau de base. Etant le directeur technique du projet, il savait comment les matérialiser. Je ne suis pas intervenu sur le découpage. En revanche, j’ai dû faire un briefing sur la façon d’utiliser les armes. Il me posait des questions techniques comme le nombre de coups tirés par minute. J’envoyais des vidéos de démonstration de tir. Il faut savoir que j’avais testé toutes les armes que l’on voit dans le film. Je voulais qu’on ressente le danger, le mécanisme et les impacts. Tout devait être très fonctionnel. J’étais vraiment très exigeant à ce niveau.
Parlez-nous de la formidable direction artistique de Kimura Shinji (Steamboy, Amer Béton).
La direction artistique était cruciale. Si l’ensemble sonnait faux, le film ne fonctionnerait pas. Cela n’a pas été facile également. Vous êtes face à Kimura Shinji, l’un des maîtres dans sa spécialité et vous devez lui dire : «Mais si vous mettez le mur rouge, cela rappelle les Caraïbes. Dans notre esprit, cela fait penser à des paysages paradisiaques et pas au ghetto». Sa vision de Dark Meat City était celle d’un designer. Les paysages désertiques n’ont pas vraiment d’attrait à ses yeux. Cet univers à l’aspect « ciment » n’avait pas de résonance en lui. Il voulait mettre de la couleur et rajouter des nuages comme on le voit dans les films d’animation japonais. Mais on s’éloignait du ghetto. Il y avait cette esthétique de vacances, de carte postale, en tout cas pour moi. Nous avons dû communiquer avec des photos. Nous avons créé un site internet avec de nombreux liens hypertextes, chacun recelant de nombreuses références. A chaque fois que je me rendais à Los Angeles, je photographiais tous les coins désolés, laissés à l’abandon. C’est ça que je voulais montrer. Le film montre des personnes abîmées, laissées pour compte. Il fallait saisir ce déclin urbain. Je lui ai donc soumis ces nombreuses références photographiques et il a compris ce que j’avais en tête. Dead Meat City très large et vide. Ce n’est pas Tokyo. J’ai montré à l’équipe des films comme Boyz N the Hood ou des séries comme The Shield. Ces œuvres montrent le Los Angeles que je voulais recréer. Je leur ai même conseillé de jouer à Grand Theft Auto V (rires).

Angelino pourrait être une nouvelle itération du Monomythe cher à Joseph Campbell, un héros-élu qui doit s’imposer sur le patriarcat, renoncer à son côté obscur et maîtriser ses pouvoirs. On n’est pas loin de Luke Skywalker ou du Neo de Matrix. C’est également un esprit très « shônen ».
Le scénario s’inscrit dans un récit archétypal. Au centre, il y a ce personnage «élu» qui perçoit des choses que les autres ne voient pas. A cause de ça, il devient la cible à abattre. Mais mes références ne s’orientent pas forcément du côté du manga et je ne suis pas vraiment pro-Star Wars. Je puise plutôt mon inspiration dans des films comme Invasion Los Angeles de John Carpenter. C’était ma référence première. Le héros met les lunettes de soleil et la vérité s’impose à lui. Il y a également La tribu des dix plombes, une nouvelle de Stephen King dans lequel le héros s’arrête de fumer et perçoit la véritable forme des dirigeants américains, des créatures ressemblant à des chauves-souris. Il y a cette idée de perception de l’inframonde, des aliens ou autres monstres. Bien sûr, on pense aussi à David Vincent et à l’ambiance paranoïaque des Envahisseurs. En ce qui concerne le patriarcat, Lino doit effectivement choisir entre son père de substitution ou son père biologique. C’est un schéma vraiment balisé. Mais l’univers est tellement « ovniesque » et décalé qu’il fallait obligatoirement se rattacher à une structure classique. Au début, le film devait durer 1h45. Lorsque le film est parti en production, il a fallu le réduire à 90 minutes. Cela m’a vraiment inquiété mais je me suis dit que c’était préférable au final. Le rythme est meilleur et les clés de compréhension sont toutes là.
Vous m’avez précédé en évoquant John Carpenter et Invasion Los Angeles. Mutafukaz présente une Amérique de la surface qui accule ses citoyens, et un monde «souterrain» qui semble tirer les ficelles.
La référence est évidente mais le film ne comporte pas un discours à charge contre les États-Unis. Le public pourrait le prendre ainsi alors que ce n’est pas du tout le cas. J’ai choisi Los Angeles car c’est une ville-monde. Si vous souhaitez représenter l’Occident dans sa globalité, Los Angeles est idéale. C’est une ville multi-ethnique et multiculturelle. Dead Meat City est le miroir déformant d’un Los Angeles fantasmé. Vu que le film montre la manipulation du gouvernement, on pourrait croire à ce discours à charge alors que ce n’est vraiment pas le cas. Je pose ce décor américain car c’est l’une des composantes de ma culture. J’ai grandi avec elle. Les décors américains que je voyais à la télévision me faisaient penser à chez moi. Je pense à des séries comme Dallas ou K-2000. Par exemple, les autoroutes de CHiPs m’étaient familières. Les ovnis constituent la trame de fond de Mutafukaz. Pour moi, les soucoupes volantes évoquent les États-Unis, les révélations de Kenneth Arnold en 1947 ainsi que le folklore des hommes en noir. Pour que Mutafukaz soit plus universel, le récit ne pouvait se passer qu’aux États-Unis.
Vous développez une mythologie spécifique autour des Luchadors, faite de sacerdoce héroïque et de mysticisme. Cela rappelle bien sûr des personnages comme El Santo. Pouvez-vous nous en parler ?
On a l’habitude de dire du catch qu’il s’agit d’un spectacle aux États-Unis, d’un sport au Japon et d’une religion au Mexique. Et c’est tout à fait ça. Au Mexique, la Lucha a une vraie fonction cathartique. C’est assez manichéen. Les combats opposent toujours le bien au mal. Le fond est très biblique, religieux. Je me suis toujours demandé à quoi ressemblerait un super-héros, dans la vraie vie et sans superpouvoir. Je me suis tourné vers les Luchadors. Au Mexique, il y un individu surnommé Superbarrio Gómez, qui fait de la politique dans sa tenue de Luchador ! Il fait le tour des quartiers défavorisés avec son masque et sa cape. Pour la population, c’est un authentique super-héros. Les enfants l’adorent bien sûr. Mais il apporte du réconfort et de la nourriture. Il utilise sa notoriété pour améliorer les politiques sociales de son pays. Il possède son propre parti, qui est très proche de l’extrême gauche locale. Je me suis dit qu’on ne voyait finalement que la surface de ces Luchadors. Le ring constitue la partie émergée de l’iceberg. Mais allez savoir ce qui se passe en coulisses.

Orelsan et Gringe
Pouvez-vous nous parler de la direction d’acteurs d’Orelsan et Gringe. Ils maîtrisent le «street talk» mais évitent soigneusement de forcer le trait. Je trouve que leur connivence renforce davantage les relations entre Lino et Vinz.
Comme vous venez de le dire, il ne fallait pas trop exagérer. Le langage des jeunes évolue et il ne fallait pas que le film sonne faux ou obsolète. D’ici trois ans, ils auront adopté d’autres mots et expressions. Mais j’avais rencontré Orelsan bien avant la sortie de la chanson « Bloqué ». Nous avions déjà fait des tests ensemble. Quand je lisais ses textes, je ressentais déjà qu’il pouvait apporter quelque chose de spécial à la voix d’Angelino. En France, s’il y a quelqu’un qui pouvait le faire, c’était forcément lui. Je ne souhaitais pas travailler avec une personne bénéficiant d’une formation d’acteur. Mais je voulais quelqu’un qui soit capable de retranscrire ce genre d’univers. Durant la longue période qui a couvert la production et la post-production de Mutafukaz, il a cofondé le groupe Casseurs Flowteurs et il a réalisé son film Comment c’est loin dans lequel il partage l’affiche avec Gringe. Et quand j’ai vu ce dont ces deux-là étaient capables ensemble, je me suis dit que cela faisait encore plus de sens. Quand j’ai vu le clip de « Bloqué », je voyais Angelino et Vinz. Je voulais vraiment qu’ils participent à Mutafukaz. Nous avons d’abord fait un assemblage de quelques scènes du film sur lesquelles nous avons plaqué des pistes audio dialoguées de Comment c’est loin. On leur a envoyé ce petit montage. Cela faisait trois fois que je sollicitais Orelsan et le film était sur le point d’être achevé. Ce montage prouvait que le film était terminé et Orelsan est revenu vers nous pour participer à l’aventure, près de 6 ans plus tard. Il nous a toujours dit qu’il participerait au projet s’il aboutissait et il a tenu parole, malgré le parcours incroyable qu’il a réalisé entretemps.
Le film a-t-il une date de sortie ?
Nous n’avons pas de distributeur français, ce qui est assez dramatique. Aucune sortie française n’est donc prévue pour le moment. Le film sort au Japon début 2018, ainsi qu’en Allemagne. Nous préparons actuellement le doublage anglais pour les Etats-Unis et nous devons encore sélectionner notre Angelino.
Propos recueillis par Fabien Mauro.
Remerciements à Estelle Lacaud de L’Étrange Festival.





 Suivre
Suivre