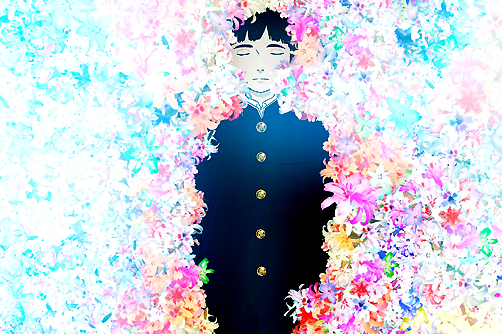En réalisant Le grondement de la montagne, Naruse atteint au milieu des années 50 sa maturité stylistique. Servi par deux grands acteurs de renom, le film est un chef-d’œuvre de finesse et de subtilité cinématographique.
Adaptation du roman éponyme de Kawabata Yasunari publié en 1954, Le grondement de la montagne de Naruse, sorti la même année au Japon, brosse le portrait d’une famille bourgeoise d’après-guerre, résidant dans la ville de Kamakura, au sud de la capitale. Deux parents vivent là avec leur fils et son épouse. La famille comprend également une fille elle-même mariée, qui habite chez les parents de son mari. La quiétude règne dans la première séquence, le film s’ouvre sur de petits détails de la vie quotidienne et expose les rapports qu’entretient la bru avec ses beaux-parents. Le soir, au retour du mari, la situation semble toutefois moins idéale qu’elle n’y paraît. Le jeune couple entretient des relations pour le moins tendues, difficile de trouver chez eux la moindre trace d’amour. On apprend rapidement que le mari voit régulièrement une maîtresse et n’a plus avec sa femme que de froides relations de convenance. La crise familiale atteint son comble une fois que la cadette, qui ne parvient plus à supporter son époux, est de retour parmi les siens.
De ce foyer, deux personnages se détachent particulièrement. La bru d’abord, brillamment incarnée par Hara Setsuko, qui, telle est la coutume dans ce Japon pétri d’anciennes traditions, se doit non seulement de servir son mari mais aussi s’occuper de ses beaux-parents. Le personnage vit essentiellement avec son entourage des rapports d’obligation. Considérée d’une certaine façon comme la servante de la maison, qu’elle a par ailleurs remplacée, la belle-fille se dévoue entièrement au bien-être de tous, ce qui lui vaut de perdre peu à peu toute sa fraîcheur. Comme une fleur qui se fane, le personnage dépérit au fil du film ; et c’est précisément pour cette raison que son mari – comparant son épouse à un lac et sa maîtresse à un torrent – lui préfère une autre femme, plus avenante et énergique.

Par effet de contraste, le personnage du père, interprété par l’illustre Yamamura Sô (acteur de certains films d’Ozu et de Mizoguchi), se définit par un caractère nonchalant et flegmatique. Ne pensant qu’à son beau plaisir, le personnage apprécie la présence et la serviabilité de sa belle-fille sans comprendre que celle-ci a perdu sa joie de vivre. Dans la mesure où il passe son temps à négliger ses obligations paternelles, le personnage peine d’un autre côté à assurer son rôle auprès de ses enfants. Il se contente de donner quelques conseils à son fils à propos de sa maîtresse et se montre distant avec sa fille lorsque celle-ci lui cherche auprès de lui du réconfort.
Bien plus motivé par le bonheur de sa belle-fille que par celui de son enfant, le père part mener l’enquête. Il rencontre par l’intermédiaire de sa secrétaire la maîtresse de son fils et lui demande de rompre avec lui. Les choses cependant se précipitent : physiquement et moralement épuisée, sa belle-fille décide de quitter le foyer et de retourner chez ses parents. Donnant rendez-vous à son beau-père dans la partie française du Jardin Impérial de Shinjuku, à Tôkyô, pour lui annoncer qu’elle désire divorcer, la jeune femme parvient à exprimer pour la toute première fois le fond de ses pensées. Le vieil homme l’invite à réfléchir de nouveau et lui apprend qu’il projette de quitter définitivement sa résidence de Kamakura pour aller vivre avec son épouse dans leur maison de campagne. Son absence, espère-t-il, saura remédier à la crise conjugale.

Clairement, le cheminement narratif du film vise à rétablir l’équilibre relationnel entre les personnages principaux. La relation cordiale du père et de sa belle-fille, dont les affinités peuvent donner à croire qu’il s’agit d’un vrai couple, paraît dès la première séquence des plus ambiguës. La solution pour eux consiste à briser cette ambiguïté : l’homme doit retrouver son rôle de père et la femme son indépendance. Il faut que cette dernière recrée une certaine distance avec son beau-père et que celui-ci rende sa liberté à sa belle-fille. Le personnage masculin, à la fin du film, prend donc une décision qui réconforte son sens des obligations : il sacrifie son petit confort – et la tradition ancestrale – pour le bien de son fils et de son épouse. Dans la même séquence, le personnage féminin, en parvenant enfin à ouvrir son cœur, finit par renouer avec ses propres sentiments. Les personnages atteignent là un point d’harmonie et un nouvel espace s’ouvre devant eux. Tout le cheminement qui conduit jusqu’à cette dernière scène consiste par conséquent à préparer les conditions dans lesquelles cette transformation est possible, au détriment de la résolution même du conflit. On ne sait en effet si la jeune femme finit vraiment par renouer avec son mari. Comme très souvent chez Naruse, le propos psychologique l’emporte sur les considérations dramatiques. Si conflit il y a, celui-ci résulte moins de circonstances extérieures que de préoccupations intimes, d’une lutte vécue au fond de soi.

On comprend que Naruse est un grand cinéaste dans la mesure où il parvient à suggérer, par le seul bais des images et des sons, la douleur ressentie par ses personnages. De film en film, le réalisateur conduit, à l’instar d’un chef d’orchestre, les modulations de cette vie invisible qui, d’un point de vue cinématographique, constitue un matériau difficile à manipuler. En s’accaparant ici l’œuvre de Kawabata, Naruse réussit à traduire en termes filmiques une écriture manifestement littéraire plus enclin à explorer les conflits intérieurs. Certes, le film se montre très bavard et comporte essentiellement des scènes de dialogue, mais le style particulièrement vivant et nourri de Naruse l’éloigne considérablement de ce qui pourrait s’apparenter à du théâtre filmé.
Il faut d’abord remarquer que les dialogues n’expriment pas nécessairement ce que pourraient penser les personnages, ceux-ci semblent bien souvent se livrer à des jeux de dupe. Il leur arrive en effet de mentir ou d’arranger la vérité : la jeune femme ment à son beau-père quant aux raisons précises de son hospitalisation, ce dernier laisserait entendre sans jamais le préciser qu’il a eu une maîtresse dans le passé. Tout porte à croire que chaque personnage se voit doté d’une part de lumière, le visage qu’on offre aux autres, et d’une part d’ombre, tout ce qu’on préfère laisser caché – la double vie du mari, les souffrances de la belle-fille. Ces différentes faces se combinent au gré des relations : le père sait que son fils a une maîtresse, ce dernier sait pourquoi sa femme est allée à l’hôpital, etc. Bien que tout le monde vive sous le même toit, un effort doit être mené pour comprendre les autres. N’est-ce pas, a contrario, parce que tout ce monde vit trop près les uns des autres qu’il leur est parfois nécessaire de porter un masque, de taire certains aspects de soi ?

C’est justement dans cette direction que le film semble s’orienter. La composition des plans manifeste une forte tendance à rapprocher les personnages les uns des autres, à les regrouper dans de mêmes espaces, voire dans de mêmes cadres. Sans cesse tel protagoniste est en présence d’un autre. L’intérieur de la maison évoque une large scène où, tout à la fois acteur et spectateur, chacun est contraint de jouer son rôle et d’obéir aux codes et aux conventions qui s’imposent. Ainsi on voit la mère qui s’interdit d’ouvrir le télégramme qu’elle vient de recevoir et s’empresse de le porter à son mari dans la mesure où, jusqu’à preuve du contraire, c’est à lui qu’incombe cette tâche. C’est aux femmes surtout que revient le respect des convenances, les hommes sont libres de leur côté d’agir à leur guise. Ainsi, le personnage du père, du fait qu’il est le patriarche, semble disposer d’une certaine autonomie, mais passant son temps à négliger ses obligations envers les autres – comme le ferait un enfant dont précisément on le voit affublé d’un masque au cours d’une scène –, ces derniers finissent par en pâtir. Lorsqu’aucun réconfort n’est possible, mieux vaut encore cacher son malheur.

Unis par les liens familiaux, les personnages semblent former une même entité, une cellule composée de différentes facettes. Celle-ci s’avère malade à force de négligence, et le déroulement du film consiste à retrouver le chemin de la guérison. Naruse propose en ce sens un cinéma d’analyse : ses cadres visent tantôt à donner une vue objective des choses – à observer les réactions des personnages regroupés dans un même espace, tantôt à en isoler une partie et à observer ce qui s’y trame. D’où un découpage alternant les plans moyens et les plans rapprochés, voire les gros plans. Ces derniers, pour la plupart, sont raccordés les uns aux autres par l’intermédiaire des regards : tel champ conduit à un contrechamp qui à son tour amorce un nouveau plan, et ainsi de suite. La technique est si souvent employée que les individus paraissent saisis dans un réseau de regards dont la caméra viendrait successivement occuper les points. Ce système permet alors à Naruse, en jouant sur l’échelle des plans, de souligner le sentiment accordé par un personnage à un autre : qu’un contrechamp bascule soudainement dans le gros plan et c’est toute l’attention du personnage regardant qui symboliquement se trouve mobilisée. Le regardé dit ici quelque chose qui intéresse ou émeut profondément celui qui l’observe. Ce type de champ/contrechamp est particulièrement frappant lors de la discussion enflammée entre le père et son fils qui s’achève progressivement sur des plans serrés, tandis que les deux personnages se livrent mutuellement le fond de leurs pensées.
A ces relations basées sur le regard s’ajoute une autre dimension plus vaste, mais aussi plus ténue, de l’ordre du ressenti. Pendant la scène du typhon qui intervient dans la première partie du film, alors que les relations entre le mari et son épouse sont en train de se dégrader, rien ne permet dans un premier temps de raccorder les images du paysage pris dans la tourmente et les plans d’intérieur où les personnages vaquent à leurs occupations – jusqu’à ce qu’un plan de la bru la montre en train d’écouter le déchaînement de la tempête. Ce raccord par l’écoute, relativement vague, semble suggérer l’idée que toute la séquence du typhon renvoie à une représentation de l’espace intérieur du personnage.

Le même procédé est à l’œuvre lorsque le beau-père, au cours de la première séquence, regarde un tournesol pour se comparer à lui – ce qu’il est symboliquement dans la mesure où, n’ayant d’yeux que pour sa belle-fille, il ne cesse de regarder en direction du soleil, cette comparaison étant pour lui une façon de lui faire comprendre qu’il désire son bonheur. Le tournesol cadré en gros plan apparaît clairement comme une projection intérieure du personnage. Une autre image mentale intervient pendant la vive scène de discussion entre le père et le fils : un plan de la bru, se livrant seule aux travaux ménagers, s’intercale entre les gros plans des deux protagonistes comme pour souligner le sentiment de pitié que le père ressent à cet instant précis.
C’est sur cette base, et avec une très grande sensibilité, que Naruse en arrive à sa scène finale, au moment où l’harmonie entre les personnages principaux est atteinte, leur équilibre rétabli. Tandis qu’elle livre le fond de son cœur, la bru est cadrée en gros plan, ce qui suppose que le beau-père assis à côté d’elle la regarde avec une vive attention. Néanmoins, le contrechamp qui suit dément une telle interprétation : l’homme, plongé dans ses réflexions, a d’abord la tête baissée puis lève les yeux vers sa belle-fille. Après un certain laps de temps, son regard finit donc par occuper le champ précédent. Ce plan ému de la jeune femme pourrait être associée à une image mentale, correspondant à ce que le beau-père attendait de cette rencontre ; le regard qu’il porte ensuite sur elle confirme son imagination, son intention vient bel et bien de toucher au but. La bru, rayonnante, est libérée du regard des autres, là voilà de retour dans le réel.

Chez Naruse, où rien n’existe en dehors du ressenti des personnages, les individus, comme les objets qui les entourent, sont cousus d’un même fil qui, maille après maille, finit par dessiner un motif d’ensemble. En tirant du livre de Kawabata la substance de son film, le cinéaste atteint avec Le grondement de la montagne un très haut degré de finesse dans sa conception de l’expression cinématographique. Ce n’est pas un hasard si, l’année suivante, il signe Nuages flottants, souvent considéré comme le chef-d’œuvre de sa carrière.
Nicolas Debarle.
Le grondement de la montagne de Naruse Mikio. Japon. 1954. En salles le 11/01/2017.
A lire sur East Asia : Quand une femme monte l’escalier de Naruse.





 Suivre
Suivre