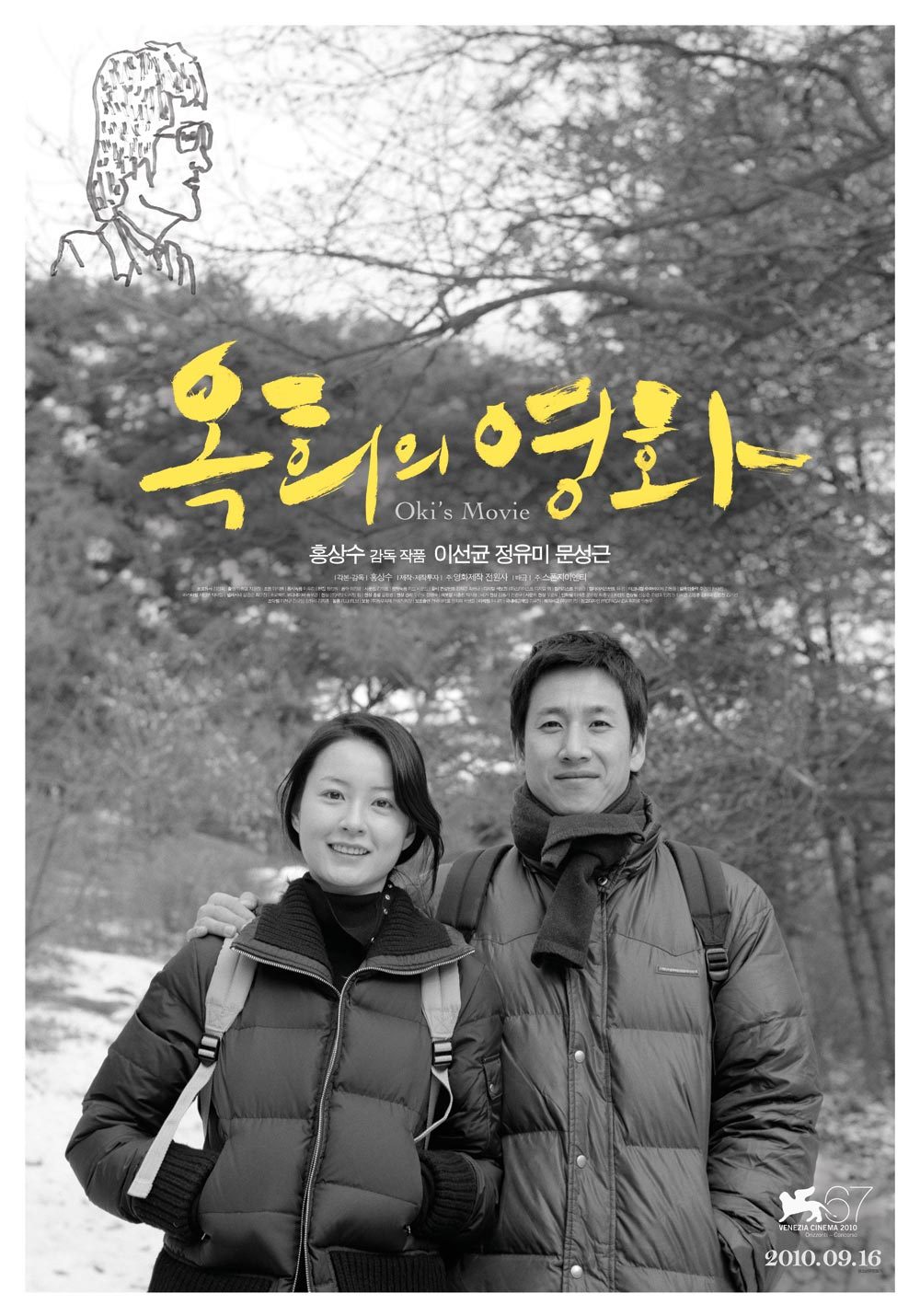Il y a deux ans, nous découvrions, au Festival du Film Coréen à Paris (FFCP), Veteran qui nous exposait, comme une évidence, le génie de Ryoo Seung-wan. Cette année, le festival projetait en avant-première The Battleship Island, l’aboutissement de sa carrière, son manifeste, son œuvre somme et probablement son chef-d’œuvre.
Des Coréens sont emmenés volontairement ou de force sur l’île de Hashima pour travailler dans les mines de charbon qui servent de ressources à l’empire japonais en déclin durant la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous suivons une palette de personnages qui se retrouvent embarqués dans cet enfer. Il y a l’artiste Lee Kang-ok (Hwang Jung-min) et sa fille So-hee (Kim Soo-ahn), le gangster Choi Chil-sung (So Ji-sub), l’agent de la résistance coréenne Park Moo-young (Song Joong-ki) et « la femme de réconfort » Mal-nyeon (Lee Jung-hyun). Tous se retrouvent coincés sur l’île et doivent accomplir des tâches pour survivre, que ce soit la prostitution ou l’exploitation minière. C’est une mécanique huilée au sang de Coréens (et de pauvres Japonais), que le film nous décrit. L’île est un microcosme qui a son propre système hiérarchique et un fonctionnement similaire à celui d’un bidonville voire d’une prison. Ryoo Seung-wan nous permet d’explorer les lieux à travers une exposition brillante qui met en évidence les relations de pouvoir et de domination, les enjeux qui traverseront le film et même les différents niveaux hiérarchiques donc topographiques. Bien sûr, il ne renouvelle pas les genres qu’il investit, que ce soit le film de prison, le film d’espionnage, le film de révolte ou à la fin du film de guerre mais c’est la maestria qui lie ces éléments qui est singulière. On change de genre en changeant de personnage, mais toujours avec une fluidité qui porte le spectateur de l’enfer des mines à la salle de fête japonaise sans que les structures narratives ne gênent l’expérience viscérale qui se dessine petit à petit devant nous.

The Battleship Island oscille entre différentes visions qui s’accordent par la virtuosité technique de son metteur en scène. On pense à Peckinpah, Mel Gibson, Spielberg mais surtout à Sergio Leone et aussi, un peu, à Elem Klimov (et à l’audace esthétique du cinéma soviétique en général). Ryoo Seung-wan combine l’horreur intrinsèque à la situation qu’il a mise en place, à une élégance, une ambition de grande fresque digne de l’âge d’or du cinéma hollywoodien. Le cinémascope inscrit le cinéaste coréen dans la lignée de ces cinéastes qui ont pour objectif de livrer un film-monde, un métrage qui comprendrait un spectre dense de l’humanité, de sa noirceur la plus totale à la possibilité de rêver le futur. Des tableaux macabres impriment la pellicule de Ryoo Seung-wan et le scope nous confronte à l’horreur comme à des visions cauchemardesques sublimées par une photographie démente. Le film regorge d’images marquantes qui s’inspirent autant de l’imagerie de propagande (relatif au placement des corps et de symboles) que de la peinture baroque (pour la colorimétrie et la lumière). Les symboles sont comme des catalyseurs esthétiques qui viennent renforcer l’expérience sensorielle à laquelle nous assistons. On connaît la valeur des images comme celle d’un père protégeant sa fille ou celle d’un couple sous les balles, mais c’est parce qu’il a construit les relations à travers le corps des acteurs que l’on ressent leur épopée comme particulière. Ce n’est pas un film froid ou théorique, et c’est tout de même un film d’esthète.

L’utilisation géniale de la profondeur de champ en atteste, elle nous laisse penser que le cinéaste serait un David Lean coréen qui pourrait contenir le monde dans un plan. On pense aux scènes de bataille qui se déroulent à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans, dans la même image. Mais c’est également une réussite totale de l’équipe technique. La direction artistique du film permet à Ryoo Seung-wan de déplacer sa caméra dans les recoins de l’île comme si nous y étions, c’est cette liberté de mouvement qui rapproche le film du cinéma soviétique. On déambule dans les mines et dans les rues étroites comme si la caméra avait traversé le temps pour nous rapporter ces images. Ainsi, le cinéaste peut se concentrer sur la chair du film, la texture. Il prend soin de filmer les peaux, leur changement d’état, les chairs qui se délitent, les corps mourants des enfants ou des vieillards. Le combat entre le gangster et le chef des Coréens dans les bains est symptomatique de cette démarche. Le cinéma de Ryoo Seung-wan se base sur les corps, et le sens qui peut émaner du choc de ces derniers. Dans Veteran, la puissance capitaliste était représentée par la puissance virile qui émanait du jeu de Yoo Ah-in et de manière plus explicite, celle qui venait des combats pour la survie que menait les personnages dans le bureau de leur patron. On se retrouve tétanisés par le traitement de ces corps dans The Battleship Island, dans un premier temps par leur dépossession au profit de l’empire japonais et dans un second temps par les épreuves qu’ils endurent durant la bataille finale.

Cette relation aux corps n’empêche pas le cinéaste de dépeindre des enjeux métaphysiques. Certes, il suit le parcours d’un blockbuster coréen avec son lot de larmes. Mais la direction d’acteur et le jeu des acteurs va au-delà de ces schémas, les personnages communiquent à travers des regards et des gestes qui disent beaucoup plus sur leur condition, et donc sur la fraternité dans la misère que ne le font les dialogues. On comprend les relations entre les personnages par des expressions simples qui semblent sortir du cinéma d’animation, comme le sourire de Lee Kang-ok à Soo-hee qui nous informe de l’état de leur relation et donc nous indique la tension à venir. Le réalisateur maîtrise les images à différents degrés, et surtout les images qui n’existent pas. Si beaucoup de plans et de mouvements du film sont si impressionnants, c’est parce qu’ils sortent tout droit de l’esprit de Ryoo Seung-wan. Les CGI sont utilisés avec une grande intelligence, et servent beaucoup plus à construire l’île, donc l’atmosphère pour créer une texture au film qu’à faire du spectacle concret (même si, l’ensemble des moyens est indispensable pour la création d’un tel climax). L’apogée de tout ce dispositif aussi bien narratif et surtout formel, se retrouve dans la dernière partie du film.

Le climax du film est un opéra du chaos, une sorte de poème épique grandiose que Ryoo Seung-wan mène d’une main de maître. Nous sommes dans le cœur de la bataille entre les Coréens et les Japonais dont l’intensité fait immédiatement penser aux scènes de guerre du dernier film de Mel Gibson. On embrasse un mouvement lyrique à travers le feu, le sang et l’eau. La musique propulse les images dans une autre dimension, avec la meilleure utilisation de Ecstasy of Gold d’Ennio Morricone depuis son apparition originelle. Ce n’est plus de l’histoire, à ce niveau, c’est de la mythologie. On se retrouve confronté à la volonté humaine dans sa représentation la plus prosaïque et pourtant la plus dense, la survie. Les soldats japonais et les travailleurs coréens se mêlent dans un ballet magistral entre la grandiloquence d’un pamphlet politique et un spectacle de désolation totale. La caméra suit les corps, comme les cris. On se retrouve avec le couple sacrifié qui évoque les tragédies théâtrales, puis avec la destruction d’une famille par le sacrifice de guerre et enfin le salut qui a un goût aussi amer qu’il semblerait être une défaite. On pourrait taxer le cinéaste d’être nationaliste ou d’encourager l’animosité envers le Japon, surtout après avoir découpé le drapeau de l’ancien empire en gros plan. Mais ne réduire le film qu’à un espèce de tract politique serait nier sa puissance humaniste qui devient évidente avec sa conclusion. C’est une leçon de cinéma, une pure expérience populaire. On espère que le film trouvera le chemin de nos salles françaises, là où son ampleur pourra être appréciée. The Battleship Island est un film sur l’échec comme dénominateur commun d’une humanité trouble. Les Coréens n’ont rien gagné, et les Japonais ont tout perdu. Dans le monde des hommes, il existe des forces plus grandes qui négligent même la tristesse des innocents, c’est la tragédie de la guerre. Et c’est ce dont il s’agit lorsque le film reprend le terrible noir et blanc avec lequel il a commencé pour nous mettre face à l’horreur ultime vue par un enfant, celle de la bombe de Nagasaki. Ryoo Seung-wan est donc clairement conscient que son film n’est qu’une expérience cathartique sur un moment de l’Histoire, un puissant zoom sur un moment qui dans ces rouages pourraient expliquer une période. Un témoignage d’un enfer que les Coréens ont vécu au Japon, et que sans le savoir, ils ont ramené chez eux avec pour seul avertissement les larmes d’une jeune fille devant la fin de son monde, devant la fin d’un monde.
Kephren Montoute.
The Battleship Island de Ryoo Seung-wan (2017). Projeté lors de la 12e édition du Festival du Film Coréen à Paris.





 Suivre
Suivre