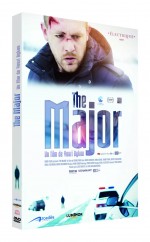Réalisateur phare de Hong Kong, Tsui Hark voit trois de ses films projetés lors de l’hommage que rend Paris Cinéma à sa ville : deux chefs-d’œuvre qui en font le cinéaste du chaos, L’Enfer des armes et The Blade, mais aussi le charmant et moins connu Shanghai Blues, sur lequel nous avons décidé de nous arrêter. Par Justin Kwedi.
Tsui Hark s’était inscrit avec ses trois premiers films Butterfly Murders, Histoire de cannibales et L’Enfer des Armes comme un des chefs de file de la nouvelle vague hongkongaise entre la fin des 70’s et le début des 80’s, souhaitant bouleverser l’ordre établi et révolutionner le cinéma formaté d’alors dans la péninsule. Butterfly Murders était ainsi un wu xia pian déconcertant et anticonformiste, Histoires de cannibales un ovni croisant horreur outrancière et comédie délirante tandis que le rageur Enfer des Armes n’est rien de moins que l’Orange Mécanique hongkongais. Cependant, si les films sont d’incontestables réussites artistiques, ils placent le réalisateur dans une impasse par leur échec public. C’est l’heure de la remise en question pour Tsui Hark qui souhaite tout autant être un cinéaste populaire qu’avant-gardiste et cherchera constamment désormais à équilibrer ses films entre expérimentations et accessibilité grand public. C’est dans cette démarche qu’il crée sa société de production, Film Workshop, qui révolutionnera le cinéma de Hong Kong et mondial pendant plus de dix ans. Shanghai Blues est la première tentative, maladroite mais charmante, de ses nouvelles dispositions et un des films les plus attachants du réalisateur.

Tsui Hark s’imprègne ici d’une veine nostalgie et référentielle avec un récit se déroulant dans le Shanghai de la fin des années 40. Dix ans plus tôt, alors que les bombardements japonais sévissent, deux jeunes gens (Kenny Bee et la belle Sylvia Chang) se réfugient sous un pont et se réconfortent l’un l’autre, tombant amoureux dans ce contexte et se promettent de se retrouver au même endroit à la fin de la guerre. Problème : l’obscurité les a empêchés de distinguer leurs visages et le chaos ambiant les a séparés aussitôt. Le destin va les réunir après le conflit, toujours en attente de retrouvailles lorsqu’ils se retrouveront voisins, ignorant l’identité l’un de l’autre tandis qu’une attachante et délurée jeune provinciale (Sally Yeh) va se placer entre eux pour un délicieux triangle amoureux.
Dès la scène d’ouverture qui lie le couple, c’est un souffle romanesque et romantique flamboyant qui se déploie avec un Tsui Hark multipliant les prouesses lorsqu’on aperçoit les avions japonais survolant la ville terrifiée tandis que notre couple se rapproche dans une frayeur commune. Kenny Bee et Sylvia Chang sont touchant de naïveté, le décor studio bien identifiable, les éclairages rougeoyants et les cadrages les plaçant face à l’immensité de ce Shanghai figent l’instant dans une magie irréelle après laquelle on courra tout le reste du film quand ils se seront retrouvés et reconnus.
Par la suite, le film jonglera entre cette tonalité romantique et un burlesque outrancier et chaotique, mené par un Tsui Hark certainement pas assagi. Le cadre de ce Shanghai en reconstruction lui permet de tisser une ambiance rétro et nostalgique, autant attaché au souvenir d’une époque que profondément influencé par le cinéma hollywoodien. On retrouve donc ici des scènes musicales endiablées et bariolées, typiques des grandes comédies musicales hollywoodiennes bien que toujours imprégnées de culture chinoise dans les chansons typiques de la variété de l’époque, comme cette amusante scène où Kenny Bee et Sally Yeh entament une drôle de chorégraphie sur les toits. Les échanges virevoltants, les multiples quiproquos et courses-poursuites évoquent le meilleur de la screwball comedy grâce à l’abattage de Sally Yeh (qui retrouvera un rôle dans cette veine dans le suivant Peking Opera Blues) tandis que la relation du couple navigue entre registre comique et sentimental.

On est pourtant loin de la simple et jolie enluminure heureusement. Sous la comédie, c’est une population de Shanghai minée par l’après-guerre qui est dépeinte ici. La pauvreté incite à se rabaisser aux métiers les plus divers en attendant des jours meilleurs quand il ne s’agit pas pour les femmes de perdre tout amour propre et de basculer dans la prostitution par nécessité. Tout cela est vu sous un jour léger, mais une réalité bien présente se fait jour à travers les multiples échanges évoquant le manque d’argent (Kenny Bee et son oncle économisant pour quitter Shanghai), l’amitié et l’entraide entre les deux héroïnes ou encore des personnages secondaires comme les loufoques et estropiés vétérans de guerre vivant dans la misère. Tsui Hark n’a pas encore tout à fait trouvé l’équilibre qui fera la perfection de ses œuvres suivantes et le film est parfois un peu trop hystérique, notamment quand il multiplie cette situation typique de la grosse comédie cantonaise où tous les personnages se cachent les uns des autres dans une pièce exiguë.
Néanmoins, le charme opère régulièrement (la belle séquence carte postale où ils parcourent la ville sous la pluie), notamment dans la dernière partie avec l’éblouissante scène où, le temps d’une nouvelle panne de courant, nos amoureux se reconnaissent enfin. James Wong (qui délivrera des splendeurs absolues dans les films suivant de Tsui Hark) délivre un score un peu kitsch mais notamment marquant lorsque se fait entendre au pic de la romance la chanson titre Shanghai Blues.
La conclusion en forme de séparation mais aussi d’éternel recommencement recèle son lot d’émotions contrastées. Et pour ceux qui croyaient Tsui Hark tourné vers le passé avec cette nouvelle direction, il n’y a qu’à se souvenir de la destination du couple dans leur départ précipité : Hong Kong, lieu d’avenir et de tous les possibles. Un bien beau film qui était une sorte de brouillon du chef-d’œuvre à venir, le merveilleux Peking Opera Blues.
Verdict :
Justin Kwedi.
Shanghai Blues de Tsui Hark, à voir à Paris Cinéma le dimanche 01/07 (20h15) et le mercredi 04/07 (22h10) aux 3 Luxembourg.






 Suivre
Suivre