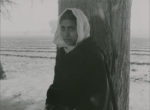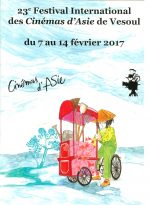Nous avons rencontré Jianjie Lin, auteur d’un remarquable premier film avec Brief History of a Family qui, après sa sélection à Reims Polar, sort en salle en France. Il développe sa très originale approche entre drame et thriller posant un regard social acéré sur la Chine contemporaine.
Le film tient un équilibre intéressant entre réalisme, fable et une certaine tension de thriller. Le scénario a-t-il pour origine des situations vécues, rapportées ou même un fait divers pour tenir cet équilibre dans votre approche ?
Le script a un canevas de récit social mais je ne l’ai pas pensé ainsi. Pour mettre une certaine distance, je l’ai envisagé comme une allégorie. Je me vois comme un auteur mais aussi un spectateur donc je ne l’ai pas pensé non plus comme un thriller classique, la tension vient plus de l’atmosphère et des personnages. C’est l’équilibre que j’ai cherché à installer, par l’ajout d’éléments en postproduction, notamment le mixage sonore.
Tout à fait, le synopsis fait penser à un drame social mais durant le visionnage on a davantage l’impression de regarder un thriller.
Oui c’est un thriller mais sans l’aboutissement dramatique d’un thriller, selon la perspective par laquelle on regarde le film.

Il y a une approche très intéressante pour travailler l’idée d’apparition et de disparition des personnages à l’image et dans le cadre de la famille. C’est d’abord Yan Shuo qui semble une pièce rapportée par la place qu’il occupe à l’image (le travelling où on le découvre attendant Wei devant son vélo) avant d’être progressivement de plus en plus central tandis que Wei disparaît. Comment avez-vous réfléchi à ce dispositif ?
Il y a deux idées en une. C’est à la fois une histoire d’amitié et de rivalité. La rivalité est un jeu de pouvoir où chacun des garçons cherche à prendre la place de l’autre. Ce style de mise en scène où les places des deux se confondent et se substituent à l’image a beaucoup été repensée en postproduction, à travers le montage. C’est une manière aussi de jouer avec l’empathie du spectateur, son envie de voir l’un ou l’autre des garçons présent à l’image et ses attentes quant à la place et le rôle qu’il occupe dans la famille. Cet équilibre dont vous parliez entre drame et thriller permet ainsi de faire basculer cette empathie de l’un à l’autre des garçons.
Il y a une approche ambiguë dans l’attachement des parents à Yan Shuo qui correspond davantage à l’ambition du père, à la sensibilité de la mère, et au passé modeste douloureux de la famille. Avez-vous voulu être universel dans votre approche ou avez-vous voulu parler aussi du sentiment d’une élite chinoise actuelle partagée entre son ambition et ses racines ?
J’ai voulu faire une histoire universelle, mais le récit prend place en Chine et prend donc compte de ce contexte. Au départ, en tant qu’enfant unique je me suis davantage identifié à Wei dont j’ai également vécu la pression sociale. Mais peu à peu mon empathie est également passée aux parents, les regrets de la mère, la volonté du père parti de rien cherchant à perpétuer cette réussite sur son fils.
Pour rebondir sur cet aspect social plus contemporain : il y a aussi une ambiguïté chez les adolescents. Yan Shuo n’accepte de se rapprocher de Wei que quand il comprend son statut social en voyant ses parents. Est-ce que même le statut filial devient une sorte d’entretien d’embauche, et de concurrence permanente où il faut faire ses preuves ? Yan Shuo semble le comprendre alors que Wei s’en rend compte trop tard en étant peu à peu évincé.
Là aussi j’ai voulu exprimer les deux. Wei n’est pas le fils idéal mais recherche malgré tout l’amour de ses parents. Le fait de voir cette affection progressivement « volée » par Shuo rend cette dimension de compétition plus réelle. Je pense que les garçons sont connectés l’un à l’autre.

Yan Shuo est d’ailleurs un personnage assez trouble pour lequel on peut avoir de l’apitoiement tout en le soupçonnant d’intentions plus ambiguës. Comment avez-vous travaillé cela dans la direction de l’acteur (Sun Xilun) et votre mise en scène ?
La chose la plus intéressante pour moi dans le fait de créer un personnage ambigu comme celui-ci est de laisser le public se faire son interprétation. Je ne pense pas qu’il soit complètement calculateur, mais il n’est pas innocent non plus. La performance de Sun Xilun contribue à ce mystère, on ne voit pas souvent ce type de personnage au cinéma.
D’ailleurs comment l’avez-vous dirigé ? Ce jeune acteur dégage vraiment une présence fascinante.
C’est intéressant car ce type d’ambiguïté ne peut pas être joué. Mon job est donc de trouver un acteur dégageant ce type de mystère.
Vous jouez sur le côté solaire et rieur de Wei dont on peut toujours deviner ce qu’il pense, face à la nature taiseuse de Shuo que l’on peut interpréter de différentes façons.
J’ai casté au départ pour Wei un acteur plus âgé mais cela ne fonctionnait pas, avant de trouver ce qui correspondait davantage à l’âge et la personnalité du rôle.
Et qui apparaît comme un adolescent plus « ordinaire ».
Ordinaire mais avec un sens de l’humour particulier !

Les éléments créant la confusion du spectateur quant à la présence/place de l’un ou l’autre des enfants, dans les dialogues et la composition de plans (notamment les scènes de repas) ont davantage été pensés sur le tournage ou en postproduction ?
Les deux, le but de créer cette confusion était de faire s’interroger le spectateur. Finalement, qui est le vrai fils ?
J’ai beaucoup pensé à Théorème de Pasolini, avec ce postulat d’un personnage extérieur servant de révélateur aux maux enfouis d’une famille. Était-ce une de vos influences ?
Quand j’ai fait le film, je n’ai pas pensé à Théorème mais quand je l’ai terminé cela m’est revenu car beaucoup de personnes me l’ont évoqué. Mais la différence est dans la symbolique, dans Théorème l’intrus était une sorte de Jésus alors que dans mon film Shuo est davantage un fantôme.
Quels films vous ont influencé ?
Sans parler d’un film en particulier, je repense à l’époque où j’ai abandonné mes études de biologie pour le cinéma. Des maîtres comme Fellini, Antonioni, Tarkovski m’ont beaucoup marqué. Voir leurs œuvres m’a fait comprendre que je pouvais amener une vision personnelle, cela a élargi mes perspectives.
Entretien réalisé le 31/03/2025 à Paris par Justin Kwedi.
Remerciements à Marie-Lou Duvauchelle.





 Suivre
Suivre