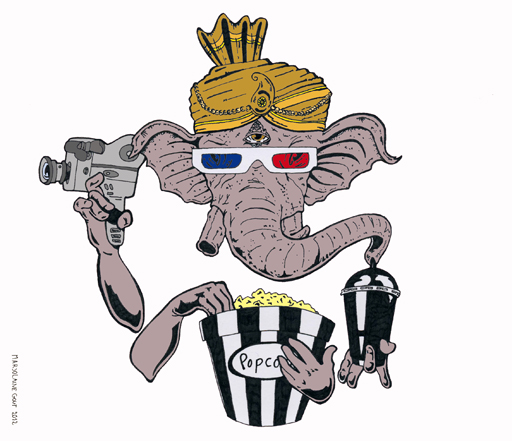En ouverture de sa 18ème édition, le festival Kinotayo a projeté Happyend de Neo Sora, un film d’anticipation dans lequel la surveillance de masse rencontre les errances de l’adolescence et la réalité des discriminations. Un mélange parfaitement équilibré de légèreté et d’appréhension qui mérite qu’on s’y attarde.
Deux amis lycéens fomentent une farce qui précipite l’installation d’une IA de surveillance dans leur établissement. À la faveur de ce changement, les différences de traitement qu’ils connaissent en raison de leurs origines respectives vont devenir de plus en plus saillantes et les interroger sur les adultes qu’ils veulent devenir.
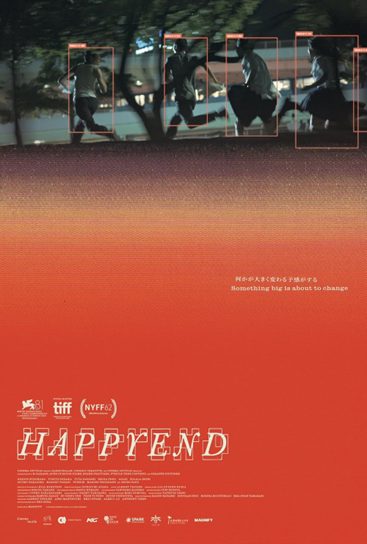
Fils de Sakamoto Ryuichi, Neo Sora avait déjà consacré un long-métrage documentaire à son père, mais s’attelle ici pour la première fois à un projet de fiction d’envergure. C’est l’occasion pour lui de sortir de l’ombre du compositeur révéré pour prouver qu’il est lui-même loin d’être dépourvu de talent. Partant d’une amorce un brin futuriste, il en déploie les pétales avec méthode et délicatesse pour réfléchir aux dérives d’une société bien plus actuelle et universelle qu’il n’est confortable de le penser. Derrière l’inquiétude diffuse, c’est pourtant une véritable tendresse qui irradie de ces jeunes personnages et projette une lueur optimiste.
Le synopsis avait de quoi rendre méfiant. Aussi intrigants que puissent être les spectres de la surveillance de masse et de l’IA, leur menace a déjà nourri nombre de fantasmes créatifs, de l’univers du roman Les Furtifs d’Alain Damasio à l’inévitable série Black Mirror créée par Charlie Brooker, en passant par l’œuvre VR The Eye and I co-signée par Huang Hsin-Chien et Jean-Michel Jarre. Dystopie partout, espoir nulle part, mais surtout : que reste-t-il à dire sur un thème essoré par l’effet de mode ? La crise existentielle qui traverse la société en ce début de millénaire semble avoir été réduite à une pile de concepts ludiques et nihilistes, quelquefois brillants, certes, mais de plus en plus redondants. Alors, qu’y avait-il à espérer d’un premier long-métrage de fiction s’attelant à pareille rengaine ? Vraisemblablement beaucoup plus qu’on ne pouvait le croire.

En premier lieu, Happyend fait le choix d’appliquer cette problématique à une population déjà fortement épiée et sous pression : celle des lycéens, dont on connait les épaules alourdies par les attentes parentales et la compétitivité académique. À ce titre, on pense particulièrement à la série On Children qui déclinait déjà ces thèmes en six cauchemars dans le système éducatif taïwanais. Il faut dire qu’il y a un paradoxe inhérent au contrôle des enfants, car quel jeune parent n’est pas friand d’accéder depuis son smartphone au suivi scolaire détaillé de sa progéniture, tout en se disant ravi et soulagé d’avoir pu y échapper lui-même au profit d’un « mais puisque je te dis que personne n’a eu la moyenne ! ». La question du libre-arbitre et de l’indépendance à laisser à un adolescent précède et dépasse donc très largement celle du pistage et du profilage de la population au sens large.
Cependant, là où le film de Neo Sora va faire preuve d’une subtilité louable en regard d’un On Children qui a tendance à s’engoncer dans des concepts extrêmes et binaires, c’est dans son choix de se placer à l’orée d’aujourd’hui, dans un monde qui n’a pas été transfiguré, où aucun changement fondamental ne s’est encore produit. L’introduction, alors, d’un système de surveillance dans la vie quotidienne des lycéens fonctionne comme une goutte d’eau qui vient former, à la surface de leur existence, des rides aussi discrètes que réalistes. Avec une grande justesse, Happyend dépeint ainsi la manière dont, subrepticement, on s’accommode de cette intrusion inhumaine : on teste ses limites, on rit de ses absurdités, on tente de détourner ses mécanismes, bref, on l’apprivoise. On a beau dénoncer son existence, on apprend malgré soi à s’arranger avec.

Surtout, et c’est là la vraie réussite de l’œuvre, l’anticipation ne sert ici que de révélateur à des écueils actuels et des tensions sous-jacentes. Cette IA qui guette les faits et gestes des jeunes tout en restant désespérément désincarnée est quelque peu semblable à la présence énigmatique et élusive des drones dans Halte de Lav Diaz, dont la vibration sinistre n’est finalement qu’un catalyseur du malaise lié aux menaces climatiques et politiques. Ici aussi, le récit prend racine dans un contexte chamboulé par la promesse d’un séisme particulièrement destructeur qui, en planant comme une épée de Damoclès au-dessus de la société, fait écho à un traumatisme historique bien réel dont les répercussions n’ont pas fini de se distiller : le tremblement de terre du Kantô en 1923 et le massacre des résidents coréens qui s’est ensuivi sous couvert d’accusations de sabotage.
Ainsi, c’est en définitive plutôt la question de la xénophobie qui vient prendre le premier plan de Happyend, en montrant comment les discriminations préexistantes sont amplifiées par des choix politiques qui peuvent paraître anodins, ou du moins secondaires, à des citoyens qui n’ont pas conscience de leurs propres privilèges. Face à un accroissement du contrôle de la population, les premiers à en faire les frais sont ceux que le système ne tolère qu’à contre-cœur, et les immigrés, qu’ils soient de première ou d’énième génération, en font bien évidemment partie. Fragilisés dans leurs protestations par leur statut trop facilement révocable, ils se retrouvent dans une position de faiblesse que seule la solidarité de ceux qui ne sont pas concernés en première ligne peut espérer compenser. C’est là le message fort, et surtout concret, que porte le film.

Pourtant, là encore, Neo Sora parvient à déployer un éventail de nuances qui évite à son œuvre de sembler dichotomique ou démagogue. Ainsi, dans le groupe d’adolescents que nous suivons, il y a un coréen zainichi, mais également un élève d’origine afro-américaine et une métisse nippo-taïwanaise. Habilement, la multiplicité de leurs identités est traitée au cas par cas, ouvrant une foultitude de perspectives sur ce que signifie être immigré. Là où, pour l’un, cela sera principalement vécu sous le sceau du racisme, pour l’autre il s’agit de la promesse d’un ailleurs où on l’attend, et qui peut lui servir d’envol comme d’échappatoire. Pour la dernière, enfin, c’est la sentence d’une identité fractionnée, impossible peut-être à rassembler et à revendiquer. Dans tous les cas, leur trajectoire creuse un sillon profondément sensible et personnel.
En cela, Happyend parvient à transcender son concept science-fictionnel et même la densité politique de ses thèmes pour se raccrocher à l’expérience aussi générale que fondamentale de la fin de l’adolescence, qu’il traite avec une grande douceur. Avant d’être des lycéens sous surveillance, avant d’être des lycéens en proie aux discriminations, ces protagonistes sont avant tout des lycéens, tout simplement. Ils exécutent déjà un numéro d’équilibriste entre l’indolence de l’enfance dont ils égrènent les dernières faveurs et l’imminence des responsabilités adultes qui se fracasseront bientôt contre eux. Tiraillés entre le désir de prolonger cette nonchalance béate et la conscience de plus en plus aiguë de leur devoir d’agir enfin sur le monde, ils incarnent cet âge charnière qui ne peut qu’accentuer les inégalités de leurs destins, quitte à cristalliser un point de rupture.

Pour ne rien gâcher, tout cela est admirablement mis en scène avec un sens non seulement du cadrage mais aussi, doit-on noter, de la géométrie et des couleurs qui donne aux plans un certain sens de l’espièglerie. Faisant honneur à la passion commune de ses personnages, le film est habillé de nappes de musique électronique qui drapent les scènes d’un voile d’onirisme sans jamais être envahissantes, renforçant d’autant plus le sentiment d’universalité de l’ensemble. Tous les acteurs sont justes, le rythme des scènes entraînant, et si la narration semble parfois traîner en longueur au niveau global, on se montrera volontiers indulgent à cet égard, car quel coup de force que de parvenir à conjuguer tout à la fois la pesanteur d’un propos sociétal et la délicatesse d’une approche intime, sans qu’aucun des deux aspects ne semble survolé !
Alors, voilà, dans Happyend, il y a tout : l’anxiété, l’humour, la mélancolie, la tendresse, la gravité, l’indulgence. L’incertitude du présent, les stigmates du passé et l’appréhension de l’avenir. L’exotisme de la science-fiction, la conviction du fond politique et la sincérité du film sur l’adolescence. Neo Sora livre là une excellente copie, montrant qu’il a su se saisir de tous les enjeux que soulève son sujet, et bien mise en page avec ça ! On n’en est peut-être pas à crier au chef-d’œuvre, mais il y a déjà de l’âme dans ce premier long-métrage de fiction, et même si à l’avenir ce cinéaste prometteur connaît la grande réussite qu’on lui souhaite, il n’aura pas à rougir de son coup d’essai.
Lila Gleizes.
Happyend de Neo Sora. Japon, États-Unis. 2024. Projeté lors du Festival Kinotayo 2024.





 Suivre
Suivre