La J-Horror a-t-elle encore des pépites à nous réserver ? Oui, et la question ne se pose même pas : ce mouvement, d’une ampleur aussi grande que ce que sa dénomination recouvre est vague, recèle encore bien des surprises. Copycat Killer, sorti en 2002 en plein pic de la vague, en est un parfait exemple. Totalement fou, très inégal mais toujours surprenant, cet étrange objet que nous avons pu découvrir à la rétrospective « Les maîtres méconnus du cinéma japonais, 16e édition » organisée par la Maison de la Culture du Japon à Paris (MCJP) et consacrée au cinéaste Morita Yoshimitsu s’impose comme un incontournable du genre, complètement barré.
Un serial killer fait surface au Japon. Sa particularité ? Jouer avec les médias et les familles de ses victimes très ouvertement, sans que la police ne puisse rien y faire. Nous suivons le grand-père de Mariko, Yoshio, harcelé par le tueur de cette dernière.

Comme souvent chez Morita, le décalage entre le ton du film et sa forme donne le la. Ici, il est extrêmement criard et joue sur des codes ultracontemporains de l’horreur. Le film, d’une manière tout à fait étrange, est une sorte d’héritier d’Evil Dead Trap d’Ikeda Toshiharu dans sa trame scénaristique, mais aussi, et surtout, de Muzan-e de Yamanouchi Daisuke dans son imagerie. Deux références très particulières, dont l’une directement sortie du cinéma underground japonais et qui fait un peu tâche dans cette production plutôt grosse, où le film d’horreur banal se voit parasité par une imagerie pornographique fétichiste à de nombreux moments. Plus qu’être héritier de tout un pan japonais du cinéma et de la vidéo pour adulte, il est aussi précurseur d’une certaine tournure que la J-Horror prendra, dans son usage de la télévision notamment, avec le superbe La Mort en ligne de Miike, le culte Noroi de Shiraishi, mais aussi, beaucoup plus tardivement, il infuse sur le cinéma de Shimizu. Ce sont énormément de noms qui viennent à l’esprit lors du visionnage, et ce n’est pas pour rien : là se trouve tout le charme de Copycat Killer. Plus qu’héritier et précurseur dans le même temps, Morita arrive à synthétiser tout un pan de l’horreur contemporaine en un seul film. Une synthèse si efficace qu’elle paraît encore aujourd’hui très contemporaine, malgré les effets spéciaux un peu vieillots.

Le lien entre l’image et le récit est l’un des éléments formel les plus intéressants du film : ce qui nous est montré est très souvent incohérent avec ce qui nous est narré. Une première partie du point de vue de Yoshio par exemple, se transformera rapidement en une partie (d’à peu près 1h) où le narrateur devient au final le tueur qu’il traquait. Seul indicatif pour nous signaler ce changement : un simple panneau « 10 ans plus tôt », qui, au fur et à mesure que cette seconde partie continuera, sera lui aussi vecteur d’une perte du spectateur dans la temporalité du film (avec des allers-retours constants entre présent et passé, parfois annoncés, parfois non, et des indicatifs temporels qui laissent petit à petit leur place à des indicatifs spatiaux). Dans cette dichotomie entre l’image et la narration, il ne s’agit ici que de son mode mineur. Le plus étonnant dans le film étant avant toute chose son usage des nouvelles images, celles de la télévision, d’internet ou bien encore du téléphone (à l’époque où celui-ci était encore à clapet !).

Souvent, un personnage se trouve spectateur de ces images, mais l’image, celle du film, ne sera pas (ou ne sera plus) de son point de vue. Le film, tout à coup, bascule dans une sorte de régime d’image proche du found footage dans lequel nous assistons à ce qu’aurait pu voir n’importe quel spectateur et non un spectateur en particulier. En ce sens, le film est précurseur de toute l’horreur analogique internet des années 2010 jusqu’à début 2020. The Mandela Catalogue est par exemple l’expérience la plus proche de ce à quoi nous assistons devant ces images à la lisière du found footage télévisuel (ou bien, plus récemment, Late Night With the Devil largement inspiré par l’horreur analogique). Le tour de force du film étant de ne pas confiner cette forme particulièrement moderne à certaines séquences, mais plutôt à tout le film : ses effets de montages télévisuels et/ou numériques infusent sur tout le métrage, d’une manière très inquiétante, faisant de l’image un bloc monolithique vis-à-vis de la narration (et expliquant peut-être pourquoi la narration, dans sa volonté de créer des images, accumule les incohérences ainsi que les éléments narratifs complètement improbables ou inconcevables). Copycat Killer est fou et audacieux. De son projet de départ, dépeindre la psyché d’un meurtrier, il ne dévie jamais malgré les grands écarts entre images et récit. Sauf qu’à la question qu’il pose, il est évident qu’il n’y apporte pas de réponse. Morita n’a aucune idée de ce qu’est la psyché d’un meurtrier. Ce motif de l’inné et de l’acquis, qui n’est pas totalement inconnu au cinéma du réalisateur (c’est notamment le cas de la tueuse de The Black House), est au centre du film tout comme il est opacifié au maximum pour ne jamais avoir à trancher. Le cinéaste ne cherche pas à dépeindre ce qu’est un meurtrier. Plutôt, à travers son film, il dépeint une recherche de ce que serait un meurtrier « pur », et ce qu’il peut en tirer.

Dans son utilisation de l’imagerie d’internet et télévisée, le film n’est pas avare en critique sur la médiatisation des meurtres : il est évident qu’il y a là une forte critique de la télévision japonaise, tant dans sa neutralité hypocrite que dans son avidité de sang et de drames pour revendre cela aux spectateurs. On le voit aussi avec le personnage de la journaliste qui, faisant des enquêtes sur les rescapés de grands drames criminels, est souvent caractérisée par l’immoralité ainsi que l’ineptie de son travail (et l’on pourrait y voir encore ici une référence à un cinéma horrifique versant dans l’extrême, tel que le Angel Guts: Nami de Tanaka Noboru). La journaliste n’est qu’un rouage, malgré elle et ses bonnes intentions, de ce commerce légal de la mort en images. Le revers de cette folie et de cette audace est bien évidemment sa radicalité : elle laissera sur le carreau bon nombre de spectateurs puisque passé un cap, de par ses longueurs et son hermétisme, le film peut s’avérer repoussant. Surtout dans sa seconde partie très longue qui, faisant des allers-retours sans cesse entre passé et présent et ne semblant aller nulle part, est éprouvante à regarder. L’expérience de spectateur devant Copycat Killer n’est pas forcément agréable : il faut aimer se faire transporter dans un film qui, nous attrapant par les cheveux, nous amène dans divers recoins très sombres sans crier gare.

Copycat Killer est donc un grand film mal-aimable. Bourré de références jusqu’à ras bord, il est aussi une somme de toute une trajectoire de l’horreur contemporaine. Très inégal, il l’est. Dans ses expérimentations formelles complètement dingues comme dans son ancrage dans son époque très marqué (le générique de début et de fin étant deux morceaux de drum n’ bass très kitsch) et à la fois ultracontemporain, il est et sera forcément très clivant. Pour peu qu’on se laisse aller devant le film en ayant en tête, non pas « qu’est-ce qu’il se passe » mais « où va-t-on ? », l’expérience peut devenir alors très marquante. Pour le meilleur, comme pour le pire.
Thibaut Das Neves
Copycat Killer de Morita Yoshimitsu. Japon. 2002. Projeté à la Maison de la Culture du Japon




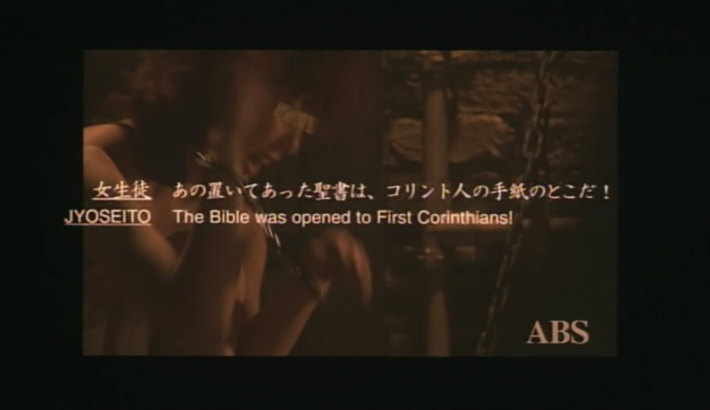
 Suivre
Suivre












