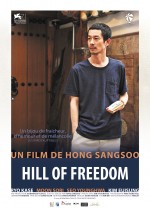En éditant pour la 1ère fois en Blu-ray un film de l’auteur, Carlotta redonne vie à sa collection Oshima, depuis les éditions DVD de 2008. Avec Contes cruels de la jeunesse, c’est un renvoi aux sources, dans une restauration dont la qualité (notamment sonore) n’a d’égale que la crudité de ce qu’elle montre, le tout embaumé dans un parfum d’esclandre que les années n’ont fait qu’amplifier. Retour sur l’un des films les plus scandaleux du Japon des années 60.

Revoir un classique en Blu-ray, c’est souvent faire l’épreuve du temps qui roule sur un souvenir. Permettez l’impudence gonzo : j’avais découvert ce film lors de la rétrospective que l’Institut Lumière de Lyon avait consacré à Oshima en 2010. Dans une copie 35mm marquée par l’empreinte crépusculaire de la photographie, redoublée par le manque de netteté de la captation originelle, la séance m’avait offert une rencontre brutale avec un auteur dont je connaissais la réputation, faite de souffre et de provocations justes. De ces contes cruels, il m’en était resté le souvenir d’un film sale, sciemment mal fagoté, loin des fulgurances plastiques des grands maîtres et plus proche des séditions formelles européennes. Onze ans plus tard, c’est donc en Blu-Ray, à la maison, que je retrouve les jeunes amants crucifiés, Kiyoshi et Makoto.
Ce fleuron de la nouvelle vague nippone frappe par ses premières séquences, baignées dans une lumière nocturne. Sur des découpures de journaux, à travers des ombres trouées et sur fond de free jazz en adagio, s’inscrit le générique en lettres rouge sang. Apparaîtront parmi les premières séquences des images d’archives, celles d’émeutes en Corée du Sud. Dans un geste internationaliste, Oshima révolté met en scène un couple de jeunes japonais mais s’adresse à toutes les jeunesses du monde, au moins celles d’Asie de l’Est. Les personnages sont de purs épigones de la vingtaine, tout à leur juvénilité fiévreuse, décorrélés de leur perspective professionnelle. « Nous n’avons pas de rêve » dit Kiyoshi. Tambour battant, dans leur sillon, le spectateur est propulsé dès le début dans la nuit tokyoïte, scellée dans cet étrange Scope des années 60, celui des « serpents et des enterrements« , qui produit ce sentiment de flottement et laisse les visages et les corps cloîtrés dans le réel.

Autour de cette jeunesse née et éduquée pendant la Seconde Guerre mondiale et d’une vingtaine d’années dans les années 60, pendant que le Japon s’acculture aux goûts et aux mœurs états-uniennes, Oshima élabore le portrait d’une société en plein bouleversement, frappée dans sa chair par une injonction à l’émancipation. C’est de l’évolution abrupte des mœurs, et notamment des rapports entre hommes et femmes, dont le film parle avec le plus d’acuité. De la violence physique des jeunes hommes et du désir libre des femmes, le film ne montre rien de nouveau sous le soleil du cinéma de l’époque (les patrons Kurosawa et Mizoguchi ayant défriché le terrain). Ce qui se dévoile ici, sous la lumière grise d’un soleil noir, ce sont les amours interdites et surtout déraisonnées d’une femme qui fétichise des barbons, la nuit venue, et s’enamoure d’un homme qui la violente. Ce dont le film regorge, c’est la solitude des amants passionnés. Motif cher aux jeunes iconoclastes des années 60 (les Yoshida, Wakamatsu, Masumura), l’isolement surréaliste de l’amour fou se traduit notamment par un mixage son qui, dans une même séquence, laisse entendre les bruits d’ambiance avant de les éteindre pour mieux isoler les dialogues et porter les protagonistes dans une tour d’ivoire. Une mise sous cloche qui ne résonne pas comme une suspension de confort, la musique angoissante rappelant souvent l’atmosphère lourde et troublante qui les enserre.

Autre singularité frappante : la cruauté des rapports. Inclinaison répandue chez les grands auteurs de la décennie, l’amoralisme critique de la société d’alors contraste aujourd’hui avec la morale impérieuse du regard des années 2020. Le jeune Kiyoshi se montre cruel envers Makoto, qu’il sauve d’abord avant de la jeter dans l’eau plus tard, menaçant de ne pas l’aider si elle refuse de ne pas faire tout ce qu’il veut. Notre regard actuel aurait tendance, non sans raison, à condamner son comportement profondément abusif mais ce n’était certainement pas l’intention première d’Oshima qui a poursuivi, de film en film, la représentation des rapports amoureux subversifs. Comme chez Wakamatsu, la critique est ambivalente : en même temps qu’il dénonce, il fascine ; il accuse et sublime dans le même geste. Le regard sur les personnages met en déroute toutes les logiques psychanalytiques et les postures d’indignation, tant l’œuvre est gouvernée par la passion et ses travers. De cela naît l’inconfort éminemment poétique. Cela surpasse la binarité politique à laquelle notre époque le réduirait. L’articulation dialectique des points de vue entre Makoto et Kiyoshi, le fait de camper d’un bord à l’autre permet au récit de gagner en complexité. Ce serait facile, et non sans pertinence, de cercler le film dans une grille de lecture sexiste, de condamner Kiyoshi et de plaindre Makoto. Mais ce serait rater la vision du film à l’époque et, par là-même, cela trahirait son ambition esthétique.

Si le film rejoint les audaces des jeunes auteurs internationaux, il se distingue frontalement de ce que la Nouvelle Vague française peut produire en même temps. Y compris comparé à la façon dont Godard s’attèle à la Guerre d’Algérie (Le Petit soldat) ou aux affres du consumérisme (Deux ou trois choses que je sais d’elle), Oshima ne verse jamais dans l’afféterie intellectuelle. La mise en scène, soucieuse constamment de cultiver son inconfort, ne cède pas aux coquetteries qui pourraient en faire un réservoir à mèmes Instagram. Une des raisons d’être mal aimable, c’est la manière dont le film accuse le hiatus culturel entre le Japon et les États-Unis. Si la France de la Nouvelle Vague est nourrie de culture nord-américaine, celle d’Oshima donne à voir une contradiction brutale avec l’Occident. Tout en écoutant Beethoven ou en buvant du whisky sur fond de free jazz, c’est une nouvelle jeunesse déboussolée, impuissante à savoir manœuvrer les nouvelles mœurs sexuelles venues des États-Unis, le tout en empruntant paradoxalement les codes rythmiques du jazz. Comme le style musical, le montage redouble d’ellipses syncopées, bondissant d’un lieu, d’une situation et d’une vitesse à l’autre.
De ma première vision, j’avais gardé le souvenir de la séquence en bord de mer sur les rondins de bois, de la violence du rapport amoureux entre Makoto et Kiyoshi, de l’image crépusculaire aux couleurs éteintes. De la revoyure en Blu-Ray me sont restées la profonde injustice des rapports entre les deux personnages, la césure entre cultures et générations et la composition musicale du montage. Les boni disponibles restent les mêmes que ceux de la précédente édition DVD : la bande-annonce originale, des extraits du carnets de notes d’Oshima qui ont précédé la création du film et un documentaire panoptique de 25min « Le Japon sous tension » qui pose la cadre et recoupe l’œuvre avec ses échos socio-historiques. Cette nouvelle édition permet, pour la première fois en France, de voir le film dans un master haute-définition 1080/23.98p et, pour le son, dans une version DTS-HD d’après un master audio mono. De quoi repartir à la conquête troublante du continent Oshima.
Flavien Poncet
Contes cruels de la jeunesse d’Oshima Nagisa. Japon. 1960. Disponible en édition DVD/Blu-Ray le 25/08/2021 chez Carlotta Films





 Suivre
Suivre