Obayashi Nobuhiko, figure culte et méconnue du cinéma baroque japonais, est décédé ce 10 avril 2020. Au terme de cette étrange année, nous vous invitons à parcourir les origines insolites de son cinéma. À travers ses premiers courts-métrages, réalisés au seuil des années 60, découvrez une ode extravagante à la jeunesse, à l’innocence et à la résistance contre le temps qui détruit tout.
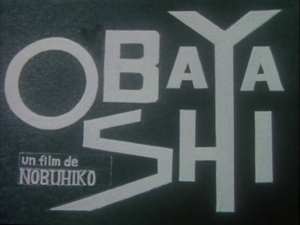

Adulé par tous les amateurs de cinéma bis, underground, expérimental – dont David Lynch -, notamment pour son chef-d’œuvre House (1977), chantre moderne de la jeune japonaise romantique et champêtre, Obayashi Nobuhiko (1938-2020) a été l’auteur d’une poignée de petits films, se faisant la pierre angulaire entre le surréalisme européen des années 30 et le baroque proto-punk nippon des années 60/70.
Figure marginale de la Nouvelle Vague japonaise, il est pourtant à l’origine d’une œuvre composée de près de 60 films, cantonnée presque exclusivement à une diffusion nationale. A contrario de celle de ses pairs des années 60/70 (Masumura Yasuzo, Wakamatsu Koji, Matsumoto Toshio), son œuvre reste encore méconnue en France. Ses films portent toutefois la trace du Japon au sortir de la Seconde Guerre mondiale, imprégnés d’un imaginaire nourri d’influences occidentales.
Tandis que la plupart des jeunes auteurs de la Nouvelle Vague japonaise (Oshima, Imamura, Suzuki) affirmaient des prises de position politiques, Obayashi a toujours défendu son apolitisme. Étranger à tout mouvement et à toutes aspirations au grand soir, son indépendance farouche, hors des chapelles, en fait un artiste éminemment singulier. Ce détachement n’en rend pas moins chacun de ses films porteur d’un regard en creux sur l’Histoire, doublé d’une poésie dont la puissance d’expression tient à l’équilibre fragile des recherches formelles.
Grand admirateur de cinéma muet, dont il aime la dimension à la fois classique et expérimentale, les œuvres d’Obayashi recomposent les fictions avec lesquelles il a grandi, se définissant lui-même, jusqu’au crépuscule de sa vie, comme un « grand enfant ». Et cette candeur, cette douceur ingénue du regard, il la met en pratique se refusant, tout au long de son œuvre, à filmer des choses laides. Y compris dans l’horreur (cf. le final de House), Obayashi orchestre une mise en scène merveilleuse.

Élément déterminant pour saisir son rapport très personnel à la beauté et à la laideur du monde, articulation cardinale chez lui : il est né à Onomichi, à près de 100km de la ville d’Hiroshima. Il avait 7 ans quand la bombe atomique y a été larguée. Cet événement national traumatique compte, de son propre aveu, comme l’un des points saillants de son rapport au réel, à l’évanescence des choses et à l’imaginaire de la mort.
Ses meilleurs courts-métrages
Auteur pléthorique, il a donc réalisé 9 courts-métrages de 1960 à 1966. Les plus importants, ceux qui portent la trace de ce que ses longs développeront de plus fascinant, ce sont Dandanko (1960), Katami (1963), Tabeto (1963) et Émotion (1966).


Dandanko (« petit à petit ») est son premier court. Exercice de style en noir et blanc, tout se déroule dans un parc public, le long d’une descente d’escalier, un enfant joue au ballon tandis qu’une femme déchire une lettre. Muet, comme presque tous ses courts, accompagné d’un piano aux accents romantiques, s’y détachent déjà certains de ses motifs clés : la beauté féminine, les émois sentimentaux, la tendresse de l’enfance, la place de la nature. Et, formellement, une allégresse du montage, des plans courts, une profusion d’axes de caméra fomentent dans l’esprit du spectateur une confusion expresse des visages et des lieux. Au point où la caméra adopte, lors d’un plan, le point de vue d’un ballon dévalant les escaliers, formulant d’emblée la dimension animiste de ses films.


Katami (« souvenir ») est son 4ème court. Variation à partir des motifs de Dandanko, une jeune femme et un petit garçon (cette fois-ci doté d’un avion en papier) se rendent dans un cimetière. En couleur, muet (à l’exception de quelques bruitages postsynchronisés et toujours de ce piano chopinien), se dégagent des gros plans de visage. Notamment de la jeune femme devant une tombe, dans un style qui deviendra presque un effet de signature de l’auteur : cadré serré, la moue pincée, un regard caméra en légère contre plongée, elle toise l’objectif et le spectateur à travers lui. Cette frontalité vigoureuse d’une jeune fille en fleur (mariant les contraires de la délicatesse et de l’effronterie) émerge régulièrement dans le cinéma d’Obayashi. House, encore une fois, en étant l’illustration cristalline.
Les jeux d’atmosphère (fumée opaque noyant l’espace, tombes fleuries dans une ambiance d’automne, filet de sang s’échappant du bord des lèvres) trouvent ici un écrin pour qu’Obayashi compose, à partir de l’imaginaire du vampire, son style et ses obsessions formelles.


Tabeto (« manger ») est un de ses courts les plus sidérants. En noir et blanc muet, il commence presque comme un documentaire sur la gastronomie japonaise à l’ère de l’occidentalisation accélérée du pays. Le récit glisse ensuite progressivement vers la mise en scène cauchemardesque d’une jeune serveuse opérée par le chef cuisinier, du ventre de laquelle sort un visage. La dernière séquence voit sortir de la bouche des convives et des serveuses des ribambelles de tissu blanc qui s’échangent de bouche en bouche avant de finir par envahir tout l’espace. Au-delà de la frénésie folle, c’est l’ambiance de la séquence centrale de l’opération qui foudroie. Elle est, dans l’esprit, très similaire, du dîner de famille dans Eraserhead de Lynch, où l’écart entre l’absurdité morbide à l’image et l’ascétisme sonore des bruits de scalpels / de fourchettes crée une sorte de bulle angoissante. Précisément lorsque le visage qui sort du ventre, tenu ouvert par les ciseaux chirurgicaux, se transforme, au détour d’un raccord, en amas de purée anthropomorphe, puis de plus en plus difforme.


Et enfin, l’acmé de ses courts-métrages, synthèse de toutes les expériences développées dans les 8 qui précèdent : Émotion. En noir et blanc, en couleur, muet et sonore, joyeux et tragique, cadavérique et vivifiant, le film se donne sous plusieurs visages. S’ouvrant sur la vie enjouée d’Emi et de son amie, sous l’apparence d’une relation lesbienne, il évolue vers l’histoire d’amour tragique d’Emi pour un vampire. Sans parole, tout est traduit par la foule de plans à la créativité débordante et, surtout, par l’énergie dynamique du montage. Joyau syncrétique des premiers courts d’Obayashi, par sa façon de condenser et de rabattre l’excédent baroque (auquel la plupart de ses courts ont tendance à céder), s’y dessine en creux le génie rococo et déchaîné de House.
Ses motifs clés
Obayashi a déclaré que comme les vertus médicinales prodiguées par ses parents, il souhaitait que son cinéma puisse panser les plaies de ses contemporains. Et, de fait, la mythologie d’un paradis perdu au fondement de ses films, mis en contraste avec l’imaginaire lugubre des vampires et morts-vivants, témoigne de son aspiration à faire revivre, par l’opération du cinéma, l’innocence d’un temps révolu depuis la Seconde Guerre mondiale. Et, bien sûr, depuis les radiations des bombes atomiques.
Pour donner corps à ce sentiment intime d’être un survivant à la catastrophe, Obayashi fait dialoguer dès ses courts l’innocence ludique de l’enfance ou de l’adolescence, la beauté immaculée des jeunes filles en fleur (dans une apparence souvent virginale) et l’horreur fantastique des vampires et des revenants.


Cette incarnation de l’âge tendre, Obayashi lui donne plusieurs formes. D’abord dans ses génériques : dès Dandanko et jusqu’à Émotion, son nom y est présenté dans une calligraphie récréative, à la croisée du constructivisme soviétique et du situationnisme à venir. Dans une police de caractère anguleuse, évoquant aussi les génériques des premiers films expressionnistes, on décèle le goût récréatif et fantasque du cinéaste. La présence itérative d’un enfant (souvent masculin) et l’adoption récurrente de son point de vue rappellent l’importance de conserver sur le monde un regard d’avant l’âge adulte. Dans son court Onomishi (1963), peinture en mouvement de sa ville natale, il ne laisse percevoir que très peu de présences humaines, parmi lesquelles, justement, un petit garçon.
L’innocence recouvrée prend corps jusque dans certains plans filmés du point de vue des objets : celui d’un ballon dans Dandanko, d’un avion en papier dans Katami, d’une pierre tombale dans Nakasendo. Cette place des objets dans la ronde des personnages traduit également la vision animiste d’Ôbayashi. Souvenez-vous des objets monstrueux de House.
L’enfance chez Obayashi, c’est aussi le rapport au jeu, à la légèreté de vivre : le peintre qui fait du manège avant de retrouver des amis qui font de la balançoire dans The Girl in the Picture (1960), l’enfant qui apparaît à cloche pied dans Dandanko, les jeux surréalistes de marabout-bout-de-ficelle présents dans tous ses courts, les prises de vue réelles animées en stop-motion dans Complexe (1964).
À cette naïveté vive qui contraste avec le drame latent de tous ses courts, s’ajoute la présence quasi-systématique de la jeune femme immaculée. Principale figure de son cinéma, elle témoigne d’une pureté qui résiste et lutte contre les forces obscures de son environnement. Un motif que reprendront, avec moins de féeries, les héritiers d’Obayashi dans les décennies suivantes : Sion Sono et Miike Takeshi.

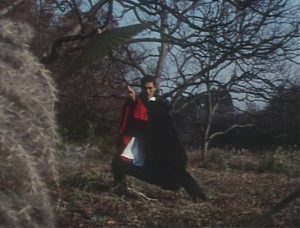
Face à cette lumière, il y oppose les ténèbres des vampires et des revenants. Avec cette subtilité qu’il ne les met pas en scène comme des menaces frontales ou des antagonismes butés, mais plutôt comme les apparitions d’une fatalité mortifère, n’oubliant jamais la maxime coctalienne : « le cinéma, c’est la mort au travail ».
Les influences du vampire, chez Obayashi, de son propre aveu, proviennent naturellement du Dracula de Stoker et du Nosferatu de Murnau (le corps du vampire à la fin d’Émotion en porte la réminiscence). Il s’inspire aussi du Nosferatu de Herzog et, plus étonnamment, d’Et mourir de plaisir de Roger Vadim. Il avoue, cependant, être moins touché par les vampires effrayants, tel que Christopher Lee pour la Hammer.
Comme Jean Rollin, Obayashi aime l’esthétique de « ses très belles femmes en robe blanche », stéréotype du genre qu’il réussit à singulariser en l’important dans le décorum du Japon des années 60. Cette place du vampire n’est pas qu’une lubie fétichiste. Le mariage de la beauté sublime et de l’effroi frontal qu’incarne le suceur-de-sang évoque, pour lui, l’image même de la bombe atomique : de trouvailles scientifiques fascinantes a priori (comme le vampire peut l’être), il en a résulté un engin de mort effroyable. Enfant, il croyait justement que la guerre et les vampires étaient liés.
En faisant camper dans des décors, souvent gorgés par la nature, des figures innocentes (le petit garçon, la jeune femme virginale) et des figures effrayantes (des vampires, des esprits de cimetière), tout cela dans une réalisation vibrionnante, fébrile, orchestrée à tombeau ouvert, Obayashi projette sur l’écran ses rêves et ses cauchemars. Ceux d’un Japon fantasmé d’avant la catastrophe d’Hiroshima et ceux d’une fraîcheur de vivre désormais entachée par l’Histoire et le temps qui passe. Compositeur de rêves, Obayashi l’a été, d’ailleurs, au point où il a réalisé le making-of de Rêves de Kurosawa.
De cette dialectique des contraires, entre la beauté chaste et la rapacité corruptible, pris dans un tourbillon souvent vertigineux et inspirant, les films d’Obayashi laissent toujours une trace bénéfique : dès ses premiers courts-métrages, celle d’un cinéma indépendant, singulier et libre.
Flavien Poncet.





 Suivre
Suivre












