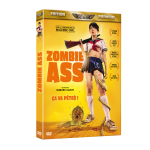Hollywood semble se tourner vers le Japon, espérant trouver dans la richesse de ses mangas et autres animes matières à exploiter de nouvelles franchises plus lucratives. Si en France nous avons pris un peu d’avance dans le domaine, avec pour précurseur Jacques Demy et son adaptation de Lady Oscar et plus récemment le Nicky Larson de Philippe Lacheau, aucun de ces films n’avaient suscité autant d’émois que l’annonce d’un Gunnm, intitulé Alita: Battle Angel, scénarisé par James Cameron et réalisé par Robert Rodriguez, tant cela semblait évident sur le papier. Les dieux du cinéma en ont, semble-t-il, décidé autrement. Que reste t-il de ce fantasme cinéphile ?

C’est avec une certaine fébrilité que nous attendions cette arlésienne du cinéma, une adaptation live d’un des parangons du cyber punk japonais. Gunnm ou Alita: Battle Angel chez nos voisins d’Outre Atlantique, avait séduit le papa du Terminator et ce dernier nous faisait miroiter depuis lors une œuvre de science-fiction unique et un vrai défi technologique. Or les astres ne se sont pas alignés comme le prédisait la prophétie et James Cameron a délégué sa place de réalisateur à l’homme qui a commis la trilogie Spy Kids, préférant explorer la planète Pandora et ses satellites au cours des prochaines années à venir. C’est dire si notre enthousiasme était quelque peu échaudé. Et les premières bandes annonces n’ont fait qu’alimenter nos craintes. Mais bon, on se rassure en se disant qu’il n’est pas complètement gâteux et que lui et son fidèle producteur John Landau ont pris les précautions nécessaires et n’ont pas laissé Robert Rodriguez tout seul sur le plateau avec sa guitare de mariachi. En effet, le père Cameron a placé aux postes clés certains de se fidèles collaborateurs. Seulement était-ce bien suffisant ? Il ne s’agit pas là d’un risque anodin, mais bien d’une super production à 200 millions de dollars. Et on s’inquiétait à juste titre de ce qu’il allait rester de l’œuvre de son géniteur Kishiro Yukito.
Et bien on y croit, avec ses premiers plans d’une dominante orangée dans lesquels on découvre l’acteur Chistophe Waltz dans le rôle du professeur Ido qui remarque dans cette immense décharge à ciel ouvert les restes d’un ange rouillé, celui d’une cyborg au visage d’adolescente. Jusqu’ici tout va bien, le film est respectueux de l’œuvre original et on constatera tout du long du métrage une certaine déférence envers le manga et son adaptation, pas très réussie, en anime. En effet Cameron, et même Rodriguez, sont parvenus dans les grands axes à écrire une bonne synthèse des trois premiers tomes et ont même réussi à intégrer de manière pertinente l’épisode du motorball au sein du récit sans que la greffe ne passe pour un artifice otaku.

Il y a dans un premier temps une réelle incompréhension face au personnage principal, de ses motivations. Si la relation avec Ido, bienfaiteur dans le manga, évolue ici en celle de figure paternelle de substitution, cela a beau changer la dynamique, elle ne nuit pas à l’intrigue. Au contraire ce segment est au final bien traité grâce au personnage de Chiren interprété par Jennifer Connelly qui fait la liaison et apporte une émotion mélancolique bénéfique au récit. C’est surtout le traitement de rom com adolescente puérile infligé à la relation amoureuse qui se joue entre Alita, cousine californienne de Gally, et Hugo qui pénalise le scénario. Cet axe scénaristique qui est l’un des enjeux principaux de cette histoire va couler le film un peu comme l’iceberg avait fait sombrer le Titanic. Plusieurs facteurs essentiels sont responsables de cette débâcle. Le premier est le traitement très propret fait du manga de Kishiro. Plus rien de punk ne subsiste dans cette adaptation aux forts relents disneyens. Il serait certes injuste d’appuyer cette démonstration sur une simple différence des cultures et ses enjeux industriels. Seulement, il est possible, en atténuant une certaine violence graphique, quelque peu gratuite dans sa version originelle et qui pourrait rebuter le grand public, de conserver certains éléments qui composent cet univers oppressant. En omettant des éléments essentiels qui régissent cette vision dystopique, non seulement certains personnages perdent leurs fonctions narratives et mais cela annihile aussi les réels enjeux qui se trament dans le récit. Le personnage de Hugo, par exemple, n’est plus un jeune rêveur un peu paumé livré à lui-même, qui cherche, dans son fantasme de monter sur Zalem, la cité flottante qui déverse ses détritus sur sa ville natale, une raison de vivre ou plutôt de ne pas sombrer dans la folie. Ici nous avons la figure classique du jeune rebelle un peu taciturne dont l’obsession fait place à une sorte de rêve, voire d’un défi adolescent pour séduire les filles. Dans un monde où tout le monde semble manger à sa fin, il fait beau tous les jours de la semaine, il y a du sport à la TV, bon le soir, certains coins sont un peu craignos, mais rien de pire que la Porte de la Chapelle. Rien ne semble réellement motiver ce besoin d’évasion, et de transgresser l’interdit. Donc quand ce grand benêt en cuir noir invite son béguin amoureux sur les toits et que cette dernière s’exclame : « Que c’est joli ! » en voyant une ville-décharge, à cet instant précis on se dit que les auteurs de ce film ont fait fausse route. Et tout le reste sera du même acabit à tel point que l’on en vient à se demander comment James Cameron a pu manquer d’autant de discernement. Robert Rodriguez n’est certes pas un cador derrière la caméra, mais toutes les fautes de goût du film ne lui sont pas imputables. Et pourtant, d’éléments qui hérissent les cheveux par leur ringardise, le film Alita n’en manque pas. Entre la découverte de sa nouvelle bande copains, une bande de cons sortis d’une pub pour soda des années 80, la bagarre de saloon qui confère au film des faux airs de série western avec sa musique rock FM, et ces scènes de souvenirs qui apparaissent quand Alita fait de la bagarre contre des vilains cyborgs qui ressemblent à s’y méprendre à la bataille finale de Moonraker de Lewis Gilbert, le film frôle à plusieurs occasions le ridicule. Quant à la pauvre Alita, elle est devenue une princesse Mickey dans un corps cybernétique, une ado un peu gourde et naïve qui ne semble pas prendre son destin en main. Elle n’est plus cette héroïne vindicative, volontaire et attendrissante qui trouve, dans l’expression de son corps, cet effet de transe qui la relie à sa psyché en sommeil lorsqu’elle pratique instinctivement l’art martial du Panzer kunst.

On pensait en revanche que le film serait irréprochable sur le plan technique, James Cameron vantant que la révolution technologique développée par Avatar était nécessaire à la réalisation d’Alita et que celle utilisée pour sa conception servirait de référence, notamment dans les innovations en motion capture pour les futures suites. Seulement, à la vue du résultat particulièrement décevant on en vient à se demander si le responsable des SFX n’était pas un nom d’emprunt de Robert Rodriguez tant cela pue le je-m’en-foutisme ! Il y a vrai problème d’intégrations des effets numériques, personnages et éléments de décors en dur dans l’image. Les scènes tournées en studios font vraiment carton-pâte, les maquillages, tocs, et les têtes flottent sur des corps en CGI : on se croirait dans une production Marvel. Et puis, il y a difformité d’Alita, qui grâce aux SFX, expriment des mimiques adorables, mais ne parviennent jamais à faire oublier ses deux globes de Gollum. Cela créer d’emblée une distance et ne parvient pas à nous faire oublier qu’elle est un effet spécial et non le personnage principal. Une expérimentation qui aurait dû stopper à la bande annonce et être rectifiée en post prod. Non seulement c’est moche, mais cela témoigne d’une réelle incompréhension du médium manga par les auteurs du film. Certes tous ces designs auront de quoi alimenter un bel artbook, mais cela manque de caractère. Tous ces techniciens chevronnés engagés par Cameron pour chapeauter le cinéaste mexicain ont l’air d’avoir fait la sieste sur le plateau, même Bill Pope qui avait éclairé la trilogie Matrix est en petite forme.

Quant à Rodriguez, sa réalisation bien qu’efficace par moment manque de singularité, ce dernier tentant d’imiter maladroitement le découpage de Cameron. Pire, il n’arrive pas à traduire sous forme cinétique l’incroyable beauté létale du Panzer kunst, Alita ne pratique à l’écran qu’une forme grossière de kickboxing dérivée de l’art du coup de pied dans la gueule façon Chuck Norris et Panda bouffi.

A la vision de ce Alita, on ne peut que regretter que le film ne soit pas resté une chimère, un fantasme de cinéphile qui aurait pu alimenter un beau documentaire qui nous aurait fait rêver du chef d’œuvre qu’il ne sera jamais. Si on peut constater que le cinéma hollywoodien maltraite avec une certaine régularité les œuvres cultes issues du manga, elles subissent de plus mauvais traitement que les comics américains. Elles témoignent simplement d’une impossibilité d’être traduites en l’état suivant les critères du cinéma mainstream contemporain. En revanche si elles permettent à de nouveaux lecteurs de découvrir l’œuvre de Kishiro alors cette adaptation n’aura pas servi à rien.
Martin Debat.
Alita: Battle Angel de Robert Rodriguez. USA. 2019. En salles le 14/02/2019





 Suivre
Suivre