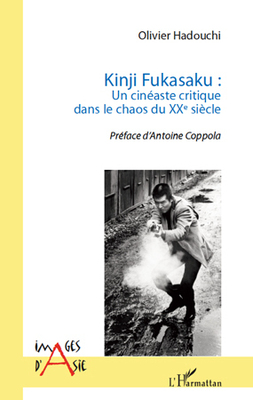Après Leçons d’harmonie et L’Ange blessé, Emir Baigazin, réalisateur de 34 ans seulement, conclut sa trilogie sur l’enfance avec The River.
L’austérité, la violence et la beauté unique de l’univers d’Emir Baigazin sautent littéralement aux yeux. Ce sont des surcadrages, une symétrie de tous les instants, une minutie qui confèrent parfois au génie. Les films monde du cinéaste ne sont pas aimables au premier abord, ils ne tentent pas de l’être. Ils font état d’un délabrement mêlé de sidération. La beauté presque hypnotique de chaque plan a quelque chose d’à la fois cruelle et émouvante. Cruelle parce que cette beauté que touche du doigt le cinéaste, les personnages ne la voit pas, enfermés qu’ils sont dans un quotidien morne et violent. Émouvante, car cette beauté ouvre un champ des possibles, une porte de sortie.

Dans The River, Baigazin conclut sa trilogie sur l’enfance. Comme à chaque fois, le personnage principal est donc Aslan, ou « le lion » en turc. Dans les trois films, il est toujours à la fois la victime et le leader, celui qui cherche à s’évader d’un cadre trop étroit. The River montre le quotidien d’enfants qui travaillent en milieu hostile. La chaleur, la poussière, un père violent qui ne laissent aucun répit.
Alors Baigazin les observe autant dans les moments de jeu éphémère que dans le dur labeur et la douleur. De ces instants de vie naît une poésie à la force incroyable. L’idée du film tient en une idée, une opposition : le versant sablonneux, aride semble toujours mis en contrepoint avec la rivière, belle, lumineuse et calme. Les enfants tentent de s’émanciper de ce monde pour trouver leur voie/x.

Comme dans les précédents films, l’analogie entre l’enfance et la situation générale du pays/monde est parfaitement établie. Même dans les moments de quiétude où les enfants nagent, le courant les sort du cadre. Le courant, Aslan en parle dès le premier plan du film. Il représente l’élément qui les retient autant qu’il peut les sauver. Il est personnifié par la présence du père qui revient comme des vagues qui renvoie à la réalité. L’action pourrait se situer à n’importe quelle époque, mais une séquence vient nous ramener à notre temps. En quelques plans, Baigazin expose les problématiques de l’enfance moderne, dans laquelle le son hypnotique sortant d’une tablette attire les enfants comme des mouches. Sans vraiment juger, l’auteur veut surtout illustrer l’ouverture sur le monde possible (l’enfant à la tablette parlera de GPS plus tard).

Petit à petit, cette rivière prend un caractère presque sacré. Dans une séquence sublime, une musique élégiaque vient briser le silence. Elle élève leurs âmes damnées, les purifie. Mais est-ce qu’une escapade est suffisante ? Baigazin semble sceptique. Dans une séquence incroyable, les enfants inertes écoutant les messages de propagande, les appels au Djihad, les catastrophes, juste après, le père expliquera que la rivière peut être dangereuse, que chaque chose de ce monde a plusieurs aspects. Et comme toujours on observera un personnage nager contre le courant et disparaitre du cadre. Evidemment ces disparitions du cadre annoncent quelque chose de plus dramatique. Comme toujours chez l’auteur, la cruauté du monde vient toujours frapper les personnages quand ils s’y attendent le moins.

Avec The River, Baigazin signe là une conclusion parfaite à sa trilogie sur l’enfance et signe son plus beau film. La dureté du monde laisse de moins en moins de place à la liberté ou l’évasion. Cette liberté à un prix : pour s’émanciper, il faut tuer une part de soi. Le nihilisme élégiaque des derniers instants devient vraiment saisissant tant il cristallise toutes les angoisses des personnages. Il cerne avec une acuité qui n’est plus à démontrer l’état d’un pays en plein changement autant que l’enfance. Alors oui, ce cinéma-là peut sembler austère à première vue, mais il recèle des trésors, serrant le cœur tout en provoquant une sidération de tous les instants. La scène finale est à cet égard terrassante.
Jérémy Coifman.
TheRiver d’Emir Baigazin, Kazakhstan 2018. Présenté dans le cadre du 20ème Festival Black Movie.





 Suivre
Suivre