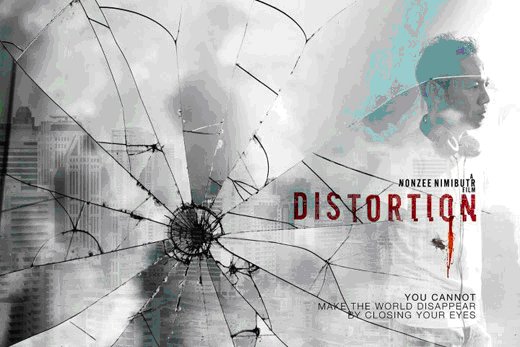Du 2 juillet au 3 août, la Cinémathèque française met à l’honneur le réalisateur japonais Fukasaku Kinji, cinéaste aux 40 ans de carrière. L’occasion était trop belle de se replonger dans notre entretien avec Olivier Hadouchi, auteur d’un passionnant ouvrage sur le réalisateur, Un cinéaste critique dans le chaos du XXème siècle (L’Harmattan, 2009), la lecture idéale pour accompagner la (re)découverte de la dense filmographie fukasakienne. Par Samir Ardjoum et Victor Lopez.
C’est surtout pour mettre en avant les réponses par rapport à Hollywood, à ce qui ce fait comme autre forme de cinéma. Il y a une focalisation sur le cinéma Hollywoodien, souvent justifiée d’ailleurs. J’adore pleins de cinéastes américains : Carpenter, Fuller, Peckinpah… Mais à la même époque, il existait un dialogue avec ce genre de films qui permet de montrer qu’il existe autre chose que les cinématographies les plus dominantes et connues.
Comment avez-vous découvert les films de Fukasaku et décidé de lui consacrer un ouvrage ?
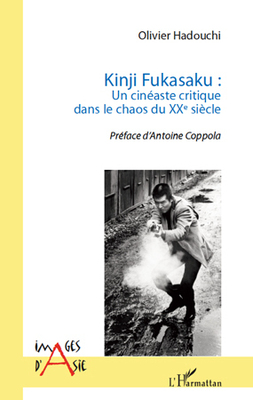
A l’origine, c’est un DEA. Je pensais que par le biais du cinéma de genre, il y avait une approche intéressante. C’est un peu le discours de la nouvelle vague, sur la manière dont les séries B peuvent montrer les innovations formelles et créer un style d’auteur, même si c’est au sein de studios, tout en ayant un regard dynamique, historique et critique.
Pouvez-vous nous présenter Fukasaku Kinji?
C’est un cinéaste qui apparait à la fin des années 50, en même temps que la nouvelle vague japonaise ( Oshima, *Imamura*…). Mais c’est surtout un cinéaste de genre, qui va renouveler le film de Yakuza. A l’époque, le genre était assez conservateur et visait à montrer une hiérarchie très établie, avec un ordre social très préservé, tout en soulignant un certain romantisme du mauvais garçon. En général, le yakuza honorable a une arme tranchante, comme un sabre, et le méchant qui ne vit pas dans les règles, a une arme à feu. C’est souvent un cinéma historique. Fukasaku va révolutionner cela en allant vers plus de réalisme.
Il y avait plusieurs studios avec leurs spécificités. Fukasaku œuvre pour la Tôei, qui avait un côté plus mauvais garçon, plus brut. Il y crée un sous-genre, qui s’appelle « histoire vraie », dont Le Cimetière de la morale est l’archétype. Et après, on ne peut plus faire de films de Yakuza « à l’ancienne », puisqu’il a montré que tout cet univers se base sur un fond d’arnaques, de corruptions, de fraudes, de manipulations… On peut un peu comparer avec ce que faisait Rosi en Italie par rapport à la mafia.
Il y a une vraie violence, mais aussi une révolte et une jeunesse. Avant, les personnages de Yakuza étaient très mesurés, chez Fukazaku, ils sont agités, peuvent avoir des crises. Il y a par exemple Suguwara Bunta, qui est assez mince et félin, et qui correspondait pour Fukasaku à la génération d’après-guerre. Fukasaku est surtout un enfant de la guerre : il est sous les bombardements et a vécu toute la période de reconstruction, assez anarchique puisque toutes les valeurs du Japon ancestral se sont effondrées. C’est vraiment le chaos. On peut rajouter à cela des problèmes de culpabilité du Japon par rapport à leur entrée en guerre, notamment par rapport à la Corée et à la Chine. Face à cela, il y a l’émergence d’une nouvelle génération, révoltée, voulant dire « je », sans être dans une espèce de carcan du groupe, avec une sacralisation de la figure de l’autorité.
Au début, Fukasaku ne choisit pas vraiment ses films. A l’origine, il fait des études de cinéma et des critiques, en essayant d’avoir un point de vu personnel. Ses directeurs de production diront d’ailleurs qu’il n’était pas « assez docile » au sein de l’industrie. Il commence avec quatre films, des « program pictures » devant lancer une nouvelle star, Sonny Shiba. Puis fait des films noirs ou policier. Son premier long métrage est Du Rififi chez les truands. Fukasaku est à l’époque assez curieux du cinéma d’après-guerre. Il a découvert le cinéma de la nouvelle vague et aime bien Godard, et la génération d’avant, Duvivier, surtout Pépé, le Mocko, dont il admire la nervosité et la mise en scène.
Il va aussi faire faire beaucoup de films de production, alternant entre des films qui lui tiennent à cœur et des commandes. On trouve dans sa filmographie aussi bien des films de Science-fiction, comme Green Slime ou Sankukaï, que des films plus personnels, dont Sous les drapeaux, l’enfer. Il y confronte les résultats de la seconde guerre mondiale et la société présente.
Pour quelles raisons son cinéma rencontre-t-il des difficultés d’exportation ?
Les gens ont vu ses films à l’époque. Friedkin s’est par exemple inspiré de son style pour French Connection : la caméra porté, le style documentaire, les changements de points de vu, la difficulté à situer les personnages entre le bien et le mal… Mais il n’est pas vraiment pris au sérieux en France. Les doublages et les titres sont à l’époque assez caricaturaux. Mais même des grands auteurs comme Ozu ont mis du temps à s’exporter en France, et c’est encore plus compliqué pour un cinéaste de genre. Ce qui explique cette marginalisation.
Et aujourd’hui ?
En 2001, un critique japonais, Sadoa Yamane, a réalisé une monographie. Mais ça fait assez longtemps que Fukasaku est respecté par une grande partie de la critique japonaise. La série Combat sans code d’honneur y est considérée comme un témoignage historique important sur le japon d’après-guerre.

Pour parler de l’ouvrage, la 4ème de couverture expose une différence entre ses travaux de commande et ses films importants. Est-ce une distinction valide pour une cinéaste comme Fukasaku, qui, même s’il a travaillé comme indépendant, à le plus souvent œuvré dans (et contre) les studios, d’autant plus que cette affirmation semble jurer avec la citation liminaire d’Oshima sur program pictures ?
Oui, mais il peut y avoir un côté artificiel à tout vouloir considérer au même plan. Il y a clairement des films qui sont beaucoup plus anecdotiques. On peut y retrouver son style et ses thématiques, mais il ne faut pas non plus idéaliser… On ne peut faire une politique des auteurs en considérant chacun de ses films comme un chef d’œuvre. Il faut donc faire une différence et montrer que certains de ses films ne sont pas vraiment impérissable…
Quel était sa marge de liberté dans le choix films/sujets/genres ?
Assez mince : il avait un cahier des charges à respecter. Au début, son style a du mal à passer. Mais comme il y a une contestation étudiante qui se radicalise à la fin des années 60, le genre et son style passent mieux. Il a alors plus de facilité à détourner la commande et laisser passer sa vision du monde. Fukasaku a vraiment la volonté d’être indépendant. On lui reprochera de ne pas être assez servile, jusqu’à ce qu’il devienne rentable et qu’on lui donne plus de moyens et de liberté.
Vous faîtes à ce propos un parallèle entre Fukasaku et Peckinpah, notamment dans leurs rapports conflictuels aux studios. On se demande cependant en pensant par exemple au cas de Major Dundee, où Peckinpah à été renvoyé du tournage, privé du montage, puis empêché de faire des films, si une relation aussi violente est réellement possible au Japon…
En fait, Fukasaku était sous contrat avec la Tôei, donc il pouvait continuer à tourner. Il a aussi tourné pour la Shoshiku et produit en indépendant Sous les drapeaux, l’enfer, qui fut un échec. Mais sinon, il joue le jeu. Dans les années 80, il réalise beaucoup de productions commerciales et s’adoucit vraiment. Il affronte donc un peu les studios au début, mais accepte ensuite les commandes assez facilement.
Une autre distinction que je ne comprends pas, c’est celle que fait dans la préface Antoine Coppola entre la violence des films de Fukasaku et celle des films d’horreur, « qui ne sont que des façons d’entretenir la peur de l’autre, de conforter la sainte famille, la patrie en danger et la société bourgeoise »…
Il peut y avoir dans les Gojira par exemple, des éléments un peu nationalistes, ou, dans les productions américaines de l’époque, un côté xénophobe. Alors que chez Fukasaku il y a une violence, non pas libératrice, car il ne pense que la liberté puisse venir de celle-ci, mais qui a à voir avec une révolte non théorisée, qui n’appartient pas à un partie. Pour lui, la violence était omniprésente, à tous les niveaux : c’était une violence de l’autorité, du père contre l’enfant, de la société, c’est un chaos total !
Il y a un sujet que vous développez et qui me semble problématique dans le cinéma de Fukasaku, c’est celui de la place des femmes dans son cinéma. Dans les Yakuza Eiga, les prostituées symboliseraient la place de parias qu’ont les hommes, d’où la naissance d’histoires d’amour entre eux. Mais elles ont tout de même une place de victimes qui subissent les situations – là où les hommes sont maîtres de leur destin. On les voit maltraitée et violées, et dans Okita ou Le Cimetière de la morale, c’est cette violence initiale qu’elles subissent des hommes qui les mène à l’amour… Peut-on y voir un forme de misogynie sous le voile de l’amoralisme, due à une absence de jugement vis à vis des actions masculines envers femmes, et si non, pourquoi ?
Je pense que c’est vraiment un réalisme. Il montre l’envers du décor, que les maquereaux tabassent les femmes quand elles ne veulent pas travailler… Il décrit les situations sans hypocrisie. La femme est vraiment une victime, et Fukasaku est un témoin. Mais cela évolue dans son cinéma avec la société, il n’y a plus du tout ce traitement dans Battle Royale.

Une autre thématique primordiale qui traverse votre première partie, c’est Hiroshima. N’est-ce pas une lecture possible pour tous les cinéastes japonais de cette période ? Et si ce n’est pas seulement générationnelle, en quoi est-ce particulièrement important pour Fukasaku ?
Ça peut être une lecture possible pour d’autres cinéastes, de manière directe ou pas. Mais il n’y a pas tellement d’images qui circulent… C’est pourquoi le genre en fait une lecture métaphorique, comme dans Gojira. Le thème est d’abord abordé par le mélodrame, puis, il y a eu Pluie noire, beaucoup plus tardif…
Fukasaku réalise vraiment des peintures de l’après-guerre. Certains éléments sont clairs par rapport à la présence de la bombe, comme dans Virus, film catastrophe dans lequel il y a une bombe atomique, un virus, un peu toutes les catastrophes. Dans d’autres, c’est implicite.
Pouvez-vous nous parler du style “chaotique” de Fukasaku (arrêt des images, décadrages, jeux sur les textures), de cette esthétique du chaos et pourquoi il n’est pas un formaliste à la Tarantino ?
Souvent, on oublie le travail stylistique d’une extrême précision de Fukasaku à cause de l’impression de chaos qui en ressort. Mais ce chaos est très maîtrisé, avec un montage très dynamique, avec des lignes fortes pour créer une grande tension, un usage de la caméra portée… Mais contrairement à Tarantino, il a un vrai regard sur la société, l’histoire, qui n’en fait pas un formaliste.

Vous évoquez le manga à propos des films de Yakuza. Voyez-vous une influence de l’un à l’autre ?
Oui, ça marche dans les deux sens. Mais c’est difficile d’établir à quel dégrée. Quand il compose un plan, le cinéaste a souvent pas mal d’images en tête, des siècles d’aquarellistes et d’artistes japonais. Et même des cinéastes comme Oshima s’inspirent à l’époque du manga… Mais en regardant les cadrages penchés de Fukasaku, il y certainement a une filiation avec les cases en oblique.
Vous présentez Fukasaku comme le cinéaste de la rupture, mais sa description réaliste de modes de vie le pousse aussi à filmer des traditions typiquement japonaises (même s’il les tourne en dérision). Pouvez-vous nous parler de ce rapport à la tradition et à la société japonaise et ce qui en fait un cinéaste critique ?
Le nouveau dogme de l’après guerre, ce n’est plus l’empereur mais la croissance économique. On le voit par exemple dans Guerre des gangs à Okinawa, où les bases américaines créent toutes sortes de trafics et de la prostitution. Mais, s’il critique l’évolution de la société, il ne veut pas la restauration d’un ordre ancien, avec la soumission et l’ordre féodal. Il critique donc les deux aspects. A la fin des années 70, on assiste à un nouveau nationalisme. Fukasaku va alors faire des films de sabre avec un fort regard critique. Il montre que les grandes dynasties se bâtissent sur le mensonge, l’assassinat, la violence…
Quel était son rapport à la politique ? Vous évoquez les événements du chalet d’Asama, mais on ne le retrouve pas engagé comme Wakamatsu…
Il ne croyait pas dans la politique au sens traditionnel, dans les partis. Mais il a un regard, que l’on pourrait qualifier d’anarchiste sur le monde. Étudiant, il militait contre l’impérialisme, mais il n’a pas du tout le côté militant de ses amis qui s’engagent dans l’armée rouge.
Comment s’est-il retrouvé aux commandes de projets internationaux (The Green Slime 1968, Tora ! Tora ! Tora ! 1970, Virus 1980) alors qu’il était, surtout avant 72, considéré comme un réalisateur peu bankable par les studios ? Et qu’est ce que ces films représentaient pour lui ?
Il essaie d’honorer la commande le mieux possible. Pour Tora ! Tora ! Tora !, les studios avaient pensé à Kurosawa Akira, mais ils ont trouvés qu’il discutait beaucoup ! Ils choisissent alors Fukasaku en espérant que ça aille plus vite. Et c’est grâce à ce cachet qu’il a pu produire Sous les drapeaux, l’enfer, qui lui tenait vraiment à cœur.

Comment expliquez-vous que les années 80 furent assez problématiques pour le cinéaste ?
La société évolue vers un capitalisme triomphant. Personne ne veut plus voir de films critiques sur les Yakusa. Le Cimetière de la morale est presque le point limite, il a tellement déstructuré le genre qu’il doit passer à autre chose. De plus, la Tôei a beaucoup de problème et il est obligé de passer à des compagnies plus commerciales.
Est-ce que Fukazaku aurait pu créer aussi intensément dans le système japonais actuel ?
A l’époque, le système des studios permettaient plus de dynamisme. Aujourd’hui, des cinéastes prolifiques comme Kurosawa ou Miike sont parfois obligés de sortir directement leurs films en DVD.
Que pensez-vous des hommages que lui rendent Kitano ou Miike dans leurs films ?
Le point commun avec Miike, c’est qu’ils font des films dans des situations très difficiles. Après, c’est un autre tempérament. Miike et Kitano ne sont pas vraiment ses héritiers, ils font autre chose.
Pourquoi selon-vous un cinéaste aussi important que Fukazaku est toujours aussi mésestimé par rapport à Oshima, Imamura ou pour citer deux poids lourds, Kurosawa et Mizoguchi ?
Tarantino a fait beaucoup parler de lui. Il y a aussi Battle Royale, mais les gens ne rattachent pas à ce qu’il y avait avant. Il y a aussi un côté très spécialisé, car c’est un cinéaste très apprécié des fans de cinéma asiatique. Malheureusement, ça reste dans un petit cercle.
Entretien réalisé par Samir Ardjoum et Victor Lopez pour CinéMove à Paris le 04/05/2010.
A lire :





 Suivre
Suivre