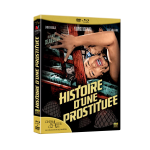Tokyo, quartier de Yûrakuchô. Du 23 novembre au 2 décembre s’est tenue la treizième édition du festival international Tokyo Filmex. Relativement inconnu en Europe, ce festival présente chaque année une sélection de films asiatiques principalement destinée à promouvoir de nouveaux cinéastes. Les films programmés sont l’œuvre de jeunes réalisateurs invités à présenter leur première œuvre, ou peu s’en faut. Donnant un aperçu des nouvelles productions asiatiques, d’Israël au Japon, le festival entreprend de faire découvrir les talents de demain. Un exemple : avant d’être reconnu en Europe, le cinéaste Kim Ki-duk a fait ses armes dans le cadre du festival Filmex et reste aujourd’hui l’un des invités d’honneur de la plupart de ses éditions. Par Nicolas Debarle
D’un cru composé de neuf longs métrages de fiction, le festival comme à son habitude s’est exclusivement concentré sur des films qu’on qualifierait de drames sociaux. Des œuvres intimistes aux fresques sociales, la palette couverte par la programmation, s’appuyant sur une certaine cohérence thématique, a le mérite de brasser un faisceau d’émotions, de révoltes et de rêves aussi large que possible.
Il convient d’être juste : tous les films de cette édition 2012, évidemment, ne se valent pas. Si certains d’entre eux ont su se détacher du lot par leur subtilité, d’autres au contraire ont montré bien de peine à convaincre. Ces films n’ayant encore trouvé de distributeur en France, espérons que les meilleurs d’entre eux trouveront leur place le plus rapidement possible dans nos salles de cinéma.
Memories look at me (Song Fang, Chine, 2012)
Dans la lignée des films de Jia Zhang-ke dont il est justement le producteur, ce premier long métrage d’une réalisatrice chinoise propose une forme de récit quasi expérimentale. Une jeune femme retourne auprès de sa famille, après une absence relativement longue due à ses études menées à Pékin. Originaire d’un village, cette famille réside à présent dans un quartier résidentiel d’une ville dont on ne connaît pas le nom.
Ce retour enclenche de longues discussions nourries par les nombreux souvenirs d’enfance du personnage principal. Dans le même temps, le film scrute la façon dont cette famille s’est vue contrainte de changer de cadre de vie en passant de la campagne à la ville. Les personnages semblent attachés à leur propre passé dans la mesure où le présent ne correspond plus à ce qu’ils attendent de la vie. Celle-ci paraît cloisonnée : le film ne quitte pas un instant l’appartement familial dans lequel rien ne se produit réellement, si ce n’est l’évocation même des souvenirs. Composé du début à la fin de longs plans fixes, le film révèle ainsi la lourde pesanteur du présent au cours duquel le passé ne cesse de surgir sous des formes émotionnelles variées, comme pour habiter le temps qui passe.
Cela étant, la réalisatrice ne fait preuve à aucun moment de passéisme : il ne s’agit pas de regretter le passé, mais de constater la perte des repères dont les générations chinoises actuelles sont les sujets.
Grape candy (Kim Hee-jung, Corée du Sud, 2012)
L’une des particularités du film réside dans le glissement narratif opéré en plein milieu du récit. Ce dernier s’ouvre sur la base d’une hypothétique relation adultère : une femme sur le point de se marier soupçonne son compagnon d’avoir une liaison avec une écrivaine célèbre. Bien décidé à mener l’enquête, le personnage finit en réalité par affronter son propre passé. Le film entretient le mystère autour de ce passé avant de dévoiler le tout dans les dernières minutes. À l’instar de la madeleine de Proust, le bonbon au raisin évoqué dans le titre constitue l’élément déclencheur des réminiscences auxquelles les personnages se livrent. Le mystère en question a trait avec un accident de bus réellement survenu en Corée du Sud dans les années 90.
Si la première partie du film repose sur des ressorts narratifs relativement classiques, la seconde partie s’efforce quant à elle d’éclater l’organisation du récit par l’intermédiaire d’une longue série de flashbacks. Deux problèmes en découlent : les deux parties tout d’abord semblent déconnectées l’une de l’autre ; les acquis du début en effet ne raccordent pas avec le déroulement du final. De plus, la seconde partie semble reposer sur les caprices d’une énonciation malicieuse. La linéarité du récit est mise à mal dans le seul but de nourrir le mystère le plus longtemps possible. Perdant de vue les possibilités posées dans les premières séquences, le film perd en finesse psychologique ce qu’il gagne en artificialité.
I am not the world you want to change (Izumi Takahashi, Japon, 2012)
Le cinéaste Izumi Takahashi signe l’un des deux films japonais en compétition, mais aussi probablement le long métrage le moins abouti de toute la sélection. Héritier, si l’on veut, des pinku eiga dont il ne conserve que l’aspect violent, le film dénonce le phénomène, répandu au Japon, des brimades à l’école. Un jeune homme, qui a lui-même été l’objet de ce genre de pratiques, propose de venger d’autres victimes en torturant leur bourreau devant l’objectif d’une caméra vidéo.
Amateurisme, c’est le mot. Dans la lignée des pinku eiga, le film manque assurément de moyens, mais contrairement, par exemple, aux premières productions de Kôji Wakamatsu, l’amateurisme imprègne ici chaque élément du film. Tant au niveau de la direction d’acteurs que de l’écriture dramatique, le long métrage ne parvient pas à dépasser une vision puérile des choses. Le récit se perd dans un brouhaha de tonalités cherchant à lier le lyrisme à l’ultraviolence (n’est pas Kubrick qui veut) et se noie dans une pluralité de scènes et de personnages tous plus stéréotypés les uns que les autres, sans pour autant parvenir à tirer la moindre lecture des problèmes sociaux à l’origine de l’intrigue.
La morale est sauve : malgré leurs égarements, les personnages finissent par rentrer dans la normalité. Tout est bien qui finit bien.
All apologies (Emily Tang, Hong-Kong, 2012)
Le film s’inscrit dans le registre du fait divers et du quotidien. L’exposition du cadre et des personnages s’effectue par petites touches réalistes. Le récit se déroule dans un quartier populaire de Hong-Kong et se focalise autour de la vie de deux couples voisins.
La mort accidentelle de l’enfant de l’un d’entre eux constitue l’acte fondateur de l’intrigue. Fou de rage à l’encontre de son voisin qu’il tient pour responsable du drame, le père du jeune défunt cherche à retrouver un équilibre, quitte à commettre un acte violemment immoral. Sa douleur le conduit en effet à violer la femme du prétendu assassin tout en la réduisant au silence par quelque chantage. S’enfermant toujours plus dans son fantasme, le personnage finit par séquestrer sa voisine, dont il espère obtenir un nouvel enfant en guise de compensation.
Le récit se fonde sur une dégradation des relations psychologiques enchaînées les unes aux autres par un effet domino. Le personnage principal refuse d’accepter la fatalité de son existence et en vient progressivement à détruire les liens qui l’unissaient avec ses proches. Si le film traduit cet état d’esprit avec finesse, il n’en reste pas moins vrai qu’il peine à dépasser le statut de l’anecdote. Un grand nombre de scènes censées étoffer le développement du récit paraissent en effet superflues. Le long métrage a certes le mérite de poser de bonnes questions, mais échoue quelque peu à y répondre. Traitant son sujet comme s’il s’agissait de simples problèmes conjugaux, le film ne trouve l’énergie nécessaire pour traiter le problème de la condition féminine, au cœur pourtant de son interrogation.
Room 514 (Sharon Bar-Ziv, Israël, 2011)
Inspectrice de police militaire, une femme est chargée d’une affaire liée à des violences gratuites commises à l’encontre de civils arabes par des soldats israéliens. Le film prend place dans deux lieux uniquement : le bureau de l’inspectrice – la salle 514 – et le bus qui reconduit la jeune femme chez elle. Les lieux se répètent au fil des jours qui passent.
Room 514 se développe autour de trois thèmes principaux : la difficulté pour l’inspectrice à exercer son métier dans un milieu masculin, les exactions perpétrées en temps de conflit et les problèmes de hiérarchie inhérents au corps militaire. En optant tout au long du film pour la seule technique de la caméra à l’épaule, le cinéaste privilégie les gros plans de façon à traquer les réactions émotionnelles de ses personnages. Le spectateur est placé au cœur des tensions mises en œuvre au cours de l’inspection.
Répétant constamment le même principe tout au long du film, le cinéaste semble en réalité passer à côté d’un pan important de son propos. Le problème militaire se voit traiter en effet comme un simple problème psychologique, une parabole valable pour toute situation de conflit. Dès lors, une question se pose : en quoi le problème palestinien, qui pourtant découle directement de la situation dépeinte dans le film, est-il évoqué ici ? Un fait isolé et coupé du monde ne fait pas un film, qu’on voudrait réaliste. Une pièce de théâtre n’aurait-elle pas été plus appropriée à développer le même sujet ?
Odayaka (Nobuteru Uchida, Japon, 2012)
Très attendu dans la mesure où son réalisateur a été primé l’an passé dans le même festival, Odayaka est l’un des premiers longs métrages de fiction à évoquer la catastrophe nucléaire de Fukushima. Cela étant, il ne s’agit pas de traiter la catastrophe en tant que telle, mais de s’interroger sur les répercussions psychologiques que celle-ci a pu exercer sur la société japonaise. Pour ce faire, le film se focalise sur le vécu de deux femmes au destin parallèle. Confrontées à l’insouciance de leur entourage quant aux possibles retombées radioactives dans la région de Tokyo, ces deux femmes cherchent à protéger leur famille, quitte à prendre à contre-pied les messages officiels édictés par le gouvernement. Montrés du doigt, les deux personnages font alors l’objet de violentes remontrances et vont progressivement s’isoler dans leur obsession.
Subtilement, le film ne prend aucun parti : la situation à Tokyo est-elle si sûre comme voudrait le reconnaître le gouvernement ? Les deux femmes ne sont-elles pas a contrario en train de sombrer dans la folie ?
La situation est telle, quoi qu’il en soit, que les deux femmes deviennent incapables de vivre dans leur environnement, à ce point que l’une d’entre elles tente de se suicider en entraînant son enfant avec elle. Le long métrage pointe par là l’incapacité pour le gouvernement à gérer la crise sociale que la catastrophe nucléaire a engendrée. Film axé sur la détresse humaine, Odayaka brille par-dessus tout par sa capacité à capter des réactions émotionnelles extrêmes grâce à une grande maîtrise de la direction d’acteurs.
The love songs of Tiedan (Hao Jie, Chine, 2012)
Une caméra au ras du sol filme les pérégrinations d’un enfant dans un village de Mandchourie des années 60. Perpétuant un mode de vie ancien, les habitants de ce village n’ont d’autre distraction que d’écouter les chants traditionnels qui cimentent leur communauté depuis un grand nombre de générations. Un soir, des commanditaires envoyés par la capitale, dans le cadre de la révolution culturelle, viennent interdire ces prestations. Les uns fuient en Mongolie, les autres sont envoyés dans des camps de travail. Trente ans ont passé ; les villageois, de retour chez eux, tentent de rebâtir leur communauté sur les ruines de leur culture. Devenu adulte, le petit garçon du début décide de quitter ses proches, suite à une rupture amoureuse dont il peine à se remettre, et parcourt la région afin de promouvoir les chansons de son enfance.
Toute la première partie du film repose sur un dynamisme des plus captivants. La caméra, la plupart du temps en mouvement, relie les personnages les uns aux autres comme pour souligner leur appartenance physique à une même communauté. Ceux-ci semblent faire partie d’un même corps, dont les chansons traditionnelles constitueraient le souffle ou l’âme. Fortement soulignée dans la majorité des plans, la nature sauvage, d’un autre côté, paraît participer d’un même élan à cette vie communautaire. Ces relations, une fois brisées, cèdent alors le pas à l’épanchement individuel du personnage principal. Ainsi, son errance dans les contrées voisines ne donne plus lieu au même enthousiasme. C’est que pour attirer les foules à ses représentations musicales, le personnage ne voit d’autre choix que de succomber à la tentation commerciale.
Par là, le film nous suggère en creux une certaine équivalence entre d’un côté l’interdiction pure et simple des disparités traditionnelles dans la Chine maoïste et d’un autre côté la modernisation à outrance à laquelle le pays se livre actuellement. L’un et l’autre cas donnent lieu à la dissolution des liens ancestraux à la base de la société chinoise.
Particulièrement frappant dans sa présentation des traditions mandchoues, le film s’essouffle malheureusement dans sa dernière partie dans la mesure où celle-ci manque de trouver un cadre filmique suffisamment clair pour exprimer l’uniformisation culturelle à l’œuvre dans la Chine contemporaine.
111 Girls (Nahid Ghobadi & Bijan Zamanpira, Irak, 2012)
Face à la menace de suicide collectif lancée par 111 femmes kurdes, célibataires par faute de prétendants, le gouvernement iranien envoie sur les lieux un délégué chargé de résoudre le problème. Quelque part entre le road-movie et le genre picaresque, le film relate l’itinéraire mené par le personnage en territoire kurde au fil des rencontres que celui-ci y effectue : enfants terroristes, militaires désaxés, chômeurs harassés, écoliers livrés à eux-mêmes…
Clairement, il s’agit d’exposer la situation vécue par les iraniens kurdes – dont la réalisatrice fait partie – non d’un point de vue réaliste, mais en en grossissant quelque peu les traits. Le ton décalé, voire burlesque du film cache en réalité un regard désabusé sur cette région délaissée par l’Iran. L’absurdité de la mise en scène amplifie la misère aussi bien matérielle que morale qui caractérise le Kurdistan.
De son côté, le personnage du représentant incarne le caractère archaïque du système politique iranien. Celui-ci est informé de la menace qui plane sur la région par une lettre que lui remet un enfant au beau milieu du désert, alors que l’information circule à la fois sur Facebook et CNN… L’Iran est représentée sous les traits d’un Mexique buñuelien, comme une terre surréaliste en contradiction avec le poids politique qu’exerce le pays dans le monde réel.
Le manque de moyens apparent du film ne l’empêche pas, contrairement à I am not the world you want to change évoqué plus haut, d’en tirer matière à développer son sujet. La situation matérielle même du film renvoie en effet au mépris avec lequel l’Iran considère ses propres artistes, forcés de s’exiler.
Epilogue (Amir Manor, Israël, 2012)
Le premier film du talentueux Amir Manor s’appuie sur une critique du « vivre ensemble » en Israël. Le réalisateur y fait le constat des conséquences sociales de la capitalisation excessive menée dans le pays depuis le milieu des années 80. Par le biais du regard d’un couple de personnes âgées, le film observe le manque de considération avec lequel la société israélienne considère ses doyens à l’époque actuelle. Un mur semble dressé entre l’ancienne génération porteuse de valeurs humanistes et la jeunesse égocentrique, renfermée sur elle-même, qui ne parvient plus à ouvrir les yeux sur le monde qui l’entoure.
Se conformant à leur propre fonction sociale, les individus paraissent dépossédés du désir de communiquer entre eux. Telle employée de santé publique demande au vieil homme de réaliser des exercices physiques dégradants afin de s’en tenir au règlement ; telle caissière de cinéma, absorbée par son smartphone, maugrée contre cette femme d’un certain âge sans se rendre compte que cette dernière entend tout ce qu’elle dit. Jusqu’aux portes automatiques qui s’obstinent à se refermer avant que telle personne âgée tirant une valise ne puisse les franchir, tout semble concourir à rejeter le troisième âge du monde tel qu’on le conçoit aujourd’hui.
Cet échec social est aussi celui du personnage principal : ancien activiste de gauche, celui-ci voit ses idéaux balayés par le vent consumériste abattu sur Israël. Désireux de créer de nouveaux groupes communautaires à l’image des kibboutz, le personnage tente de porter son message vers ses concitoyens qui, incapables de comprendre de quoi il retourne, semblent avoir perdu tout espoir d’améliorer leur propre cadre de vie.
La force du film consiste à entremêler cette critique politique et sociale au drame intimiste vécu par les deux protagonistes. En pleine crise conjugale, brisé par l’évincement de tous leurs espoirs, le couple parvient en réalité à se reformer, une fois délesté du carcan idéologique qui n’a eu d’autre résultat que de les séparer l’un de l’autre. Remarquablement justes, les deux acteurs interprètent leur rôle avec une émotion d’autant plus sincère que la caméra parvient à créer un fort rapport d’empathie avec l’expression de leur désarroi.
Palmarès de l’édition 2012 du festival Tokyo Filmex :
Grand Prix : Epilogue
Prix Spécial du Jury : Memories look at me
Prix Spécial Etudiant : I am not the world you want to change
Nicolas Debarle.









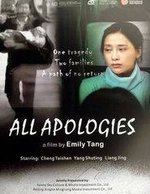





 Suivre
Suivre