Si l’on ne vantera jamais assez la vitalité, la convivialité et le sens de la découverte qui fait du FICA de Vesoul l’un des meilleurs festivals de cinéma en France, il semble cependant important de revenir sur ce qui nous a semblé son point faible : la sélection officielle, afin d’éclaircir nos réticences. Par Victor Lopez.
La sélection « Visages des cinémas d’Asie contemporains » a en effet laissé un goût d’inachevé, comme si le terme « Cinémas » y avait été occulté, ou plutôt, mis entre parenthèse et utilisé comme un moyen pour montrer quelque chose d’extérieur à lui. Tous les films présentés semblent en effet avoir été choisis plus en fonction de la force de leurs thématiques que de leurs qualités proprement artistiques. Dance Town de Jeon Kyu-hwan évoque le parcours d’une réfugiée nord-coréenne à Séoul, Khalifah de Nurman Hakim le rapport à l’Islam d’une indonésienne mariée à un radical, Nino de Loy Arcenas présente les affres d’une famille moderne et déstructurée, contées comme un miroir des évolutions et contradiction de la société philippine, August Drizzle d’Aruna Jayawardana raconte le combat d’une femme moderne travaillant au Sri-lanka comme entrepreneur en pompe funèbre, Return Ticket de Teng Yung Shin parle du sort des femmes travaillant en Chine loin de leurs familles, alors que Le Temps dure longtemps d’Özcan Alper évoque la question kurde en Turquie.
Ce qui pose ici problème, ce n’est pas tant cette ouverture au monde, bien au contraire, mais l’inadéquation que l’on a pu sentir entre la vision du monde que proposent ces films et les moyens mis en œuvre pour nous la présenter. On ne reproche ainsi pas vraiment aux films du festival une valorisation du fond sur la forme, mais plutôt, comme une invalidation de la force de leurs sujets par leur traitement, leur incapacité à proposer un univers cohérent qui nous ferait croire à leur propos. Trois d’entre eux posent particulièrement problème : Nino, August Drizzle et Khalifah. Ils montrent que sans travail esthétique, le cinéma n’est qu’une coquille percée, dont le propos s’évapore sans impact.
Khalifah est peut-être le plus symptomatique des trois. Le manque d’ampleur de sa mise en scène, qui aligne les plans téléfilmiques et les cadres scolaires dans une photographie sans relief empêche le spectateur d’être happé par l’histoire qu’il raconte. Certaines scènes devraient ainsi être choquantes, voire bouleversantes, comme celle ou Khalifah, portant la burka, se fait agresser par un couple victime d’un attentat terroriste. Mais non, on la traverse sans heurts et sans violence : on comprend bien le propos, mais on n’en ressent pas la force.
Nino porte les mêmes travers, la subtilité du scénario en moins. On comprend que la famille au centre du film devrait nous dire quelque chose sur la société philippines d’aujourd’hui, mais le tout est si maladroitement construit, que l’on n’y prête pas attention. Pire, à force d’accumuler les thématiques explosives, on ne sait plus si l’on regarde un drame qui se voudrait poignant ou une farce qui viendrait hypertrophier ce que l’on voit habituellement dans les drames familiaux de type télénovellas. La scène du repas, dans laquelle tous les non-dit familiaux sont révélés est-elle ainsi parodique ? Ce ne semble malheureusement pas être le cas, et même quand le fils annonce, alors qu’un inceste va être dévoilé (!), qu’il est gay (!!), on reste dans un premier degré fort maladroit, et presque embarrassant.
On retrouve ces contradictions dans August Drizzle. Certains passages se veulent ainsi une dénonciation d’une forme de corruption machiste au Sri-lanka. Mais pourquoi alors les « vilains » sont-ils aussi caricaturaux ? On les voit rire aux éclats en fomentant leurs plans machiavéliques ! Difficile ensuite de croire au propos mélodramatique du film, d’autant que le réalisateur use sans recul de toutes les ficelles possibles pour contraindre ses personnages au malheur. La tristesse qui en découle ne vient que de lieux communs cinématographiques, et donne l’impression d’une froide mécanique. Loin de toucher, elle finit par agacer.
Le problème de ces films est certainement de vouloir établir un rapport direct au monde, une exposition totale de leurs sujets, sans traiter la matière cinématographique qui permettrait de leur donner corps : le plan, le cadre, la photographie ou un jeu avec les genres et les attentes du spectateur. Les cinéastes donnent alors l’impression de filmer un scénario, une idée, une thèse, plus que monde qui les entoure.
Il n’est en ce sens pas étonnant que le plus beau film de la sélection officiel soit le coréen Dance Town. Interrogé sur ce qui semblait la thématique centrale du film, les rapports entre Corée du Nord et du Sud, l’acteur Oh Seong-tae a vite fait d’expliquer au public de Vesoul que le réalisateur ne pensait pas du tout son film comme politique, et qu’il aurait très bien pu le situer dans un autre pays.
Cela ne veut cependant pas dire que les films doivent se fermer au monde et aux « grands-sujets » pour exister. Au contraire, les « films-monde » sont à l’opposé des « films-sujets » que la sélection officielle du FICA nous a donné à voir. Pour citer un exemple vesoulien, présenté dans le génial « Regard sur le cinéma du Kazakhstan« , on peut parler de L’Aiguille de Rachid Nougmanov. Bien malin celui qui pourrait dire de quoi parle le film durant ses premières minutes, et pourtant, il nous parle. La musique, le montage, les cadrages, la force de ses images créent une atmosphère qui nous aspire, et nous permet de comprendre instinctivement son monde. Contrairement aux films de la sélection, il est impossible de résumer L’Aiguille à son sujet (dire qu’il s’agit d’un film sur… « la dépendance idéologique » par exemple, n’a pas de sens) et pourtant, sa richesse thématique est inépuisable (lire la critique de Jérémy ici). Il résiste à une classification et n’en devient que plus riche. Preuve s’il en est que les films apparemment sans fond ont parfois plus de profondeur que ceux dont on touche le fond trop rapidement.
Victor Lopez.
PS : Dans le dernier paragraphe, on peut remplacer L’Aiguille de Nougmanov par Black Blood de Zhang Miaoyang, Il était une fois en Anatolie de Nurie Bilge Ceylian, Oncle Bonmee d’Apichatpong Weerasethakul, etc.
À lire également : notre entretien-fleuve avec Rachid Nougmanov




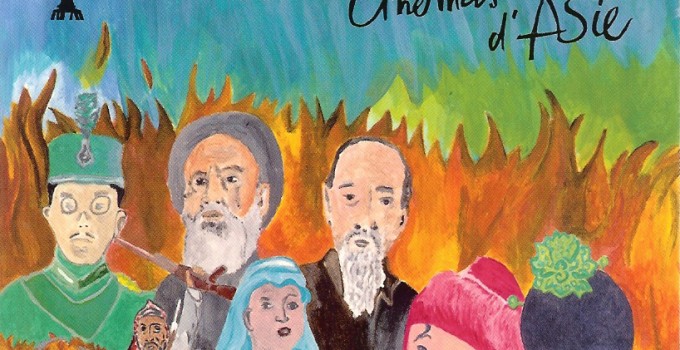



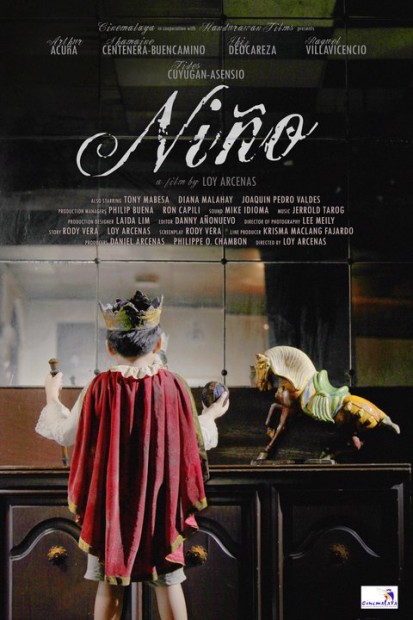

 Suivre
Suivre












