Arey ! नमस्ते,வணக்கம், سلام, ఏమండీ … ఒక భాష సరిపోదు!!! Vous avez bien accosté sur le territoire sacro-saint des cinémas indiens ! Pays regorgeant d’un zillion de cinéphiles au mètre carré, gouverné par une pléthore de dieux filmiques, c’est ici avec la bobine bien pendue que les anecdotes des plateaux de tournage sont contées. Kidnapping, catastrophe naturelle ou scoumoune en série tout est possible sur les rives du Gange et au-delà. Des plateaux de tournage de Kodambakkam aux studios implantés à la lisière des champs de papavéracées, vous voici donc propulsés au cœur de la cinématographie indienne. Alors que l’Inde s’apprête à festoyer en mai 2013 les cent ans de son cinéma, nous vous proposons un retour sur la production 2011. Par Marjolaine Gout.
Mais avant cela, un rappel s’impose. Les cinémas indiens ne se distinguent pas de prime abord par une catégorisation des films, au même titre que les genres et les mouvements cinématographiques, dit populaires, régionaux, artistiques ou encore issus de la diaspora, mais par leurs langues. On a en Inde deux familles de langues. Grossièrement, au nord règne le royaume de l’Indo-européen avec l’hindi, le marâthî, le bengali… et la langue coloniale et véhiculaire l’anglais. Au sud sont implantées, majoritairement, les langues dravidiennes, avec le tamoul, le télougou, le malayalam et le kannada. Ainsi, les productions cinématographiques en Inde se divisent généralement entre les studios enracinés à Mumbai (au Nord) et ceux de Chennai (au Sud). Mumbai reste ainsi la Mecque du cinéma hindi et Chennai celle du cinéma tamoul. Certes, le sous-continent indien regorge de studios de part et d’autre à l’instar de ceux de Calcutta (Bengale-Occidental) ou celui de Ramoji Film City à Hyderabad (Andhra Pradesh) mais il est légion que les tournages transitent et pérégrinent à travers le monde. L’identité première d’un film indien reste ainsi sa langue et l’ancrage culturel le rattachant à celle-ci. Cinéma parallèle ou commercial la teneur d’un film du nord n’est pas la même que ceux confectionnés au sud.
Si le cinéma du « nord » reste connu grâce à Satyajit Ray ou via le terme vulgarisé Bollywood (référant au cinéma hindi commercial) et l’industrie du « sud » par ses acteurs moustachus ou sa forte identité culturelle ceux-ci offrent un panel de films incomparables. Leurs particularités se distinguent par leur culture, leur tradition, leur spécificité… Le cinéma populaire hindi, connu actuellement comme l’antre des trois Khan (Salman Khan, Aamir Khan et Shah Rukh Kan, acteurs et producteurs) et produisant un cinéma d’évasion, dépeint des fresques flamboyantes en y plaçant, de plus en plus, les femmes sur le devant de la scène. Le cinéma tamoul dit commercial, côtoyant les sphères politiques du Tamil Nadu, s’incarne souvent dans des films davantage « réalistes »,« sociaux » où le héros masculin est vénéré. (D’ailleurs, vénération oblige si vous êtes une star de cinéma, du nord comme au sud, vous avez toutes vos chances pour briguer le poste de ministre en chef d’un des 28 états indiens. Jayalalithaa et N. T. Rama Rao attestent de ce parcours sous les feux de la rampe.) Le cinéma du sud est de même connu pour ces techniciens hors pairs et ces « petits budgets »face aux tournages pharaoniques du nord. Néanmoins, Endhiran fit démentir cette tendance en atteignant en 2010 des sommes colossales de production. Sur les terres de la « Superstar» Chiranjeevi, toujours au « sud », là où l’on s’exprime en télougou, les innovations techniques et narratives de ce cinéma, l’ont établi ces dernières années, comme fournisseur officiel de matière à remakes.
Influences communes et similitudes
Certes, ils existent des différences mais l’industrie cinématographique indienne, nord et sud confondus, se fonde sur des influences communes telles que sur les écrits du Mahabharata ou du Ramayana. Le percutant Agneepath, sorti début 2012, dresse ainsi des parallèles avec le Ramayana. D’autre-part, suivant des préceptes anciens, l’acteur indien est avant tout vecteur d’émotions. L’approche du jeu du comédien diffère ainsi de celui des occidentaux. Enfin, du nord comme au sud, hérité du Sangeet Natak et de bien d’autres théâtres indiens, on trouve un type de film unique au sein de leur cinéma commercial avec le masala. Incarnation de la culture indienne, le masala mêle les genres avec panache. Action + Comédie + Romance + Drame (ou Mélodrame) = Un Masala d’une durée approximative de 2h30 à 3h00 (la durée a tendance à se réduire). Le tout est souvent entrecoupé de six interludes musicaux chorégraphiés et de l’incontournable« intermission » marquant une pause. Il existe de même une structure définissant le masala, mais celle-ci présente toujours des variantes et des subtilités pour chaque cinéma. Sa musique, ses danses, ses costumes, son comique… changent sensiblement. Au sud le dappa et le port du lungi sont ainsi roi tandis qu’au nord l’humour potache tend à s’effacer. Néanmoins le masala a la particularité d’avoir un contenu souvent moraliste et présente parfois des facéties et une absence de logique qui peut perturber le spectateur occidental. Le masala reste le film de divertissement par excellence en Inde ! Une valeur sûre, 100% paisa vasool !
Une évolution nette
D’autre-part, lorsque l’on évoque le cinéma indien actuel 1998 reste une date importante. Elle marque en effet l’accord du gouvernement à donner le statut d’industrie à son cinéma. Le financement des films change ainsi avec des nouvelles closes fixées en l’an 2000. Avant cela, les fonds viennent du secteur privé ou de la mafia. Depuis cette« révolution » la production et la distribution de film à l’étranger sont facilitées. Les producteurs du cinéma commercial ciblent ainsi de plus en plus les expatriés indiens devenus une nouvelle manne financière non négligeable. Le cinéma indien a depuis muté et prend de nouvelles directions. La narration, les genres subissent des expérimentations le menant vers de nouveaux horizons. Des sujets audacieux, séditieux et auparavant tabous prennent d’assaut le contenu des films. De même, la langue évolue. L’incorporation de l’anglais aux langues indiennes a vu fleurir de nombreux dialectes se substituant au télougou avec le tenglish ou l’hindi avec l’hinglish. Le cinéma commercial indien, élargissant son audience et s’adressant ainsi aux NRI (Non résident en Inde) et à la jeunesse, a vu le fond et la forme de ses films se transformer.
La diversité culturelle, l’impact d’écrits sacrés ou encore des arts (à l’instar des théâtres indiens ou même du cinéma hollywoodien) ont ainsi influencé considérablement l’industrie du film indien. Depuis, son changement de statut, son ouverture sur le monde et la mondialisation rampante ont certes atteint cet art mais n’ont en aucun cas réussi à ébranler ses caractéristiques. Ce cinéma continue à se redéfinir à l’image de sa production de 2011.
Après cet « abrégé », on peut enfin rentrer dans le vif du sujet !
Retour sur la production 2011
Cette année laissait présager de l’épique, avec des aventures où s’entrecroisent avec subtilité passion et grenades flambées ! Suspens et excitation étaient à leur acmé, après une année 2010 riche en gourmades, avec la satire corrosive Tere Bin Laden , le drame social Udaan, les « déboussolants » et magnifiques Raavan et Raavanan, l’intemporel et énigmatique Ishqiya, le masala décérébré Dabangg ou encore le contemporain Band Baaja Bhaaraat concocté dans les vieux chaudrons du cinéma hindi. Comédie scissipare, romance tarabustée, thriller au jasmin ou films hybrides parsemèrent de nouveau la production de 2011. Mais il fallut arpenter des hectares de pellicules pour les débusquer.
2011 fut une année riche, mais avant tout excessivement prospère en remakes, nouveaux seigneurs du box office !
Les remakes
Comme chaque année, l’Inde pratique le remake avec zèle. 2011 n’échappe guère à cette tradition.
Salman Khan, acteur incontournable du cinéma hindi, a ainsi œuvré dans deux remakes, issus de l’industrie du sud, avec Bodyguard (Malayalam) et Ready (Telugu) films déjà réadaptés à maintes reprises. Ces deux « œuvres » ont supplanté toutes celles de la production hindi en 2011, en terminant sur les deux plus hautes marches du box office, mais le rendu est loin d’être concluant. Néanmoins, avec un climax dantesque et larmoyant, Bodyguard, contentera les glandes lacrymales des amateurs de mélo. Mais avant cela, il faudra endurer des scènes d’actions et de comédies poussives. Par ailleurs, si vous êtes intéressés par la version indienne de I am Sam (2001, USA, de Jessie Nelson avec Penn et Pfeiffer) ruez-vous sur sa refonte tamoule Deiva Thirumagal. Vous y croiserez un acteur phénoménal : Vikram.
En dehors de ces films, une kyrielle eut le droit à une métempsychose à l’instar de Singham (remake hindi du film tamoul Singam), Osthe (remake tamoul du film hindi Dabangg), Vaanam (remake tamoul du film telugu Vedam), ou encore Siruthai (remake tamoul du film telugu Vikramarkudu). En bref, si vous visionnez un film indien et qu’il vous en rappelle un autre ne chercher guère. Vous l’avez certainement déjà vu ! Les fées de l’adaptation indienne guettent toujours à l’affût de bons scénarios.
Les remakes en Inde ont ainsi un bel avenir, en devenant des valeurs sûres, accumulant des sommes phénoménales au box-office. Pour preuve, l’excellent 3 idiots qui engrangea, en 2009, des recettes colossales, le consacrant film le plus lucratif de l’histoire du cinéma hindi, vient d’être réincarné en Nanban. Une version tamoule sortie en janvier 2012.
Les tendances au nord (Production hindi)
Les Femmes prennent le pouvoir
Cela fait quelques années que les femmes commencent à prendre du galon et à ne plus jouer les Sancho Panza dans les productions hindis. Rani Mukherjee et Vidya Balan ont piétiné allégrement cette étiquette de simple faire-valoir, tout comme leur rang de co-star. Cette année, elles endossèrent de beaux premiers rôles. Mais, cela serait mentir que de ne pas reconnaître que le cinéma indien donne une place de choix aux femmes. Cependant, elles sont souvent cantonnées à interpréter des mères (Radha dans Mother India (1957), des femmes idéales (Paro dans Devdas), des vamps (Helen Richardson Khan et ses numéros mémorables dans les années 60/70), des courtisanes (à l’instar de la performance de Meena Kumari dans Pakeezah (1972)), des prostituées (Chameli, 2004), des déesses ou encore des femmes serpents (Nagina, 1986). Ces rôles figurent parmi les plus exploités à l’écran. Certes, des réalisatrices indiennes, comme Deepa Mehta, ont su briser cette norme. Mais elles ne sont pas les seules. Les réalisateurs Mani Ratnam ou encore Vishal Bhardwaj vont à l’encontre de ces images d’Epinal en dépeignant des femmes indépendantes. Toutefois, les films arborent une dominante masculine récurrente. Et pourtant, un nouveau souffle remanie cette tendance. Les actrices se battent pour des rôles tels que ceux que campait jadis Madhuri Dixit, ébouriffante en femme bafouée puis vengeresse, dans Anjaam (1994). Les rôles percutants, en dehors des sentiers battus, sont ainsi recherchés activement.
Les actrices indiennes ont, de nos jours, une appétence féroce et comptent bien régner seules. Les stars masculines passent ainsi à la trappe tandis qu’elles œuvrent à des minis coups d’état. Et cette année, des longs-métrages ont confirmé cette tendance en osant afficher des actrices dans le rôle titre. No one Killed Jessica met en scène le combat d’une journaliste (Rani Mukherjee) pour révéler l’assassin d’une jeune femme. The Dirty Picture s’inspire de la vie de l’actrice Silk Smitha (jouée par Vidya Balan), icône sexuelle, qui fit parler ses courbes dans des productions du sud. 7 khoon Maaf retrace l’existence d’une femme (Priyanka Chopra) ayant les effets d’une mante religieuse sur ses époux. Des héroïnes au tempérament de feu, s’affranchissant de la gente masculine et réussissant à générer des entrées au box office, fut la grande surprise de cette année.
Autre observation notable, parmi la gente féminine, c’est l’ascension d’une productrice et de deux actrices. En produisant cette année Ragini MMS, The Dirty Picture et Shor in the city, Ekta Kapoor se place comme une des personnes clefs de l’industrie cinématographique actuelle. Elle ose s’attaquer à des sujets qui ne sont guère porteurs ou sulfureux et les propulser sur le devant de la scène. La marque de fabrique d’Ekta se définit par une qualité de film au style et au contenu non conventionnel usant certes des ficelles du cinéma commercial hindi. Elle se démarque de même en ne ciblant pas les masses mais une niche de marché. Résultat, elle fait mouche en rencontrant les attentes d’un public précis. Ainsi, The Dirty Picture (film destiné à un public adulte) et le film d’horreur Ragini MMS (dans la veine de Paranormal activity) ont conquis les salles par leur disparité affichée.
Outre Ekta Kapoor, l’année 2011 fut sous les auspices de Vidya Balan, la téméraire. The Dirty Picture et No one killed Jessica l’ont sacralisée par ses aptitudes à camper avec panache des protagonistes inattendus. Celle-ci est devenue à juste titre une des actrices les plus convoitées. Si Vidya impressionne, une autre actrice extrêmement populaire, mais au jeu à équation variable, a, cette année, fait des étincelles. Il est en effet enthousiasmant d’assister à l’efflorescence d’une artiste. La carrière et les interprétations de Katrina Kaif ont sensiblement évolué. Naguère reléguée à des rôles insipides, elle s’affirme à présent de film en film. Depuis le thriller New York (2009) et le drame politique Raajneeti (2010), elle a brillamment mûri. Elle commence enfin à décrocher des rôles ayant une substance. Mais surtout, le sens du timing et de la comédie apparaît dans son jeu. Dans la sympathique comédie Mere Brother Ki Dulhan, où un jeune homme part à la chasse à la mariée et tombe amoureux de sa future belle-sœur (Katrina Kaif), elle prouve avec conviction qu’elle peut incarner des personnages pleins de fougue sans tomber dans la caricature. Elle réitère cela dans Zindagi na milegi dobara, un road movie sur la quête de soi. Katrina Kaif s’affirme ainsi comme l’actrice montante à suivre. En espérant, qu’elle ne se fourvoie plus dans des rôles sans lendemain.
Les réalisateurs prometteurs
MMXI fut sous le signe des Akhtar. La grande sœur Zoya réalisait Zindagi na milegi dobara tandis que son frère Farhan œuvrait sur Don 2, film d’action suivant les tribulations du mémorable gangster Don. Chacun auteur, leurs films possèdent une esthétique particulière et surtout une écriture. L’un et l’autre travaillant ensemble sur leurs projets respectifs, leurs films se font ainsi parfois écho. Zindagi na milegi dobara rappelle le film culte Dil Chahta hai (2001, Farhan Aktar) avec sa thématique du passage à l’âge adulte et un questionnement intérieur. Contrairement à son frère qui compte à présent un répertoire de films à son actif, Zoya Akhtar confirme surtout avec son deuxième long-métrage les espérances formées sur sa carrière de metteuse en scène.
Si les Akhtar mènent le bal, question réalisation, la relève ne se fait guère attendre. Une escouade de réalisateurs, au sang neuf, marche sur leur trace en venant réinjecter de la vigueur au cinéma indien. Ils étaient nombreux cette année à passer derrière la caméra pour la première fois : Bejoy Nambiar (Shaitan), Nupur Asthana (Mujhse Fraandship Karoge), Nila Madhab Pandya (I am Kalam) ou encore Abhinay Deo (Game et Dehi Belly). Ceci dit, on retiendra les noms de Kiran Rao pour Dhobi Ghat (ancienne assistante à la réalisation d’Ashutosh Gowariker)et celui d’Amol Gupte pour Stanley Ka Dabba qui ont réussi avec des films à petits budgets, à se démarquer en distillant avec simplicité et élégance des réalisations soignées et investies d’une âme forte. On attend hâtivement leur retour derrière la manivelle pour y dévorer, avec panache, de la bobine.
Une vague de films pour la jeunesse urbaine
Une mouvance grandissante se confirme d’année en année : La production de films ciblant la jeunesse des mégapoles indiennes. Phénomène tout à fait normal et inéluctable lorsque l’on étudie la démographie de l’Inde ! Un des initiateurs, le producteur Ronnie Screwvala a notamment participé à renverser la donne avec des œuvres telles que Rang De Basanti (2006), Dev D (2009) ou Kaminey (2009). Anurag Kashyap, réalisateur du thriller That Girl in Yellow Boots, figure, de même, parmi les notables instigateurs de ce courant qui tend à se sédentariser. Cette année, il y a contribué en produisant Shaitan mettant en situation un groupe de jeunes, égarés, passant leur journée sans but à se droguer. L’histoire bascule suite à un accident de voiture laissant sur le macadam deux cadavres fraîchement fauchés. Déroutant, ce film à la gageüre de traiter des démons intérieurs sur fond de crise d’une génération perdue. Shaitan présente de nombreux artifices mais reste à voir pour sa séquence phare, celle dites de Shomu. Flasback dans un flashback, cette mise en abyme délirante met en scène Rajat Barmecha, la révélation d’Udaan (2010), dans un caméo innovant et virevoltant.
En dehors de ce type de film, où l’on troque le saree pour un jeans, la kurta pour le tee-shirt, la burka pour une mini jupe et où le trash prime sur la guimauve et l’irrévérencieux sur le contenu, on a eu moult films destinés à la jeunesse. De nombreuses productions, de cet acabit, furent ourdies par l’écurie Yash Raj, se révélant drôles et inventives. Ladies vs Ricky Bahl, une comédie romantique agréable, narre les tribulations de trois filles arnaquées par un gredin des petits chemins. Celles-ci s’unissent afin de fomenter un plan des plus diaboliques. On est très loin du fade John Tucker Must Die dont le synopsis s’inspire. Le divertissement en demi-teinte, Mere Brother Ki Dulhan, scalpé par un scénario en dent de scie, mais porté par un casting efficace, propose une trame narrative des plus rocambolesques. Les plans les plus fous sont échafaudés afin de faire basculer un mariage. Enfin, un autre film ciblant adolescents et jeunes adultes, Mujhse Fraaandship karoge a révélé un tout nouveau studio, Y-Films, lié à la société Yash Raj et à Aditya Chopra. Ce studio qui se désigne comme LA maison mère de films créée par des jeunes et à destination des jeunes – tout un programme ! – a ainsi présenté une romance ficelée par l’intermédiaire de l’interface Facebook.
Les futurs cinéphiles ont eu de même le droit à des films. Salman Khan a frappé un grand coup en coproduisant Chillar Party. Dans la veine de La guerre des boutons (1961, France, Yves Robert) ou de Pasanga (2009, Tamil, Pandiraj), certes divergeant et singulier, des enfants se mobilisent et s’inscrivent dans « le combat citoyen » en tentant de sauver un chien contre son euthanasie imminente. Ils essayent ainsi de recueillir des votes et de trouver une parade pour sensibiliser les médias puis l’opinion. Un petit film surprenant et sympathique.
Constellation de films de gangsters
Du nord comme au sud, le film de gangster, égaye des jours heureux. Certes, là où les serpettes ne fleurissent pas à chaque scène de combat, à comprendre dans le cinéma hindi, une armada a secoué les tentures indiennes. Saheb, Biwi aur gangster, Yeh Saali Zindagi ont réinvesti les plates bandes du genre, souvent de manière loufoque et détournée. Mais, d’autres ont misé sur une ambiance et une esthétique à l’image de Shabri. Petit film noir suivant la montée d’une femme dans les sphères de la pègre. Hormis un record de baffes en exergue, la mise en scène soulignée par une musique occidentale originale vaut le détour. Esha Koppikhar (l’actrice vedette), saisie par un cadrage soutenu et efficient, est méconnaissable en apprenti gangster. La conscience du plan, indéniable, reste la grande force de ce film. Quant à Shor in the city, une narration éclatée saute de prime à bord. Construit autour d’une pléiade de personnages principaux, on suit ainsi leurs combats pour survivre, s’implanter ou simplement vivre dans la jungle de Mumbai. Résidents et criminels se côtoient. Les destins de ces protagonistes se croisent, puis s’entremêlent au gré d’une multitude d’histoires fusionnant en une. Shor in the city reste l’un des films inspiré de cette année nous projetant avec malice et sarcasme dans le chaos de la jungle urbaine. Le film de gangster sous toutes les formes ou s’immortalisant en sous genre s’est dispersé et propagé dans de nombreuses productions. Vecteur comique, satirique, stylistique… Le crime ne paie peut-être pas mais devient après le masala, un des grands genres peuplant le cinéma indien.
Nouvelles du sud (Production tamoule & Co)
Si l’année fut palpitante au nord, elle fut tout aussi haletante au sud.
Année sous le signe de Dhanush
L’année fut faste pour l’acteur Dhanush. CNN estampilla sa chanson Why This Kolaveri Di (écrite pour le film tamoul, 3, sortie en 2012) comme étant le morceau le plus populaire de l’an 2011. Il se distingua, de même, par ses performances en tournant, une nouvelle fois, sous la direction de son frère, Selvaraghavan. Intitulé Mayakkam Enna, ce long-métrage s’inscrit dans la continuité des œuvres réalisées par son ainé où les thématiques de la passion et de la jeunesse y sont itératives. A l’instar des personnages que Dhanush incarnait, dans Pudhupettai (2006) ou Kaadhal Kondein (2003), il campe un être tourmenté mais aux antipodes de ceux-ci. Ici, son personnage s’escrime coûte que coûte à devenir photographe animalier. Hélas, son parcours semé d’embûches, le confronte aux aléas et drames de la vie. Mais les Lauriers et louanges s’amoncelèrent, pour Dhanush, après la sortie d’Aadukalam. Un drame réaliste qui estourbira ou enchantera au choix. Le combat de coqs sert de toile de fond pour révéler le comportement et les conflits qui animent les propriétaires des gallinacés. Les antagonismes entre les hommes, tiraillés entre amitié, jalousie ou trahison restent les véritables sujets du film. Dhanush y interprète un apprenti éleveur de coqs s’en amourachant pour une anglo-indienne. S’exprimant dans le dialecte de Madurai et adoptant le langage corporel de ses habitants, Dhanush a ainsi bluffé le Tamil Nadu par son interprétation plus vraie que nature.
Les films originaux créent la surprise
Autres films, autres destins. Si Aadukalama fait l’unanimité, les autres colosses du cinéma tamoul n’ont pas vraiment brillé. 7 Am Arivu n’a pas convaincu. Dans ce thriller de science-fiction, un acrobate de cirque apprend qu’il est le descendant d’un moine bouddhiste et de surcroît, grâce à son précieux ADN, il est le seul à pouvoir enrayer une guerre biologique amorcée par la Chine. Dit comme cela, ça laissait augurer un masala des plus karmiques ! Au final, on eut le droit à un film dynamité par des scènes d’actions, rivalisant d’originalité entre rickshaw volant et combat à coup de lancé de tronc d’arbre. Mais le tout se désincarne malheureusement trop souvent par des accélérations malhabiles de ces séquences en postproduction. La mise en scène s’embourbe, de même, par ses écueils narratifs. Néanmoins, la fin de ce divertissement reste étonnante et rappelle grossièrement celle de The Great Dictator (1940, Chaplin). En effet, le final nous présente un agrégat de messages disparates à destination des masses. On se retrouve tout d’un coup plongé au sein d’un film éducatif voire propagandiste. En dehors de certains messages sur la persécution des tamouls au Sri Lanka, l’acteur principal, face caméra, explique l’importance du savoir et des sciences, l’usage de la médecine et non de la religion, en cas de maladie ou encore, souligne le fléau qui condamne l’Inde par la fuite des cerveaux du pays. Un pêle-mêle extravagant, désordonné et maladroit, à l’image du film, mais malgré tout captivant. Assurément la palme du salmigondis suprême !
Les sensations de 2011 venaient d’ailleurs. Les films, défiant la catégorie des mastodontes, furent des poids plume chargés d’un contenu réaliste et d’une fraîcheur scénaristique. Parmi les longs-métrages qui valent le détour, on trouve எங்கேயும்எப்போதும்,ஆரண்ய காண்டம் ou encore அழகர்சாமியின்குதிரை ! Sous ces cursives et déliés, ça ressemble à du klingon ou du na’vi, mais non, c’est bien du tamoul ! On a donc Engeyum Eppodhum, Aanranya Kaandam ou encore Azhagarsamiyin Kuthirai.
Engeyum Eppodhum fut l’œuvre phare tamoule de 2011. Un accident d’autocars et deux histoires d’amour se croisant sont narrés sous différentes unités de temps. L’une se déroule en une journée, l’autre sur des mois. Le film débute par la collision des deux bus pour conter au travers de flashbacks, les histoires sentimentales de quatre personnages impliqués dans l’accident. N’importe où, n’importe quand (traduction approximative du titre) c’est la symbolique du film qui s’affaire à nous présenter une ode à la vie quotidienne et à ses imprévues. M.Saravanan, ancien assistant d’A. R. Murugadoss (le réalisateur de 7 am Arivu) capture avec quelques failles mais beaucoup de sensibilité des instants de vies. Dans un autre style, Aaranya Kaandam, un néo-noir bien sanglant se distingue par une excellente musique signée Yuvan Shankar Raja et un savoir-faire qui font sa spécificité et son intérêt. Enfin, un conte moderne tournant autour d’un village et des rituels de son temple créa la surprise avec Azhagarsamiyin Kuthirai. Un cheval et un personnage atypique (Azhagarsamy) deviennent les héros de cette fable où la condition humaine et ses superstitions sont saisies de manière réalistes. En somme, cette année, le cinéma tamoul nous gratifia d’œuvres marginales singulières.
De la diversité et du décalage
Là où l’on parle le malayalam, le mot d’ordre fut la différence et l’audace. Santosh Sivan nous concocta un Urumi bien étrange. Un film, mêlant histoire et fantastique avec un vil et fou Vasco de Gama. Malheureusement le tout trop dissonant reste indigeste. On retiendra par contre Adaminte Makan Abu. Un couple de vieillards musulmans rêve de se rendre en pèlerinage. Ils tentent ainsi d’entreprendre les démarches pour concevoir ce voyage. Les cadrages et la photo du film sont sublimes. Malheureusement, trop de bons sentiments sapent son contenu.
Les télougous nous firent la primeur d’une prise d’otage d’un aéroplane avec Gaganam. Des terroristes y exigent la libération de leur leader, un fringant barbu, nommé Yusuf Khan, contre un avion rempli d’un panel représentatif de la population indienne. Ce thriller s’avère être techniquement quasi irréprochable. Mais, somme toute, le ton didactique et la présence de certains personnages extrêmement moralisateurs et nationalistes le torpillent. Pilla Zamindar, repris d’un film coréen (A Millionaire’s first love, 2006), nous fait le bonheur de dynamiter les comédies traditionnelles en se gargarisant de second degré à outrance. Rien que pour ce rare décalage, le film reste à voir.
Voilà pour le condensé de l’année en Inde. Certes, si vous souhaitez vous plonger dans de bons films retrouvez la semaine prochaine la liste de ceux qui ont marqué de leur empreinte, voire de leur superbe, le cinéma.
Marjolaine Gout.




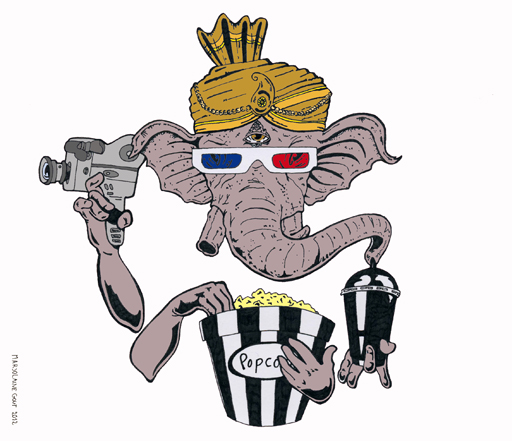
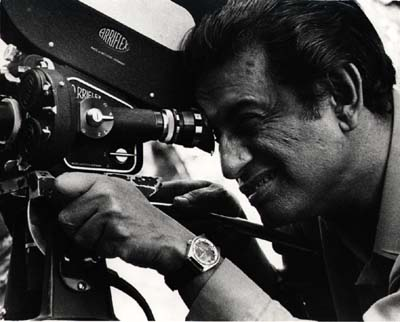














 Suivre
Suivre












