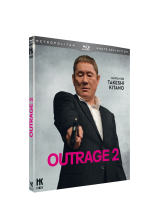Alors que le FICA de Vesoul diffuse son Syngué Sabour, retour sur notre entretien avec Atiq Rahimi.
Votre premier film, Terre et cendres, date de 2004. Votre second, Syngué Sabour de 2012. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps avant de revenir au cinéma ?
Chaque film me donne l’occasion de voyager pendant un voire deux ans pour sa promotion. J’ai également d’autres activités comme l’écriture. À chaque film, j’aimerais me lancer dans l’écriture et la photo. Pourtant, j’avais pas mal de propositions. En 2007, je devais tourner en Inde un film basé sur une nouvelle, Rabîndranâth Tagore, co-écrit avec Jean Claude Carrière. Mais on a raté la saison de la mousson où devait se tourner 20% du film, alors je me suis lancé par frustration dans l’écriture. Le livre Syngue Sabour est sorti en 2008 et a gagné le prix Goncourt, occasionnant deux ans de voyage. Après le succès du livre, les producteurs ont été intéressés par l’adaptation au cinéma. Jean Claude Carrière m’a convaincu de faire le film grâce à l’univers cinématographique du récit.
Comment avez-vous rencontré Jean Claude Carrière ?
On se trouvait en Inde en 2005 pour parler aux étudiants sur le rapport entre la peinture et le cinéma, ainsi que sur la question de l’adaptation de mon livre Terre et Cendres. Jean Claude Carrière était invité pour une Master Class et on a eu une belle rencontre. On a tout de suite travaillé sur Kabuliwala qu’on devait tourner en 2007. Cela s’est très bien passé, nous avons beaucoup de points communs. Il connaît très bien l’Inde, le Pakistan, l’Afghanistan et l’Iran avec sa femme iranienne adepte de la littérature et culture persane. Pour moi, c’est un monument dans l’histoire du cinéma. Il aime ce que j’écris et réalise dans le cinéma. Nous avons deux autres projets en chantier. C’est quelqu’un qui a une manière de trouver la clef dans un récit pour l’adapter au cinéma.
Vous adaptez de nouveau l’un de vos romans. Le passage par la littérature vous semble-t-il nécessaire pour arriver au cinéma ?
Le cinéma a besoin de raconter une histoire. La base, c’est le récit. Chaque histoire a besoin de mots pour être racontée. Même le cinéma le plus pur, qui ne veut pas d’un scénario, est obligé d’avoir une idée narrative. Plus on adapte, plus la narration est présente comme point de départ. Le cinéma a sa manière de raconter une histoire. Quand j’écris, j’écris avec mon inconscient. Mes personnages m’échappent pendant l’écriture, je n’arrive plus à les contrôler. Dans le cinéma, on ne peut pas le faire, il me permet de mieux connaître l’histoire que j’ai racontée dans mon roman. Je filme pour savoir pourquoi j’ai écrit cette histoire. Aussi parce que j’aime mes personnages, c’est par amour pour mes personnages que je réalise des films. Je leur donne une autre vie, une autre manière d’être, une chair, un regard, un esprit.
C’est surtout Golshifteh Farahani qui donne corps aux mots du film. Comment l’avez-vous choisie pour Syngué Sabour ?
Au début, c’était un grand problème de trouver une actrice persanophone capable de jouer ce rôle aussi bien politiquement qu’artistiquement. Dans le désespoir total, j’ai rencontre Golshifteh Farahani chez Jean Claude Carrière. Je l’ai vu, une très belle actrice. Mais je ne voulais pas m’arrêter uniquement à sa beauté. Au contraire, elle me faisait peur, peur qu’elle prenne le dessus sur le personnage. Il m’a fallu un certain temps pour me convaincre, j’ai fait de nombreux essais. Elle m’en veut toujours pour cela d’ailleurs (rires). Quand on a commencé, je lui ai dit que le travail d’une scénariste et d’un écrivain était de mettre les personnages dans la merde et aux comédiens de les en sortir. Je lui ai donné ce personnage tout en lui demandant de ne pas tomber dans un jeu ou pour sortir ses états d’âme dans un personnage donné en jouant des situations. Je cherchais des émotions très complexes. En littérature, la complexité des personnages tombe dans l’explication alors que dans le cinéma non. Je voulais capter les contradictions entre le regard, les mots, le temps et le geste du comédien en dessinant une palette de complexité.
J’ai vu des films où elle jouait qui exigeait d’elle un personnage avec une évolution émotionnel unique alors que dans mon film c’était le contraire. Dans le même plan et une même phrase, elle devait jouer plusieurs dimensions de son personnage. Elle a également travaillé sur sa voix. Au début du film, elle devait parler avec une voix nasale et, petit à petit, cette voix descend pour devenir très grave comme si elle sortait de ces tripes. Cela nous a permis de caractériser les moments précis du film et ceux où elle doit faire volte face. On a travaillé beaucoup en amont sur le personnage, et comme elle est d’origine iranienne, elle possède un autre accent. Elle a dû apprendre l’accent afghan sans tomber dans l’imitation. Il lui a fallu 2-3 mois pour incorporer des expressions précises afghanes. C’est cela le génie d’une actrice de jouer toute cette complexité.
Le parcours du personnage féminin rappelle celui du Soldat-dieu de Wakamatsu d’après Edogawa Rampo. L’avez-vous vu ?
Oui, j’ai d’ailleurs eu très peur, puisque quand le film est sorti, je travaillais déjà sur Syngué Sabour. Mais il y a de nombreuses différences, puisque dans mon film, le mari est paralysé, on ne sait rien de ce qu’il pense ou entend. L’ouvrage de Rampo, La Chenille, surtout a été determinant. Il y a aussi Johnny Got His Gun, qui est inspiré de la nouvelle La Chenille. Parmi les références que j’avais dans un coin de ma mémoire, il y avait aussi L’Empire des sens d’Oshima. Et cette caméra qui était très basse était aussi une référence à Ozu. J’ai rendu également hommage à Wong Kar-wai avec un ralenti et une musique qui sont les marques de fabrique de ce grand cinéaste. La grande influence était le court-métrage La Main de Wong Kar-wai. Non seulement c’est le chef-d’œuvre du cinéma de Wong Kar-wai mais également du cinéma mondial. Pour Terre et cendres, il y avait beaucoup d’empreintes et de clins d’œil au cinéma japonais comme Kurosawa avec le personnage du vieillard, le silence ou le cadrage.
Propos recueillis par Victor Lopez à Deauville le 7/03/2013.
Merci à toute l’équipe du Public Systeme Cinema, et plus particulièrement à Agnès lLroy pour avoir permis cette rencontre.
Synguée abour de Atiq Rahimi, projeté lors du Fica de Vesoul 2014 du 11 au 18 février.
Pour plus d’informations sur le film (et ses scéances).
Pour plus d’informations sur le festival.
LE FICA de Vesoul 2014 sur East Asia :
Édito preview : d’un festival à l’autre
Entretien : Martine Thérouanne, directrice du festival
Entretien : Brillante Mendoza pour Sapi
Cinéma philippin : rencontre avec Eugene Domingo (actrice) et Joji Alonson (productrice)
Critique : Qissa d’Anup Singh (Visages des Cinémas d’Asie Contemporains)
Entretien : Anup Singh, réalisateur de Quissa
Critique : Leçons d’harmonie d’Emir Baigazin (Avoir 20 ans)
Entretien : Atiq Rahimi réalisateur de Syngué Sabour (Carte Blanche de nos 20 ans)
Critique : Vertiges de Bùi Thac Chuyên (Francophonies d’Asie, le Vietnam)
Critique : L’Hirondelle d’or de King Hu (La Carte blanche de nos 20 ans)
Critique : Thy Womb de Brillante Ma. Mendoza (Regard sur le cinéma philippin)
Critique : Like Someone In Love d’Abbas Kiarostami (La carte blanche de nos 20 ans)
Critique : Les Enfants de Belle Ville d’Asghar Farhadi (Avoir 20 ans)
Critique : Poetry de Lee Chang-Dong (La carte blanche de nos 20 ans)
Critique : Chungking Express de Wong Kar-Wai (La carte blanche de nos 20 ans)









 Suivre
Suivre