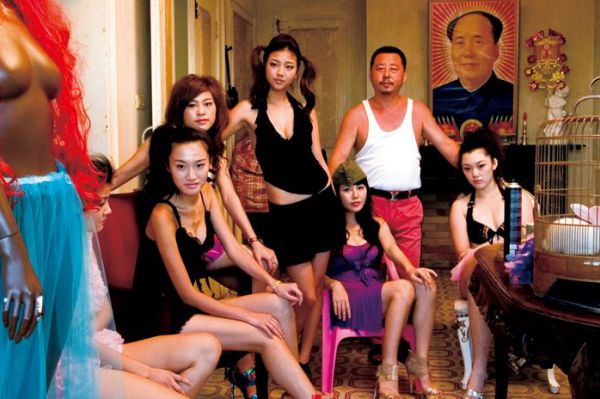Avec The Ugly, Yeon Sang-ho transforme l’enquête sur la disparition d’une femme à la fin des années 70 en une démonstration sur la lutte entre le bien et le mal et l’éternellement recommencement de l’histoire. Un film qui s’inscrit parfaitement dans l’œuvre du réalisateur sud-coréen, et qui était à voir au Festival du Film Coréen 2025.
The Ugly est une adaptation de Visage, une bande dessinée de Yeon Sang-ho publiée en 2018. Dans la Corée contemporaine, une équipe de télévision réalise un reportage sur le parcours étonnant de Yeong-gyu, aujourd’hui sexagénaire, un aveugle de naissance et artisan célébré pour la qualité de son artisanat : la gravure de sceaux. Malgré son handicap, il s’est sorti de l’extrême pauvreté dans les années 70 et a même élevé seul son fils, Dong-hwan, aujourd’hui quarantenaire. Cette ascension sociale, « des haillons à la fortune » pour citer l’expression de Horatio Alger, est soudain remise en question lorsque la police découvre les ossements de la femme de Yeong-gyu, disparue quarante ans plus tôt. Aidé par l’équipe de télévision, Dong-hwan enquête pour savoir ce qui est arrivé à sa mère, qu’il n’a jamais connue et dont il ne connaît même pas le visage. Commence une plongée dans l’époque troublée des années 70, lorsque Yeong-gyu n’était qu’un artisan inconnu et sans le sou, survivant à Cheonggyecheon, le quartier de Séoul regorgeant de petites usines de textile.

The Ugly est le second film de Yeon Sang-ho distribué en 2025, après le thriller mystico-religieux Révélations, avant un film de zombies à sortir en 2026. Depuis 10 ans, pas une année sans un projet de Yeon : longs-métrages, séries TV ou scénarios pour des tiers. Depuis le carton de Dernier Train pour Busan en 2016, il évolue dans les hautes sphères de l’industrie cinématographique sud-coréenne, à coups de projets dispendieux parfois très lucratifs (la série Hellbound). Les argentiers du cinéma sud-coréen ont tellement voulu imiter et concurrencer Hollywood (et ils ont réussi) qu’ils en ont repris les travers : recyclage de concepts à succès, films insipides et creux portés par les mêmes figures archétypales sans singularité ni aspérité. Cela donne des pelletés de produits passables et banals, au mieux bien mis en scène et bien confectionnés (comme on réussit un plat en suivant scrupuleusement une recette de cuisine trouvée sur Marmiton), au pire des films ridicules écrits par et pour les algorithmes, aussitôt vus, aussitôt oubliés. Yeon fait partie des exceptions de cette industrie droguée aux tableaux Excel. Chacune de ses œuvres est singulière et s’inscrit dans le discours politique et artistique qu’il développe depuis ses premières œuvres animées de la fin des années 1990. Pour The Ugly, Yeon fait malgré tout un pas de côté : le film a été tourné dans l’urgence, en trois semaines, avec une équipe technique de vingt personnes et des acteurs payés au minimum syndical pour un budget total de… 120 000 €. Une anomalie qui montre notamment qu’emboutir des millions dans un film est une ineptie et un gâchis. Mais quand on sait que le budget faramineux d’un film est un argument de vente en soi…
Quel est donc le discours, le questionnement que tient Yeon depuis près de 30 ans ? Ni plus ni moins que le bien et le mal. Qu’est-ce qui pousse l’être humain a choisir sciemment le mal pour assouvir son pouvoir et asservir son prochain ? Pourquoi le mal domine-t-il le bien ? Une question qu’on peut juger prétentieuse et que Yeon aborde à la fois de manière métaphysique et très concrète. Métaphysique dans le court métrage The Hell: Two Kinds of Life (2006) et la série Hellbound (2021 et 2024), avec des humains confrontés à la cruauté surnaturelle et absurde d’anges exterminateurs. Concrète dans The King of Pigs (2011), The Fake (2013) ou Psychokinesis (2018) quand Yeon place ses personnages dans un microcosme de la Corée contemporaine : respectivement une école, un village et un quartier.
Chez Yeon, quand les personnages ne sont pas des pauvres gens ou des esclaves dominés par une caste qui assoit son pouvoir par la violence, ce sont des bêtes sauvages ou des monstres. On comprend mieux pourquoi il s’intéresse tant aux zombies ou aux êtres dotés de pouvoirs paranormaux. Cette monstruosité peut-elle être le vecteur d’un contre-pouvoir pour faire triompher le bien ? C’est le propos de Psychokinesis. Les croyances (ou plutôt superstitions) religieuses sont-elles aussi un contre-pouvoir… ou au contraire un moyen efficace de domination ? C’est le propos de The Fake, Hellbound et Révélations. Et le libre arbitre dans tout ça ? L’humain peut-il vraiment choisir entre le bien et le mal ? À quel point est-il maître de ses actions ? Pourquoi accepte-t-il la servitude volontaire ? On peut trouver simpliste et binaire cette distinction entre le bien et le mal mais l’histoire lui donne malheureusement raison.

Pour The Ugly, Yeon ne fait pas appel au surnaturel ou aux superstitions religieuses. La petite histoire de Yeong-gyu, l’artisan aveugle, s’inscrit dans la grande histoire politique de la Corée du Sud. Celle du régime dictatorial de Park Chung-lee des années 70, considérée uniquement comme un « miracle économique » et le terreau de la Corée contemporaine, démocratique. Dans son enquête pour découvrir qui était sa mère et comment elle est morte, Dong-hwan interroge cinq groupes de personnes qui l’ont connue : des membres de sa famille, des collègues de travail, sa contremaître, son ancien patron et, finalement, son propre père. L’histoire tragique de la mère disparue se dessine peu à peu dans des flashbacks où le jeune artisan aveugle des années 70 est interprété par le même acteur que son fils des années 2010 : Park Jeong-min. Une manière de souligner l’éternel recommencement. La cruauté, la veulerie et la laideur de l’humanité ne changent pas, elles se reproduisent d’une époque à l’autre. Le mal triomphe toujours du bien.
L’éléphant dans la pièce de The Ugly est cette similarité entre le régime dictatorial des années 70 et le régime démocratique actuel. C’est le même monde car composé des mêmes êtres humains. La violence des rapports humains est certes moins explicite aujourd’hui (l’extrême pauvreté a à peu près disparu et les conditions de travail se sont améliorées) mais elle est plus larvée et perverse. Façon de rappeler que, démocratie ou pas, quand on se penche sur la liste des derniers dirigeants de la Corée du Sud, on trouve un ancien PDG de Hyundai (soit l’un des conglomérats industriels qui a prospéré sous la dictature), au moins trois présidents condamnés pour corruption, détournements de fonds et abus de pouvoir, et un autre accusé d’avoir fomenté un coup d’État en voulant rétablir la loi martiale. Bonne ambiance. « L’enfer coréen », décrit et documenté depuis années, ne serait-il que la conséquence d’un système néo-féodal dirigé par une caste militaro-industrielle, financière et religieuse ? Pourquoi accepter cela ? On retrouve ici toutes les préoccupations de Yeon sur le vivre ensemble et l’harmonie entre humains, tiraillés entre le bien et le mal.
The Ugly s’inscrit totalement dans l’œuvre de Yeon Sang-ho, ici sans surnaturel ni effets spéciaux. Une histoire simple et didactique. Une démonstration sur les mauvais sentiments et le « mal humain », plus qu’une enquête.
The Ugly de Yeon Sang-ho. Corée. 2025. Projeté au FFCP 2025. Sortie en salles via KMBO en mars 2026.





 Suivre
Suivre