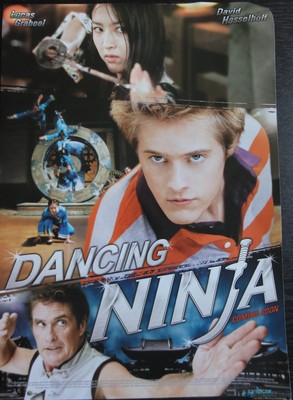Itim, Kisapmata, Batch ’81 : voici seulement trois titres de l’œuvre de Mike de Leon, réalisateur philippin qui a émergé dans les années 1970. Si ce nom vous est encore étranger, vous allez apprendre à le connaître car une partie de sa filmographie sort enfin dans les salles françaises.
Carlotta Films a annoncé la sortie en France, en 2022-2023, en versions restaurées, d’une partie des films de Mike de Leon, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et producteur philippin apparu dans les années 1970. Avec d’autres, comme Lino Brocka, Ishmael Bernal ou Marilou Diaz-Abaya, il a pavé la voie d’un cinéma philippin novateur, à la fois exigeant et populaire, dans une période politique tourmentée : celle de la prise de pouvoir du couple Ferdinand et Imelda Marcos qui a instauré, de 1972 à 1981, une loi martiale et un régime dictatorial, avant de fuir le pays en 1986.
C’est pendant ce laps de temps, de 1972 à 1986, que Mike de Leon est le plus actif, réalisant deux courts-métrages, sept longs-métrages et un documentaire. Il est bien plus rare depuis cette date. D’ici la fin de l’année, il doit publier ses mémoires, Last Look Back, qui sera sans doute un éclairage sans pareil sur sa carrière et le cinéma philippin.
En attendant la sortie française de ses films, revenons sur son parcours et l’importance de son œuvre. Épouvante, thrillers politiques, drames sociaux ou comédies romantiques et satiriques… quels que soient les genres abordés, Mike de Leon a réalisé parmi les plus films les plus importants des Philippines.
.
Héritage familial et Lino Brocka
.
Mike de Leon a baigné dès son enfance dans le cinéma. Et pour cause : sa grand-mère Narcisa de Leon a co-créé en 1938 la maison de production LVN Pictures, un des studios les plus importants des Philippines. Comme la MGM, LVN reprend les trois premières lettres de ses fondateurs : De Leon (L), Villongco (V) et Navoa (N). Narcisa de Leon devient rapidement l’unique dirigeante de LVN Pictures qui, dans les années 1950, sera un studio à succès, faiseur de stars et porté sur les productions populaires à grand budget, inspirées des mélodrames hollywoodiens. Dès 1961, en difficultés économiques, LVN Pictures arrête la production. Ce n’est que bien plus tard, entre 1977 et 1981, que LVN Pictures produira trois nouveaux films… de Mike de Leon.
Manuel de Leon, fils de Narcisa et père de Mike, est producteur de films. Après ses services pour LVN Pictures, il a fondé sa propre société, Diadem Pictures, à laquelle on doit en 1965 A Portrait of the Artist as Filipino de Lamberto Avellana, adapté de la pièce de théâtre à succès de Nick Joaquin (un nom qui réapparaîtra tout à l’heure).

Arrive donc Mike de Leon, la troisième génération de la famille à travailler dans le milieu cinématographique. Né en 1947, Mike étudie l’histoire de l’art à Heidelberg, en Allemagne. Sa fréquentation des salles de cinéma et son héritage familial développent son intérêt pour le septième art et, en 1972, il réalise un premier court-métrage, Sa Bisperas, apparemment jamais terminé. Il fréquente le milieu artistique de son époque, notamment Lino Brocka qui, en 1974, vient de réaliser son premier chef-d’œuvre, Tinimbang Ka Ngunit Kulang, succès à la fois artistique et critique. Brocka y développe l’approche qu’on lui connaîtra par la suite : un mélodrame aux références bibliques dans un village de campagne, avec ses aliénations religieuses, sociales et économiques, en même temps que le passage à l’âge adulte de son jeune protagoniste, un fils de bonne famille confronté à la cruauté du monde qui l’entoure. La même année, Mike de Leon fonde sa maison de production Cinema Artists Philippines. Il propose à Lino Brocka de produire et d’être le directeur de la photographie de son prochain film : Manille. Échec commercial à sa sortie en 1975, ce film est désormais considéré comme un sommet du cinéma.
Dans sa lancée, Mike de Leon réalise un deuxième court métrage, Monologo, aujourd’hui partiellement perdu. C’est la matrice de son premier long-métrage Itim comme il l’explique dans cet entretien pour le Festival de Cannes : « C’était une histoire de fantômes en hommage à Blow Up, le film de Michelangelo Antonioni, dans laquelle le personnage prenait des photos et ne réalisait pas qu’il avait capté une présence dans sa propre maison. J’avais particulièrement aimé l’idée d’aliénation existentielle qui imprègne Blow Up. En 1975, j’ai eu l’idée d’une histoire sans dialogues, ni effets spéciaux, qui se raconterait en quelque sorte au travers de l’appareil photo de son personnage principal. À cette époque, j’étais très enclin à réduire au maximum les dialogues. Plusieurs bobines entières du film n’en comportent d’ailleurs aucun. »
.
Itim : noir c’est noir
.
1976 marque l’entrée fracassante de Mike de Leon à la réalisation d’un long métrage avec Itim, projeté en version restaurée au Festival de Cannes en 2022. Itim (noir ou ténèbres en tagalog, langue officielle des Philippines) lorgne du côté de l’épouvante. À l’occasion d’un reportage sur la Semaine sainte en milieu rural, le photographe Jun Torres (Tommy Abuel) rencontre Teresa (Charo Santos), une jeune femme au comportement étrange, visiblement possédée par l’esprit de sa sœur aînée, morte plusieurs années auparavant. Attiré par le magnétisme et la beauté de la jeune femme, Jun va découvrir la vérité tragique de la mort de sa sœur. Une mort littéralement révélée par des photographies et des séances de spiritisme. Le clin d’œil à Blow Up reste léger et de Leon convoque plutôt l’ambiance et quelques éléments narratifs de Ne vous retournez pas de Nicholas Roeg et des Innocents de Jack Clayton.
Le jeu avec les codes de l’épouvante est évident : maison mal éclairée, sacrifice de poulet, une femme mystérieuse qui passe furtivement au second plan dans une scène angoissante, un secret de famille sur des morts suspectes… En catalyseur de cette épouvante, la chambre noire du photographe, c’est-à-dire sa propre dark room. Une première couche de révélation, à laquelle s’ajoute la Révélation religieuse puisque toute l’action se passe pendant la Semaine sainte avec, en point d’orgue, le Vendredi saint, soit la commémoration de la Passion du Christ (sa mort) et la foi en sa Résurrection. Itim mélange avec brio les rites catholiques et les pratiques plus ancestrales comme le spiritisme dont le but est de communiquer avec les esprits des morts.

Itim est une œuvre syncrétique à plusieurs titres : film d’auteur sur une thématique et un genre populaire, mélange de catholicisme et de croyances ancestrales, rencontre entre le monde rural traditionnel et la modernité urbaine, brouillage entre la Passion du Christ et la mise à mort d’une femme et, enfin, cet affrontement entre la lumière et les ténèbres. Ce dernier point nous donne des scènes de clair-obscur dignes d’un tableau du Caravage. Mike de Leon explique : « Dans mon esprit, l’obscurité était l’un des personnages majeurs du film. Avec mon chef décorateur, nous avons opté pour une palette de couleurs volontairement sombre. Le film a été tourné dans la maison ancestrale de ma famille et a été éclairé uniquement en post-production car l’éclairage était réduit à son minimum sur le tournage. »
Itim révèle Charo Santos qui deviendra l’une des actrices les plus populaires des Philippines. À noter : à l’international, le film est titré Itim, les rites de mai, ce qui est une erreur (reconnue par Mike de Leon). Tout le film se passe pendant la Semaine sainte, c’est donc Itim, les rites d’avril qu’il fallait titrer.
.
Vraie romance et espionnage musical
.
Mike de Leon poursuit en 1977 avec Kung mangarap ka’t magising (C’était un rêve, en français), une comédie romantique produite par LVN Pictures et dédiée à sa grand-mère Narcisa. C’est une romance entre deux stars montantes de l’époque révélées chez Lino Brocka : Christopher de Leon (Joey) et Hilda Koronel (Anna). Lui est un bourgeois, éternel étudiant de 24 ans qui ne sait pas ce qu’il veut faire de sa vie, hésitant sans grande conviction entre la musique et la biologie. Il est également en peine à la suite de la mort de sa fiancée. Elle est une mère de famille de 22 ans qui a sacrifié son adolescence avec son mariage soudain à 17 ans et la naissance de son fils. Leur brève rencontre à l’université va transformer leur vie.
C’était un rêve s’inscrit dans la vogue des comédies romantiques en milieu universitaire. Un genre qui permet de rire et de distiller une dose de mièvrerie sentimentale à peu de frais, avec en général un léger sous-texte socio-économique sur l’amour qui permet de transcender les distinctions entre les riches et les pauvres, tout cela dans un pays en voie de modernisation et tourné vers le loisir et la culture étasunienne (musique pop, mode vestimentaire post-hippie et culture des clubs).

De Leon pervertit ce bonbon sucré dans cette comédie douce-amère qui vire au mélodrame. Aux scènes de circonstance (pitreries des étudiants et scènes de dragues rythmées par des ballades sentimentales) répondent des moments introspectifs plus sombres comme les remises en questions existentielles de Joey sur sa condition de bourgeois et son mode de vie parasitaire ou les confrontations tragiques d’Anna avec son mari, un tyran phallocrate qui veut la réduire à un animal domestique et un écrin de beauté flatteur pour son amour propre.
En 1980, Mike de Leon revient avec un troisième long-métrage, là encore dans un style complètement différent. Après l’épouvante et la comédie romantique, Kakabakaba ka ba? (Frisson ? en français) est une parodie de film d’espionnage qui se termine en comédie musicale. Christopher de Leon et Charo Santos reprennent du service dans les rôles d’un musicien et d’une hôtesse de l’air embarqués dans le complot ourdi par des Japonais et des Chinois pour dominer les Philippines (et le reste du monde) par la vente d’une drogue dérivée de l’opium. Une version contemporaine et délibérément pop des enjeux géopolitiques du trafic de drogue et du rôle économique des Philippines dans l’Asie du sud-est. Le Japon est montré comme le pays technologique par excellence via la production de cassettes audio et autres gadgets high tech (rappelons qu’entre 1941 et 1945, les Philippines ont été envahies par le Japon, période terrible en pleine Seconde Guerre mondiale).

Comme C’était un rêve, Frisson ? met en scène des jeunes gens modernes urbains et cosmopolites, insouciants et tournés vers le loisir et la culture pop mondialisés. Ces jeunes gens sont musiciens et adeptes de l’amour libre et des drogues. Ils tournent en dérision l’Église, représentée en commerce comme un autre. Le ton est outrageusement léger et irrévérencieux. Le ridicule est la norme avec des incursions cartoonesques (notamment les incrustations visuelles de « pif », « paf », « pouf » dans la bagarre finale comme dans la série TV Batman des années 60) qui ne sont pas sans rappeler Tisoy! d’Ishmael Bernal (avec le même Christopher de Leon en acteur principal), adaptation du komiks à succès du même nom en 1977 (dans l’après Seconde Guerre mondiale, les Philippines sont l’un des premiers producteurs et consommateurs de bandes dessinées, souvent lues en séries dans des quotidiens ; c’est l’industrie des komiks).
.
Sous la mauvaise étoile de Marcos
.
En 1981 et 1982, Mike de Leon sort peut-être ses deux meilleurs films : Kisapmata et Batch ’81. Kisapmata est un film dramatique inspiré d’un véritable fait divers rapporté par Nick Joaquin dans son récit criminel The House on Zapote Street écrit en 1961. Terrible fait divers dans lequel un père de famille, ancien policier, a tué par jalousie sa fille et son beau-fils, avant de se suicider. Kisapmata est un film étouffant porté par la prestation magistrale et terrifiante de Vic Silayan dans le rôle de Tatang Dadong, père tyrannique, ancien policier véreux et ultra-violent, vaguement alcoolique, incestueux et jaloux du mari de sa fille. Une personnification du dictateur Ferdinand Marcos et de l’ambiance irrespirable du pays, profondément mortifère.
Lors de la projection du film au Festival de Cannes en 1982, Mike de Leon ne parle pas ouvertement de cette critique de Marcos (propos qui auraient pu être dangereux pour sa vie et sa carrière) : « L’authentique fait divers dont Kisapmata est inspiré m’a toujours fasciné, et ceci pour deux raisons. Premièrement, parce qu’il décrit les effets de la peur et de l’oppression sur l’institution la plus sacrée des Philippines, la famille et les valeurs qu’elle représente, à savoir la tradition, le respect et l’obéissance. Deuxièmement, il donne un aperçu de l’énorme complexe de culpabilité inhérent à la culture de la petite bourgeoisie qui est une conséquence de notre éducation profondément catholique. »

La moitié du film se passe dans la maison familiale, véritable prison entourée de fils barbelés où l’action se joue sur deux niveaux : le rez-de-chaussée avec ses simulacres de « réunions » et son téléphone, seule possibilité de communiquer avec le monde extérieur ; l’étage avec les chambres à coucher des parents et de la fille (sans verrou) qui sont tout sauf des lieux de sommeil et de plaisir. Étage ou rez-de-chaussée, tout est contrôlé par le père tyran. Les seuls moment de répit pour la jeune femme Mila (interprétée par Charo Santos) sont ceux où elle peut écrire son journal intime qui nous est lu en voix off. Même ses rêves sont imprégnés par sa séquestration et ses relations de maître / esclave, fille / amante / jouet sexuel avec son père.
L’étouffement du film est tel que même la scène de mariage, censée être un moment de joie et de liesse, est un moment de tension extrême où les invités sont à peine filmés. Au contraire, la danse traditionnelle avec son échange de partenaires renforce ce monde clos et incestueux : la mariée passe de mains en mains, entre son père, sa mère et son mari.
Notons enfin la musique toute hitchcockienne de Lorrie Illustre pour ce film aussi glaçant que Psycho. Kisapmata est un carton critique avec notamment 10 récompenses au Festival du film de Manille et 7 récompenses Gawad Urian (prix créés par le collectif de critiques Manunuri ng Pelikulang Pilipino).
Comme Kisapmata, Batch ’81 sera projeté au Festival de Cannes en 1982. Deux films d’un même réalisateur projetés la même année à Cannes, c’est assez rare pour le noter. Sans doute doit-on cette double sélection à Pierre Rissient, défricheur et promoteur du cinéma philippin en France, alors conseiller artistique du festival. C’est une nouvelle claque : brûlot contre le totalitarisme et la destruction des individus, Batch ’81 est à classer aux côtés de Salo de Pier Paolo Pasolini, Au nom du père de Marco Bellochio ou le manga (adapté au cinéma) de Furuya Usamaru et Ameya Norimizu : Litchi Hikari Club.

L’étudiant Sid Lucero (Mark Gil) est attiré par la perspective de rejoindre l’Alpha Kappa Omega , l’une des fraternités les plus influentes du campus, véritable terreau de l’élite du pays où se côtoient les futurs dirigeants politiques, économiques, militaires et judiciaires. Un État dans l’État. L’équivalent philippin des fraternités Skull & Bones à Yale ou le Bullingdon Club à Oxford. L’initiation ne sera pas de tout repos pour briser l’humanité des prétendants à la fraternité : discipline militaire, humiliations, chantages, simulacres de torture calqués sur l’expérience de Milgram et exclusion des plus « faibles ». Une fabrique de l’inhumanité pour souder un groupe élitiste amené à diriger sans partage le pays. Les « maîtres » comme ils disent. Le film est rythmé par une musique au synthétiseur, à la fois oppressante et enjouée, qui rappelle inévitablement Orange mécanique de Stanley Kubrick.
Mike de Leon commente : « Batch ’81 devait être au départ un film commercial sur la vie des étudiants de nos jours. L’intention première était de se greffer sur l’avalanche des films de ce type qui continuent à avoir un grand succès au box-office philippin. Le thème des confréries ou sectes universitaires est devenu très rapidement le propos principal du film au cours de l’élaboration du scénario. Ce qui m’a le plus passionné dans ce phénomène de confréries, c’est qu’il m’a procuré l’occasion de montrer les machinations d’une organisation autoritaire, se camouflant derrière une façade égalitaire. La violence physique et, plus grave, psychologique sont les instruments utilisés pour inculquer le conformisme et la soumission. Batch’ 81 pour moi, en conséquence, est plus qu’un exposé sur les confréries estudiantines aux Philippines. C’est aussi une allégorie. » Là encore, le réalisateur ne nomme pas directement le régime dictatorial de Marcos.
En 1983, les tensions politiques et sociales font rage. Si la loi martiale est abolie depuis 1981, le couple Marcos continue de régner sans partage, de piller le pays et de museler toute opposition. Les « disparitions » ou assassinats d’opposants sont monnaie courante. Le 21 août, Benigno Aquino, ancien sénateur alors exilé politique aux États-Unis, retourne aux Philippines. Il est abattu dès sa descente de l’avion. S’ensuivent de nombreuses manifestations populaires. Mike de Leon réalise alors Signos (Présages, en français), un documentaire de 38 minutes (visible sur la chaîne Vimeo de Mike de Leon) sur l’opposition au régime. Il est rythmé par la lecture du texte de Bertolt Brecht « Aux générations futures » écrit pendant la montée du national-socialisme en Allemagne. Le texte commence ainsi : « Vraiment, je vis en de sombre temps ! Un langage sans malice est signe de sottise, un front lisse d’insensibilité. Celui qui rit n’a pas encore reçu la terrible nouvelle. »
Dans ses mémoires à paraître, Mike de Leon revient sur ce moment important : « Signos était vraiment un produit de son époque, une collaboration d’artistes, de cinéastes et de journalistes, qui, malgré des convictions politiques différentes, étaient unis par un objectif commun : renverser le régime vilipendé de Marcos… Le film Super 8 mm met en scène des personnalités courageuses qui ont contesté le régime autocratique de la famille Marcos, y compris l’ancien sénateur Jose W. Diokno, les journalistes Joe Burgos, Letty Jimenez-Magsanoc et Ceres Doyo, les religieuses militantes Sœur Christine Tan et Sœur Mariani Dimaranan, l’avocat des droits de l’homme Rene Saguisag, le leader syndical Ka Felicing Villados, le cardinal Jaime Sin et le réalisateur Lino Brocka… Ce n’est pas un hasard si ce documentaire a fortement influencé ma représentation des personnages principaux de Sister Stella L. Sœur Christine et Ka Felicing sont devenus mes modèles pour les personnages des deux Sœurs Stella et le dirigeant syndical Ka Dencio. »
En février 1986, Corazon Aquino, femme de Benigno Aquino, assassiné en 1983, devient présidente des Philippines. La famille Marcos fuit à Hawaï, après plus de vingt ans de corruption (et un enrichissement personnel estimé entre 5 et 10 milliards de dollars… oui : milliards) et d’oppression du peuple au détriment d’une élite. Mais l’histoire des Marcos aux Philippines ne s’arrête pas là, comme on le verra par la suite.

Comme l’écrit de Leon, Signos lui inspire les personnages de son film, Sister Stella L., en 1984, avec l’actrice superstar Vilma Santos. Ce film éminemment social et politique raconte l’histoire de sœur Stella Legaspi, une religieuse non engagée politiquement et dont la position pacifiste est contestée par une collègue plus radicale (probablement communiste) et Nick Fajardo, journaliste et ex-petit ami de Stella avant son entrée dans les ordres. La position de Stella change peu à peu lorsqu’elle rejoint le piquet de grève d’un groupe d’ouvriers, opportunité de mettre en pratique les enseignements du Christ et de défendre les opprimés. Mais bientôt, des briseurs de grève et des milices sans doute mandatées par le propriétaire de l’usine s’attaquent aux manifestants.
Sister Stella L. pose frontalement la question de l’engagement de l’Église contre le régime de Marcos et en soutien aux plus pauvres, terrassés par une grave crise économique (à l’époque, le pays est au bord de la faillite). Le message est clair : le régime de Marcos ne profite qu’aux propriétaires au détriment de l’ensemble du peuple. De Leon montre ici la convergence des luttes entre syndicalistes, religieux et journalistes… avec tout son jeu d’alliances et d’intérêts : ainsi, Stella est, avec ou sans son consentement, considérée par les syndicalistes comme un atout auprès de l’opinion publique et des forces de l’ordre, et par les journalistes comme le sujet d’articles à sensation. Le film se termine par la confession face caméra de l’héroïne, un procédé qui reviendra dans les films ultérieurs : Aliwan Paradise, Bayaning 3rd World et Citizen Jake.
.
Sexe, mensonges et vidéo
.
En 1985, Mike de Leon réalise sans doute son film le moins personnel avec Hindi nahahati ang langit (Le paradis n’est pas divisé, en traduction littérale), l’adaptation d’un komiks à succès. Quel grand écart avec les films précédents, très politiques ! On a affaire ici à un soap digne de Dallas (en moins long et complexe) avec cette histoire d’amour entre deux demi-frère et sœur, Noel et Melody, au sein d’une famille bourgeoise. Ou comment leur haine réciproque depuis l’enfance cache le plus pur amour, que ne pourront entraver leurs mariages respectifs (malheureux) et leurs bisbilles financières. On retient surtout le jeu excessif de Christopher de Leon qui crie et se ronge les sangs pour un rien. Si on comprend les jeux excessifs et hystériques d’un acteur chez Andrzej Zulawski ou Sono Sion… dans cette comédie romantique, beaucoup moins ! C’est le plus grand succès commercial de de Leon aux Philippines.

Événement technologique en 1986 quand Mike de Leon, mandaté par Sony Entertainment, réalise le premier film philippin en vidéo avec Bilanggo sa dilim, une adaptation du premier roman de John Fowles, L’Obsédé, déjà porté à l’écran en 1965 par William Wyler. On touche encore au désir de manipulation des individus et de possession comme dans Kisapmata et Batch ’81 mais avec moins d’intensité. Lito, un jeune photographe psychopathe, séquestre tour à tour deux femmes pour répondre à ses fantasmes, assez troubles et plus portés sur la domination que sur le sexe. Un mélange du mythe de Pygmalion et de Galatée avec le système sadien de séquestration. Une thématique qu’on retrouve dans de nombreux pinku eiga S&M ou la franchise japonaise Perfect Education.
Mike de Leon est assez habile pour varier les points de vue de ce film à trois acteurs, en quasi-huis clos. Grâce aux voix off, le spectateur passe de la tête de Lito à celle de Marissa, une de ses victimes (interprétée par Cherie Gil décédée cette année). Avec ce procédé narratif, le pouvoir change de main : la femme séquestrée pourra-t-elle dominer son tortionnaire ?
Après ce film, Mike de Leon se détourne du cinéma pour la publicité et la communication. Comme si la fuite du couple Marcos sonnait pour lui la fin de son intérêt pour le cinéma ?
.
Le paradis du divertissement
.
Après six ans de pause, Mike de Leon revient au cinéma en 1992 avec le court-métrage Aliwan Paradise, incorporé dans le film omnibus Southern Winds. Dans un futur dystopique, le ministère du Divertissement mandate Aliwan Paradise, mélange de Pôle Emploi et d’agence publicitaire, d’organiser une émission de télécrochet pour découvrir des talents « radicalement nouveaux ». Ce court métrage est une satire de l’utilisation du divertissement pour apaiser les maux de la société et endormir le peuple, ainsi qu’une critique du star system et de la télévision poubelle. On retrouve ici la politique des 3 S largement employée dès la fin des années 70 dans des pays comme l’Italie et la Corée du Sud : Sex, Screen, Sport.
Mike de Leon injecte pour la première fois un aspect méta dans une séquence d’images d’archives sur l’évolution du star system aux Philippines avec des productions LVN mais aussi Manille de Lino Brocka, Itim et Sister Stella L. Une affiche de Frisson ? tapisse les murs de l’agence Aliwan Paradise, aux côtés d’un portrait d’Emilda Marcos, censée être la ministre du Divertissement. À cette époque, la femme de l’ancien dictateur vient tout juste de rentrer de son exil hawaïen dans le but de briguer la présidence de la république philippine ! Si elle échouera, elle ne deviendra pas moins députée dans les années suivantes, perpétuant l’influence du clan Marcos sur le pays.

Comme dans les jeux télévisés, des participants présentent leurs talents auprès d’un jury constitué de deux religieux, deux militaires, une mère au foyer (et accessoirement femme d’un des militaires) et un représentant des étudiants (un ancien agitateur à qui on a coupé la langue… et qui ne peut donc pas s’exprimer) : une belle photographie du pays. Le final complètement cynique conclut que la misère, matière première des pays du tiers-monde, est le filon à exploiter pour renouveler l’industrie du divertissement, annonçant le courant du misérabilisme et du poverty porn, mis en scène avec ironie dans les années 2000 par un réalisateur comme Khavn de la Cruz (voir The Family that eats Soil, Mondomanila ou Alipato).
.
Jose Rizal : anatomie d’un héros national
.
Mike de Leon poursuit en 1999 avec Bayaning 3rd World (Héros du tiers monde, en français), une réflexion sur Jose Rizal, écrivain et héros national qui, à la fin du XIXè siècle, lutta contre le colonisateur espagnol et l’Église catholique et pour l’indépendance des Philippines. Il fut exécuté le 30 décembre 1896, à l’âge de 35 ans. Bayaning 3rd World met en scène deux réalisateurs qui réfléchissent à comment mettre en scène un film sur Jose Rizal. Surtout, ils y questionnent ses écrits, sa vie privée, son réel engagement contre l’occupant espagnol (il s’opposait à la révolte armée portée par Andrés Bonifacio) et la controverse sur sa possible reconversion à l’Église catholique la veille de son exécution. Le film est donc une enquête et une déconstruction du mythe de Rizal dont la figure a rapidement été récupérée / canonisée par les autorités politiques et religieuses. Comme le disent les deux réalisateurs, « une nation sans héros est une nation sans histoire ».

Toujours métafictionnel, les deux réalisateurs passent une partie du film à parler de Rizal dans leur studio tapissé d’affiches de Manille de Lino Brocka, Noli Me Tangere de Gerardo de León (film adapté du roman de Rizal en 1961), de photos d’archives, de bibelots et de peintures. Un cabinet des curiosités pour percer le(s) mystère(s) Rizal. Comme dans une enquête, ils répondent point par point à plusieurs questions biographiques et thématiques en interrogeant, magie du cinéma, les protagonistes de l’époque : autorités religieuses, révolutionnaires, famille proche et Rizal lui-même. Des interrogatoires fictionnels qui sont la matrice du film.
.
Citizen Jake : bienvenue dans la post-vérité
.
En 2018, alors que le pays est dirigé par le populiste Rodrigo Duterte, dans un climat autoritaire et mortifère qui rappelle les années Marcos, Mike de Leon réalise le très personnel Citizen Jake, l’histoire d’un journaliste obsédé par la corruption de son pays mais fils d’un sénateur, ancien soutien et nostalgique de Marcos. Reclus dans sa maison familiale à Baguio (historiquement, une ville développée au début du XXè siècle par l’occupant étasunien pour son climat plus doux qu’à Manille, devenue la ville des élites politiques et économiques, abritant même une résidence présidentielle et un tribunal suprême), Jake alimente un blog dans lequel il publie des informations contre les élites corrompues, y compris son père, en pleine période électorale. Il fréquente notamment Lucas, un professeur d’histoire et ancien activiste contre le régime Marcos. Un militant un brin désabusé par le retour politique des Marcos et qui qualifie les élections de « festival de connards ».

Dans sa naïve quête de justice et d’équité, Jake enquête sur la mort d’une lycéenne et un réseau de prostitution de luxe pouvant compromettre les élites du pays. Le constat de Jake (et du réalisateur lui-même) est bien amer : son enquête n’intéresse pas grand monde malgré son caractère explosif et les personnalités mises en cause ne seront jamais inquiétées. Jake constate aussi le désintérêt et l’amnésie des Philippins sur la période Marcos : ses anciens acolytes sont encore au pouvoir et perpétuent une politique anti-démocratique. Le film se déroule d’ailleurs pendant une campagne électorale à laquelle participe Ferdinand « Bongbong » Marcos Jr, le fils de Ferdinand et Emilda Marcos… devenu en mai 2022 Président des Philippines ! Une campagne populiste organisée sur les réseaux sociaux avec une stratégie de révisionnisme sur les actes de la famille Marcos (pourtant parmi les plus grands voleurs de l’histoire). Ou comment les classes populaires plébiscitent des milliardaires sans scrupules. Bienvenue dans l’ère de la désinformation à grande échelle et de la post-vérité.
En 2018, Mike de Leon affirmait que Citizen Jake serait son dernier film. Des propos remis en question en mai dernier dans un entretien au site d’information Rappler où il laisse entendre qu’il pourrait bientôt reprendre du service. D’ici là, De Leon a réalisé plusieurs clips de propagande contre Rodrigo Duterte (comme Kangkungan en 2019), écrit ses mémoires et s’efforce de préserver et promouvoir le cinéma philippin.
En plus d’aider à la restauration de films du studio LVN, Pictures il a créé une chaîne Vimeo sur laquelle il met en ligne des classiques. Malheureusement, la conservation des films philippins fait défaut et de nombreux films sont perdus ou impossibles à restaurer. Depuis le début des années 2010, on peut tout de même se satisfaire du travail effectué par la World Cinema Foundation (par exemples avec Manille et Insiang de Lino Brocka) ou l’ABS-CBN Film Restoration Project (avec des restaurations de films de Mike de Leon, Ishmael Bernal, Eddie Romero, Mario O’Hara ou Peque Gallaga).
.
À venir en 2022 / 2023 : la ressortie en salles de plusieurs films de Mike de Leon par Carlotta Films. Un focus Mike de Leon est également organisé à l’Étrange Festival 2022 avec la projection de 4 films : Itim, les rites de mai (1976), Frisson ? (1980), Kisapmata (1981) et Batch ’81 (1982).
Marc L’Helgoualc’h





 Suivre
Suivre