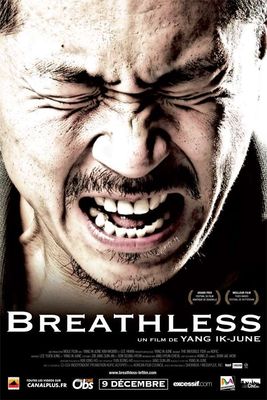Quelle joie, pour un spectateur intéressé par les mouvements de plaques tectoniques au sein du cinéma mondial, de voir advenir de nouveaux cinéastes ! Grâce à sa double faculté à se situer dans la généalogie du cinéma iranien tout en ouvrant une nouvelle voie, le jeune Saeed Roustaee (32 ans au compteur) confirme après La Loi de Téhéran qu’une nouvelle génération d’auteurs persans voit le jour, prête à succéder aux grands pontes avec fracas, intelligence et émotions. En témoigne Leïla et ses frères, drame kaléidoscopique aux ressorts tragiques et sociétaux.
Jouons-là comme Leone : partons d’un plan de grand ensemble (l’état du cinéma iranien) pour aller au très gros plan (les détails du film). De quoi le cinéma iranien est-il le paysage aujourd’hui ? Séquencé en 3 générations (comme on le dit pour le cinéma chinois), la cinématographie persane moderne a été construite par les incunables, les pères fondateurs : Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Mohammad Reza Aslani. S’en sont suivis celles et ceux qui leur ont succédés, souvent nés de la cuisse de ces grands auteurs : Jafar Panahi, Samira Makhmalbaf, Asghar Farhadi, Mohamad Rasoulof… Depuis plusieurs années déjà, ces mêmes auteurs figurent en proue de la gondole internationale. Et, en deux ans, l’apparition simultanée de Panah Panahi avec son fabuleux Hit the Road et de Saeed Roustaee qui ré-inventait le polar au passage jette de nouvelles perspectives.

Aux grandes contemplations morales des grands-père,s aux réflexions méta et sociétales des pères, les héritiers (Panahi comme Roustaee) s’approprient les codes du cinéma de genre pour en injecter l’imaginaire et l’énergie dans le canevas familier des films iraniens. Après avoir approché les codes du polar dans son deuxième long-métrage, Roustaee s’approprie ceux bien connus du drame familial, en épousant la structure du film choral. Leïla et ses frères déploie sur 2h45 les luttes intestines d’une famille composée d’un père et d’une mère vieillissants et de leurs 5 enfants (une femme et quatre hommes). Si l’énergie et la violence propre au polar et dominants dans La Loi de Téhéran s’efface ici (à l’exception de la séquence inaugurale de l’évacuation de l’usine), la portée sociale et géopolitique de son précédent se retrouve bel et bien là. C’est l’un des traits marquant de cette nouvelle génération : l’Iran n’est plus donné comme un pays fermé au monde et autonome dans la région du Moyen-Orient ; il est représenté comme une place cardinale dans l’échiquier mondial et se trouve désormais pris aux quatre vents des influences culturelles extérieures. Que ce soit les nombreuses citations à Schubert, Allen ou Ozu dans Hit the Road, ou dans Leïla et ses frères les discrètes disséminations du soft power états-unien dans le quotidien de la famille, l’Iran se donne à voir désormais comme un pays ouvert. Ce qui rend d’autant plus dramatique le contraste avec les réflexes grégaires de certains de ses habitants.

Tout s’ouvre sur le visage d’un vieille homme, affalé dans son fauteuil, le regard perdu dans le lointain, une cigarette décatie au bec. Si les personnages au cinéma ne sont jamais que leur propre cosmos, difficile, au fil de l’intrigue, de ne pas deviner à travers cet homme âgé une certaine incarnation du vieil Iran populaire. Toute la dramaturgie de Leïla et ses frères est tendue entre deux volontés : celle du père, soucieux d’acquérir, moyennant finance, le respect et la reconnaissance de sa famille (aux aspects mafieux) contre celle de ses enfants, menés par la sœur, Leïla, désireux de sortir la famille de la pauvreté dans laquelle les maintiennent les règles archaïques d’honneur et d’assujettissement en investissant dans un petit commerce de quartier. Les raccourcis ethno-centristes auront tôt fait d’invoquer comme lecture l’un des grands anathèmes occidentaux qu’est la lutte contre le patriarcat. Et le film dispose d’une ouverture suffisante pour se lire à cette aune. Mais il déploie un regard bien plus ample sur les structures actuelles de la société iranienne, tout en offrant une mise en scène aux ressorts éminemment cinéphiles.

Leïla, remarquablement interprétée par Taraneh Allidousti (découverte dans les premiers Farhadi), est cette force motrice et frondeuse qui fédère ses frères pour tâcher de construire avec eux un avenir plus digne que celui proprement égoïste auquel les destine leur père vieillissant, opiomane et aliéné à la doxa d’une famille d’oncles au fonctionnement mafieux. Avec leur concours, elle essaye de porter la famille en-dehors de son bourbier social (dont tous se plaignent) pour leur offrir simplement, par la force d’un travail honnête, un peu de confort de vie. Les ramifications géopolitiques (avec cet arrière-fond de lutte des classes, cette ingérence culturelle et économique des États-Unis dans le quotidien de cette famille populaire de Téhéran, cette évolution du système social vers une inclinaison à l’entreprenariat…) chargent le récit d’une dimension complexe, ample et lucide sur l’état actuel du pays. Et que ce soit la sœur de la fratrie qui soit la vectrice de cette émancipation confirme bien, non pas les vertus féministes d’un cinéma qui l’est presque avant l’heure, mais que, comme disait Musset, « ce que femme veut, Dieu le veut« . Et pour arriver à ses desseins, elle est entourée, notamment, de deux des fidèles collaborateurs de Roustaee, présents depuis son premier long-métrage : Navid Mohammadzadeh (le criminel dans La Loi de Téhéran, le bon fils dans celui-ci) et Payman Maadi (le flic dans le précédent, le frère récalcitrant ici).

Quid alors du style, de cette force d’énergies par laquelle La Loi de Téhéran avait tant fasciné ? Si plastiquement, le film sidère moins, convainc moins par des effets de bravoure formelle (ce qui est un atout pour un film de plus de 2h30, risquant – le cas contraire – l’épuisement du spectateur), c’est par sa relecture renversée et subtile du Parrain qu’il intrigue. Au tragique sublimé de la filiation contrainte, au cœur du chef-d’œuvre de Coppola, Roustaee oppose un regard ultra-contemporain de désaliénation, soumettant la famille aux mêmes problématiques : doit-on se laisser conduire dans le sillon de ses parents, au risque de perpétrer une loi mortifère ? Et c’est précisément à cet endroit que le film touche le plus juste, sur un plan émotionnel et sociétal : la fratrie tâche de s’arracher aux convoitises du père soutenu par la veulerie de la mère, mais sans le condamner, toujours dans le nécessaire respect des anciens. C’est là où la révolution présentée par le film est beau (et les Iraniens s’y connaissent en la matière) : le point de bascule exposé par l’histoire (aux risques des claques et des scandales) ne se fait pas sans égard des jeunes à l’encontre des anciens.
Le public est en droit d’attendre Leïla et ses frères avec appréhension. Comment réussir sa confirmation d’auteur après le fracas de son deuxième long-métrage ? Sa propulsion en Compétition au Festival de Cannes 2022, un an seulement après qu’il ai été reconnu en France au Festival de Reims-Polar était-elle de bonne augure ? Non seulement Leïla et ses frères lève tous les doutes mais il enthousiasme suffisamment (par son ampleur romanesque, la sagesse de son auteur, la générosité de son imaginaire) pour déjà donner envie de découvrir son 4ème long-métrage !
Flavien Poncet
Leïla et ses frères de Saeed Roustaee. France. 2022. En salles le 24/08/2022





 Suivre
Suivre