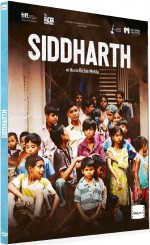Acclamé sur le circuit festivalier et notamment à la Berlinale 2018, An Elephant Sitting Still, coup d’essai et de maître du jeune et déjà regretté Hu Bo, arrive en salles ce 9 janvier. Cette complainte de la Chine moderne est un joyau d’une beauté fragile et douloureuse, imbibé d’une poésie amère.
Deux lycéens, un petit malfrat et un retraité. Sous la grisaille d’une grande ville post-industrielle, leurs quatre destins prennent une tournure tragique. Sur le point de tout perdre, ils vont chercher refuge dans la ville de Manzhouli. On raconte que là-bas un éléphant reste assis, immobile, à longueur de journée.

Dans ce qui restera l’unique long-métrage de Hu Bo, qui mit fin à ses jours peu de temps après l’avoir achevé, le fond et la forme s’associent pour accoucher d’une œuvre d’une grande force lyrique. Empreinte d’une profonde dureté, elle parvient à évoquer, avec une économie d’artifices et sans jamais basculer dans la noirceur ou le misérabilisme, un monde où la violence physique comme psychologique est omniprésente. Ce chant du cygne tissé de grâce et de désespoir, porté par des acteurs sublimes, suinte d’une rage sourde contre les injustices de l’existence, récit d’un combat que l’on sait perdu d’avance mais que l’on mène malgré tout.
Avant même que ne se brisent les trajectoires des personnages, c’est le poids considérable de l’atmosphère qui prend à la gorge. L’image est prise au piège d’une colorimétrie grisâtre, étouffée par le ciel pollué et le béton nu. La ville qui enserre les protagonistes prend l’allure de limbes labyrinthiques dans lesquelles ils s’avancent sans but défini, le plus souvent occupés à chercher ou à fuir. Dans cette métropole qui semble tout à la fois se construire et se détruire, nulle oasis à laquelle se ressourcer, puisque les seuls lieux de relative liberté où ils trouvent refuge sont les allégories mêmes de la malédiction qui les frappe : les cages maussades d’un zoo, un long tunnel déserté, le lit sale et desséché de ce qui fût jadis un fleuve… Les rues que l’on traverse pourraient sembler désertes, pourtant elles sont arpentées par des fantômes, silhouettes floues mais accablées qui tracent leur propre errance dans ce purgatoire sans ébrécher la chape de solitude qui plane constamment.

Ce n’est cependant pas uniquement l’espace, mais aussi le temps qui oppresse. Les plans-séquences laissent l’usure de l’attente et de l’incertitude faire son œuvre, les scènes s’étirant sans répit pour mieux incarner le récit de cette interminable journée dans la vie des personnages. Dans le vide qui se creuse, ceux-ci se trouvent renvoyés à leur propre impuissance, car ce temps dans lequel rien ne semble advenir est aussi celui de l’interrogation, du doute, de l’introspection. C’est celui dans lequel éclosent l’angoisse, l’ennui ou le malaise qui donnent au film sa paradoxale densité émotionnelle. Les silences, d’ailleurs, y contribuent grandement, d’autant qu’ils ne se montrent jamais apaisants : ils sont habités d’éclats de voix distantes et du ronflement de la circulation, qui viennent renforcer le sentiment d’écrasement incessant. La musique, quant à elle, se fait rare et toujours lancinante : quelques notes mélancoliques délivrées avec parcimonie sont le seul réconfort qu’elle consent à apporter.
En effet, en dépit d’une mise en scène minutieuse, la recherche d’esthétisation est minimale : ce n’est pas ici une perfection formelle que l’on poursuit, mais la valeur brute de ce qui est filmé. Ainsi, si la caméra accroche de loin en loin un cadre dont la perspective élégante et la composition harmonieuse séduisent le regard, elle se contente la plupart du temps de suivre les personnages, au rythme hypnotique de leurs pas. Plus significatif encore, l’oreille attentive décèlera, à de rares reprises, le sifflement du vent faisant saturer le micro, ou l’écho des chaussures du cameraman en quête du bon placement. La conservation de ces éléments, qu’il aurait été aisé de faire disparaître en post-production, témoigne d’un pari qui porte entièrement ses fruits : inaltéré, le bruit d’ambiance procure en effet une immersion bien plus puissante que celle qu’aurait pu apporter une bande-son nettoyée en studio. Cette forme langoureuse mais rugueuse évoque volontiers le Kaili Blues de Bi Gan, et de la même manière tout semble évoluer dans un flottement âcre.

Ce n’est pourtant pas tant ce qui passe devant la caméra qui importe ici que ce qu’elle ne capte pas : d’ailleurs, les moments-clefs qui bouleversent les destins des personnages se déroulent tous en hors-champ. Cela n’est pas une carence, bien au contraire : la suggestion suffit amplement à communiquer la dureté des faits, tout en évitant la facilité d’un choc cathartique. Plus régulièrement, c’est la mise au point et la profondeur de champ qui mettent à distance les conflits mais aussi les simples interlocuteurs en se focalisant sur les visages des protagonistes principaux, les faisant apparaître impassibles vis-à-vis des drames qui se jouent autour d’eux ou des paroles qui leur sont adressées. Cette apparente indifférence est pourtant lourde de sens, puisqu’on les sent prisonniers de leurs propres pensées, perpétuellement préoccupés par des inquiétudes de fond. Surtout, on devine chez eux une usure, un épuisement moral qui n’est pas sans toucher le spectateur face à l’infaillible succession des tragédies.
Tout, en effet, dégouline d’un sentiment de fatalité qui confine à la résignation. Le film est imprégné d’une poésie du pessimisme aussi grisante que glaciale, et l’on a tôt fait de comprendre que le malheur n’aura de cesse de s’abattre selon une loi implacable. Cependant, plutôt que produire la sensation d’un acharnement gratuit, l’accumulation des obstacles associée au temps long du métrage produit l’effet d’une plongée en apnée, dans laquelle on est amené, par accoutumance, à assimiler le détachement des personnages. Graduellement, toutes les options semblent devenir équivalentes : le déni, la violence, la trahison, la fuite, et même le suicide… Faute du moindre soutien qui rattache les protagonistes à leur existence actuelle, ils sont prêts à s’aliéner de ce monde qui les a abandonnés, et dans ce cheminement la gravité de leurs propres actes n’a plus d’importance. La hiérarchie des alternatives ainsi effondrée, la mort semble ramenée au même niveau… que le spectacle d’un éléphant excentrique.

Pourtant, c’est l’éléphant que les héros choisissent : c’est leur manière de, malgré tout, continuer à avancer. Alors qu’on leur professe qu’il n’existe aucune échappatoire, que la souffrance est une malédiction que l’on porte en soi et que nul horizon nouveau ne peut alléger, ils persistent à se donner une chance. On ne peut pas pour autant parler d’optimisme, puisque l’espoir auquel ils se raccrochent n’est guère qu’une fantaisie absurde, une anecdote qui sonne comme une farce et derrière laquelle ne se dresse aucune perspective. Ils prennent le chemin de Manzhouli comme un athée se rendrait en pèlerinage, sans réelle conviction mais refusant de renoncer sans avoir d’abord épuisé tous les recours. Cette quête de l’épiphanie n’est d’ailleurs pas sans ironie, puisque c’est à n’en pas douter l’apathie et la désaffection de l’éléphant qui les fascinent et à laquelle ils cherchent à s’identifier ; or, pour aller à sa rencontre en dépit de l’adversité, ils déploient une énergie et une détermination considérables.
An Elephant Sitting Still, c’était à l’origine une nouvelle de Hu Bo. Cette adaptation cinématographique l’a transformée en poème. Un poème Romantique, sans doute, puisqu’à la vue de la ville asphyxiante qui sert de cadre au film il est difficile de ne pas repenser aux premiers vers du Spleen de Baudelaire : « Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis… ». Puis, au fur et à mesure que l’oeuvre se déroule, enivrant le spectateur de toute la brutalité de sa mélancolie, c’est plutôt de Musset que l’on se souvient, lorsqu’il écrit dans La Nuit de Mai : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots. » Seul l’avenir jugera de sa postérité, mais An Elephant Sitting Still est un cri déchirant qui résonne aujourd’hui avec une cruelle intensité.
Lila Gleizes.
An Elephant Sitting Still de Hu Bo. Chine, 2018. En salles le 09/01/19.





 Suivre
Suivre