
Introduction
Deux Ours d’or à Berlin (pour Garçon d’honneur en 1993 et Raison et sentiments en 1995), deux Lions d’or à Venise dont il présidait logiquement la compétition en 2009 (pour Brokeback mountain en 2006 et Lust, Caution en 2007), un énorme succès international (Tigre et dragon) et la réalisation d’un blockbuster super-héroïque (Hulk) ont fait d’Ang Lee un cinéaste omniprésent, capable du grand écart entre l’Asie et Hollywood, films de festival et succès grand public. A y regarder de plus près, ses films laissent pourtant un sentiment de vide et de platitude, surtout lorsque le cinéaste touche-à-tout s’attaque à des genres précis (le western, le wu xia pian ou le film de super-héros) qui ne semblent pas vraiment l’intéresser. Petite mise au point sur une filmographie fade mais consensuelle, afin d’en expliquer les défauts et les raisons de son succès.
Des débuts problématiques
Les premiers films d’Ang Lee annoncent le meilleur pour la suite. Le cinéaste fait preuve dans sa trilogie Father knows best d’une réelle sensibilité dans l’analyse des sentiments, qui, alliée à une sincère implication thématique, font oublier les défauts d’une mise en scène sans relief, qui passe encore comme une forme de discrétion. Il brosse avec l’aide du formidable acteur Lung Sihung et de son fidèle scénariste James Schamus le portrait de familles taïwanaises confrontées aux différences culturelles entre la Chine et les Etats-Unis (Pushing Hands), à l’homosexualité (Garçon d’honneur) ou au vieillissement du père sous le regard de ses trois filles (Salé Sucré). Ces thématiques familiales se transposent avec succès dans l’Amérique des banlieues dépressives de The Ice Storm. Et si quelques défauts du cinéaste sont déjà visibles dans Raison et sentiments, qui échoue à insuffler un véritable rythme aux thématiques personnelles d’Ang Lee (la confrontation entre les conventions sociales ou familiales et le désir de liberté, d’émancipation de bonheur personnel), noyées sous un décorum factice, c’est surtout à partir du moment où Ang Lee décide de révolutionner les grands genres américains et chinois que son système va révéler ses véritables failles.
Chevauchée avec le diable : le western à l’Ouest
Si c’est d’abord Brokeback Mountain, présenté comme le premier « western gay » qui vient à l’esprit lorsque l’on pense aux cowboys d’Ang Lee, sa Chevauchée avec le diable de 1999 annonce déjà l’intérêt du cinéaste pour le genre. Mais c’est justement de cet intérêt dont on peut douter en voyant les deux films. On peut considérer Brokeback Montain un peu à part sur la question du genre, tant sa partie western est infime et s’efface face à la volonté d’Ang Lee de montrer les sentiments de virils cowboys amoureux – ce qu’il filme d’ailleurs de la même façon que les paysages de cartes postales qui les entourent. Le film de 1999 est déjà plus problématique, tant on y sent la prétention de l’inscrire dans le genre, tout en le dépassant, sans arriver ni à l’un ni à l’autre. Chevauchée avec le diable commence en pleine Guerre de Sécession, et tout l’imaginaire lié à cette période, des duels au pistolet aux paysages désolés, est convoqué. Pourtant, les scènes de poursuite, d’action ou de batailles sont si rares qu’elles donnent l’impression d’être traitées comme des éléments secondaires et superflus. Non, ce qui intéresse Ang Lee, c’est d’insérer un parcours en quête de liberté individuelle dans la grande histoire américaine. On a ainsi le droit à une réflexion sur l’identité culturelle (le héros incarné par Tobey Maguire est d’origine allemande, et devient américain en prenant part à une guerre qui ne le regarde a priori pas), sur la tolérance (le Sudiste devient ami avec un « nègre » qu’il découvre finalement comme humain) et sur l’amour (comme à son habitude, Ang Lee casse l’action de son film pour y insérer des interludes sentimentaux) qui viennent alourdir le film au lieu de l’approfondir. Et là se trouve le problème du cinéma d’Ang Lee : persuadé d’apporter quelque chose au genre qu’il ne parvient pas à maîtriser il ne livre ni un western, ni un film d’auteur, mais un mélange bâtard et un peu hypocrite des deux.
Tigre et dragon : le wu xia pian au ralenti
Le Wu Xia Pian est un genre majeur du cinéma chinois, mélange de film d’aventure, de sabre, de chevalerie et de Kung-fu. Comme le souligne le pourtant très contemplatif Tsai Ming Liang : « Tous les réalisateurs d’origine chinoise rêvent de faire un Wu Xia Pian. C’est quelque chose qui est tellement ancré dans notre culture, du roman au cinéma en passant par la poésie, lié à notre environnement, qu’évidemment il m’arrive de penser à aborder le genre ». C’est certainement la même réflexion qu’a dû avoir Ang Lee lorsqu’il s’est greffé à la production de Tigre et dragon à une période où le genre était tombé en désuétude après la rétrocession de Hong Kong à la Chine en 1997 et où ses cinéastes tenaient leur chance aux États-Unis. Or, si l’aventure hollywoodienne fut un échec pour la plupart des exilés de Hong Kong, les producteurs américains savent s’y prendre pour vampiriser et s’approprier une culture étrangère. Alors qu’on voit fleurir dans tous types de production des combats aériens chorégraphiés par les maîtres du genre, à l’image de ceux de Matrix, composés par Yuen Woo Ping, la Colombia donne le feu vert à une co-production américano-chinoise en costume et en mandarin, dans la plus pure tradition du Wu Xian Pian et laisse carte blanche à Ang Lee, qui a le mérite de parler la langue et la réputation de pouvoir s’attaquer à tous les genres, aux commandes de ce blockbuster.
Et force est de constater que le cinéaste remplit le cahier des charges : les scènes d’acrobaties martiales câblées sont nombreuses, on retrouve avec plaisir des acteurs qui ont marqué le genre, dont Chen Pei Pei, l’ancienne Hirondelle d’or, dans le rôle de la perfide Jade La Hyène, et la structure scénaristique, avec son flashback coupant de manière improbable le film au milieu, rend hommage aux audaces du cinéma hongkongais. Tigre et Dragon rappelle aussi que le genre fut avant tout féminin, et laisse la part belle aux personnages de femmes fortes et indépendantes.
Malheureusement, ces qualités camouflent mal l’immobilisme de la mise en scène (qui laisse à penser que la réalisation des scènes d’action a plutôt été confiée à Yuen Woo Ping), comme le manque de conviction d’Ang Lee face à son sujet : minimisant l’ancrage dans les légendes et l’histoire chinoise, Lee adopte un traitement mélodramatique, et interroge le rapport entre le respect des traditions et les désirs profonds des êtres. Mais cette problématique, qui parcourt toute l’œuvre du cinéaste, est ici contrebalancée par une imagerie poétique aussi molle que puérile. Cette disneysation du genre se traduit aussi par une volonté de créer de la beauté en faisant de chaque scène un tableau, figeant artificiellement personnages et décors dans des poses statiques. Aux combats secs, souvent violents et barbares du Wu Xia Pian, le cinéaste préfère une légèreté cotonneuse, dénuée de toute fureur, et propre à plaire au public occidental. Le formatage pour un public américain, associé à une énorme campagne publicitaire, fait de ce film un triomphe, qui a le mérite d’ouvrir la voie à une nouvelle vague de Wu Xia Pian, mais renforce la conviction qu’Ang Lee est avant tout un cinéaste consensuel, et en tout cas plus un touche-à-tout malin se faisant passer pour un auteur que le génie révolutionnant les genres par son approche personnelle.
Hulk : les spectateurs verts de rage
Le succès mondial de Tigre et dragon ouvre définitivement les portes d’Hollywood à Ang Lee, qui accepte alors d’adapter le comic Marvel Hulk. Si la digression sur la thématique de la famille dans les Quatre Fantastiques de The Ice Storm était plutôt bien vue et apportait un peu de légèreté au film, l’intellectualisation extrême du personnage de Bruce Banner va ici au contraire plomber le film aussi bien scénaristiquement que visuellement. Sur-interprétant les thématiques psychologiques du pauvre Banner qui n’en demandait pas tant, The Hulk voit tous les problèmes du personnage prendre racine dans un conflit œdipien poursuivant le personnage depuis son enfance. Et lorsque la résolution passe par un combat contre des toutous mutants et une confrontation finale avec la figure paternelle transformée en centrale électrique géante, on se demande vraiment ce qu’Ang Lee et James Schamus ont fumé en imaginant le film. L’impression de ridicule est accentuée par les effets visuels, qui tentent de retranscrire cinématographiquement les cases d’un comic, mais accumulent plutôt les effets étranges qui transforment certaines scènes en véritables trip sous LSD (avec l’apparition de méduses vertes et de grenouilles qui explosent !). Si l’on ajoute à cela un rythme d’une lenteur soporifique traversé par des tunnels explicatifs, on comprend pourquoi Ang Lee connait avec ce film son premier – et seul – véritable échec (le film est boudé par la critique et ne récolte que 243 millions de dollars pour un coût de 172). Pour une fois, la formule Ang Lee ne fonctionne pas, et l’excellence du jeu des acteurs – le cinéaste a toujours un casting parfait – ne cache pas les faiblesses du film. Mais le cinéaste retombe vite sur ses pattes en se réfugiant dans le cinéma indépendant avec Brokeback mountain et en retournant en Chine pour Lust, Caution. De quoi regagner la confiance de majors et se voir proposer de nouvelles commandes, comme Hôtel Woodstock, qui souffre de nouveau des tics du réalisateur en plantant encore une fois les névroses familiales habituelles du cinéaste dans un Woodstock factice et peu convainquant.
Un dernier mot sur Kubrick.
Le souci que pose Ang Lee aux amateurs des genres auxquels il s’attaque est donc avant tout sa prétention à vouloir les révolutionner, sans vraiment chercher à en comprendre l’essence. Si le modèle du cinéaste est sur ce plan Stanley Kubrick, celui-ci avait le génie de ses ambitions, et pouvait mettre tout le monde d’accord. 2001 ou The Shining fascinent autant les fans monomaniaques de films de S.-F. et d’horreur que le cinéphile intellectuel ou le spectateur n’ayant jamais vu un film de genre de sa vie. A l’inverse, Tigre et dragon peut charmer le néophyte, mais ne peut qu’énerver quiconque connait un peu le Wu Xia Pian. On tremble alors en pensant à ce qu’Ang Lee aurait pu faire du Aryan Papers de Stanley Kubrick si son nom avait été confirmé à la réalisation du vieux projet du maître, récemment réactivé.
Victor Lopez.





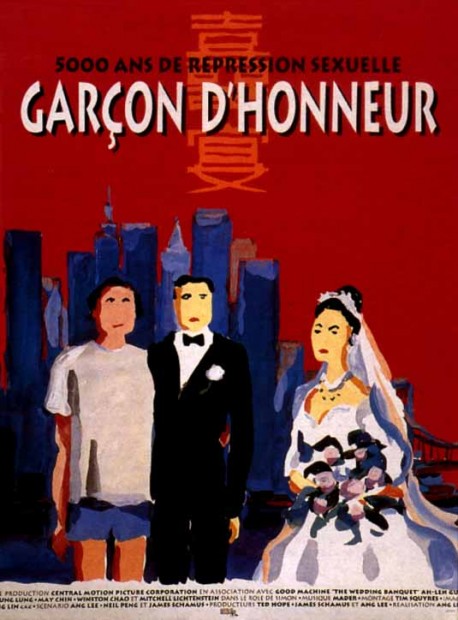
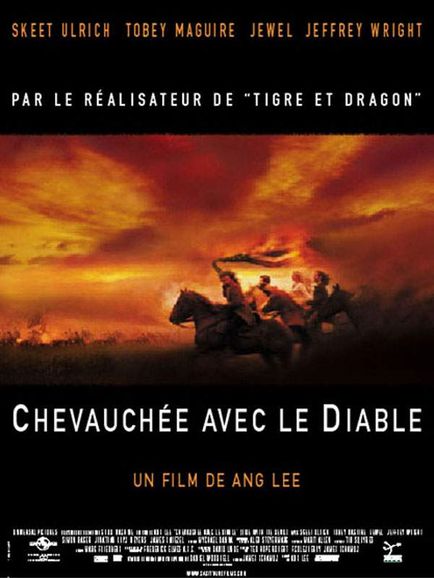


 Suivre
Suivre












