Comme pour consolider sa place de pape du cinéma populaire indonésien, Joko Anwar nous propose une œuvre sérielle sur Netflix. Entre la volonté d’épouser ses influences pulp et celle de tutoyer les cinéastes internationaux nouveaux « maîtres de l’horreur », Nightmares and Daydreams est une œuvre singulière. Peut-être la moins audacieuse, mais celle qui serait la clé pour ressaisir rétrospectivement l’importance de l’œuvre du cinéaste durant la décennie dernière, en Indonésie, mais également dans le reste de l’Asie.

Des histoires de phénomènes de science-fiction surnaturels se déroulent dans ce recueil de sept histoires hallucinantes.
Joko Anwar scénarise la majorité de la série, mais n’en réalise que le premier et le dernier épisodes. Difficile de ne pas voir cette omniprésence, même en tant qu’acteur dans l’épisode 04, comme l’aveu d’autorité sur cette production Netflix. Si la plateforme américaine s’est bien implantée en Asie à la fin des années 2010, c’est justement par le financement de tout un pan du cinéma d’horreur ou d’action (les œuvres des ex-Mo Brothers sont des productions Netflix) qui avait mis en lumière l’archipel au début de cette même décennie. Il n’était donc pas étonnant que le big boss de l’industrie locale soit à son tour sollicité par la plateforme. Il peut à la fois rivaliser avec son ami de Singapour, Eric Khoo, qui avait dirigé la série d’anthologie Folklore pour HBO Asia en 2018-2019, dont Joko Anwar avait réalisé l’épisode indonésien, soit le premier épisode de l’anthologie. Il avait été également été acteur dans l’épisode singapourien d’Eric Khoo. Mais pour le cinéaste indonésien, ce n’est pas seulement l’ambition de représenter l’Asie du Sud-Est comme son comparse, c’est aussi l’ambition de se présenter en tant qu’artiste par la vitrine qu’offre Netflix. On pense donc aussi à la série de Guillermo del Toro, Le Cabinet de curiosités en 2022. Joko Anwar souligne par cette démarche sérielle qu’il serait l’équivalent du cinéaste mexicain pour l’Asie, et dans une certaine mesure, il n’a pas tout à fait tort. Comparaison n’est pas raison, mais les filmographies des deux cinéastes autant que leur rôle de producteur rendent ce jeu de miroirs raisonnable. Cependant, l’hommage du cinéaste indonésien diffère de celui du mexicain dans l’angle du traitement de l’horreur, Joko Anwar n’étant pas un exilé et réfléchit son cinéma à partir de Jakarta, un territoire qu’il veut explorer dans ses recoins les plus sombres. Il ne s’agit pas de refaire des motifs ou des lieux communs, mais de re-imaginer un réel dont la violence dépasse de loin celle des auteurs favoris de del Toro. C’est cela qu’explore Joko Anwar, comme l’annonçait déjà le titre d’un podcast auquel il participait il y a quelques années, « Good kid mad city ». En référence à l’album de Kendrick Lamar, c’est une introspection dans un territoire comme celui de la conscience d’une nation ou du moins des gens qui l’habitent, le composent et parfois le décomposent.

Ce qui revient souvent comme voute et structure des épisodes au fil de la série, c’est comment elle appuie sur une subversion liée à une dynamique de classe. Une lutte même. Avant qu’interviennent les éléments fantastiques ou d’horreur, les corps sont déjà soumis aux tensions propres à la précarité, la pauvreté, la faim ou la servitude. Toutes les situations se déroulent à Jakarta à différentes époques qui nous sont explicitées au début de chaque épisode. L’invariant devient évident quand peu importe l’époque, on réalise que les personnes que nous suivons sont toujours soumises au cauchemar capitaliste comme base d’une horreur qui ne peut qu’évoluer et s’étendre du pire à l’ignoble. Les épisodes ont donc pour commun cette tension autour de la vampirisation capitaliste. Presque du marxisme gothique. Sauf que Joko Anwar donne une chute à chaque épisode. On pense petit à petit que ce que l’on voit n’est pas seulement de l’ordre du cinéma mais aussi de la translation d’un autre art sériel, celui du comic book. Puis par les plans subjectifs, du jeu vidéo. La série épouse une forme mutante, assez singulière où l’on ne reproduit pas des plans propres aux genres que l’on évoque dans le cinéma, mais on s’approprie l’esthétique des cultures populaires récentes. Cinéma, jeu vidéo, comic book, réseaux sociaux. Chaque épisode dévoile un plan subjectif à un moment clé. Dans le premier, on pense aux vidéos Youtube de chasseurs de fantômes ou d’Urbex voire à certains succès récents du jeu vidéo comme les derniers Resident Evil. Surtout quand on nous révèle qu’au cœur de tout cela se joue une histoire de secte monstrueuse. Dans un autre épisode, le plan subjectif nous dévoile le monde en noir et blanc du personnage principal qui ne voit pas les couleurs. Alors qu’il sombre dans la folie, il ne peut en dissocier les strates car le monde est déjà binaire malgré lui à travers son regard. Comme une logique de filtres, on pense aux effets des réseaux sociaux ou à l’alternance de couleurs comme une grammaire graphique propre à certaines œuvres de BD. La série brasse des effets et des expérimentations esthétiques dont le plan subjectif est l’articulation récurrente, comme si au final, on nous proposait de vivre ces situations à la première personne. Le « je » lyrique du romantisme à la littérature gothique devient celui du cinéaste qui nous permet d’incarner l’altérité qu’est la vie indonésienne comme une expérience universelle. Une horreur partagée par des logiques de systèmes, de flux, dont Netflix serait aussi l’un des véhicules. De là à dire que le cinéaste pirate la plateforme il n’y a qu’un pas, mais il est presque franchi quand la série se déploie réellement dans la durée que commence à former par réseaux les épisodes entre eux.

Joko Anwar garde le cap qui a irrigué son œuvre cinématographique, celui d’une certaine cruauté et d’un tragique propre à la culture indonésienne dont les origines ont à voir avec le théâtre et la poésie locale. C’est cette culture qui transpire quand tous les épisodes semblent organisés comme des pièces qui nous donnent accès à une cérémonie qui serait le grand tableau final que dessine cette mosaïque sérielle. On pense au garçon diabolique qui donne des cadeaux, à l’homme perdu dans le cinéma schizophrène de son existence décalée ou au combat des habitants pour ne pas perdre leur territoire et leur travail. Ce mélange entre social, sacré et folklore populaire est celui qui a fait les grandes heures du cinéma indonésien mais aussi de son théâtre. La singularité du théâtre indonésien, théâtre d’ombres, théâtre magique et cathartique, c’est aussi de faire le lien entre les différentes strates du monde qu’elles soient sociales ou métaphysiques. C’est aussi ce que travaille la série dans la continuité du cinéma de Anwar. Les images les plus horrifiques sont celles qui montrent la violence du quotidien comme un évènement d’un courroux divin. Les dunes et les collines d’ordures de l’épisode 02, la sénilité et la fragilité de la vieillesse dans l’épisode 01, les violences conjugales et sexistes dans l’épisode 03 ou le chômage dans le 06. Le fantastique ne vient qu’accentuer ce qui nous paraît déjà inadmissible comme pour en explorer les origines mais aussi donner un moyen cathartique d’y survivre malgré tout. Dans l’épisode 04, la caméra subjective devient un plan-séquence car une femme autrice parvient à se connecter à sa sœur jumelle durant l’écriture, comme une transe. Si cette forme est typique du cinéma d’horreur indonésien, c’en est même devenu le marqueur durant les années 2010, et elle est détournée par un jeu de miroirs et de porosité. On parvient aussi à voir du point de vue de l’agresseur, le mari qui bat sa femme. L’horreur a le visage de la victime mais aussi le regard du bourreau. Il faudrait prendre en compte les deux pour que la lutte ne devienne pas aveugle ou s’éborgne dans l’impasse de la vengeance. La série prend une dimension beaucoup plus intéressante quand sa subversion repose justement sur le fait qu’il y aurait toujours au moins deux points de vue voire plus à une situation. Dans l’espace mais aussi dans le temps.

Si Jakarta joue un rôle, c’est celui d’espace sédimentaire dont les couches dévoilent les horreurs comme des moments figés dans les strates du temps. Pourtant les causes de ces horreurs restent les mêmes selon les époques. Comme si nous étions piégés dans une boucle. Cette boucle serait d’abord celle des fictions qui rejouent à tous les niveaux de réalité ces luttes. Une cartographie imaginaire de la ville qui trouve, entre métaphore et allégorie, un moyen de désigner ces formes comme une affliction mondiale par le prisme du folklore local. Dans les différents épisodes, des images reviennent dans les séquences oniriques. Comme si tous les personnages partageaient un cauchemar, mais aussi un rêve commun. Ce pourrait être celui du cinéma qui libère les esprits mais emprisonnent les corps dans l’épisode 05, avec son hommage discret au pionnier du cinéma indonésien, Andjar Asmara. Où un homme part à la dérive dans les limbes du temps en tentant de rester accroché à son souvenir d’un cinéma en ruines qui est désormais un gouffre aux fantômes. Une cavité nostalgique qui vampirise le temps et nous condamne à une odyssée cyclique.

Par images récurrentes, par un réseau de plans et de motifs se dessine, par touches, une lutte à venir. Les chutes ont à la fois les propriétés surprenantes des formats que le cinéaste émule, mais aussi ceux des cliffhanger dignes des aventures de super-héros. Toutes ces pistes vont se cristalliser dans l’ultime épisode qui donne par un twist téméraire mais pas surprenant une autre vision de l’entièreté de la série. On pensait regarder une suite des nouvelles fantastiques, une version indonésienne des Contes de la crypte avec son influence EC Comics : en réalité nous regardions des origins stories de super-héros dignes de DC Comics. Il faut se rappeler que si Joko Anwar est depuis 20 ans le maître du cinéma d’horreur indonésien, il est aussi depuis plusieurs années la figure de proue d’un univers super héroïque au cinéma propre à l’Indonésie. Le Jagat Sinema Bumilangit est l’équivalent local des univers étendus hollywoodiens en continuant des figures héroïques locales qui existent depuis les années 50. Joko Anwar rend hommage à une partie de l’histoire du cinéma et de la BD de son pays en retournant aux origines pulp des deux émanations du genre qui proposaient au lecteur/spectateur de voyager dans les abysses des imaginaires dans des formats courts et jetables. Netflix est donc bien l’endroit approprié pour redonner vie à ces œuvres, du moins leur rendre hommage dans leur aspect populaire, grivois et parfois putassier. Il n’y aurait qu’un pas entre l’épouvante et l’héroïsme : celui d’une chute des corps ou de leur suspension. Il n’y aurait qu’une page à tourner, qu’un cut, qui nous ferait passer d’un monde à l’autre. C’est par ce prisme que Joko Anwar invite le monde à Jakarta et le révèle pour ceux qui y sont déjà. Une ville de luttes, de violences sociales et de drames qui dépassent l’entendement. C’est dans le stupre des zones d’ombres de la ville que brille l’or du cœur des gens qui se sont dressés pour dire non, pour se battre contre les injustices avec les habits oniriques des justiciers populaires. C’est dans la porosité et le glissement de ces imageries et imaginaires que le cinéaste nous embarque dans ces moments de peu de fortune. Dans le revers du flux, notre œil se laisse guider par ce tissu imaginaire qui constitue en réalité une culture commune comme un avenir commun. Puisque la lutte finale semble toujours reportée, le cinéaste nous propose au moins de nous y préparer par le rêve autant que par le cauchemar.
Kephren Montoute
Nightmares and Daydreams de Joko Anwar. Indonésie. 2024. Disponible sur Netflix




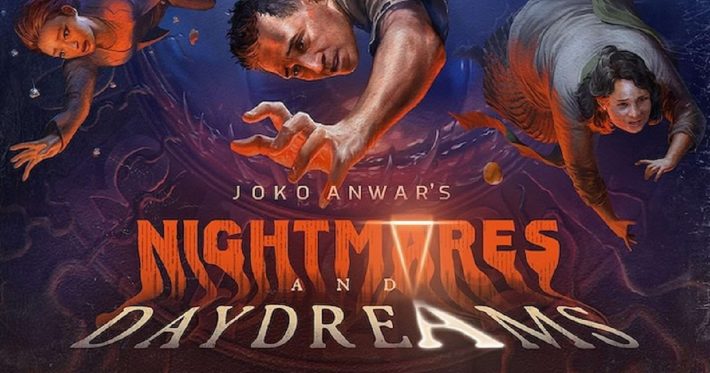
 Suivre
Suivre












