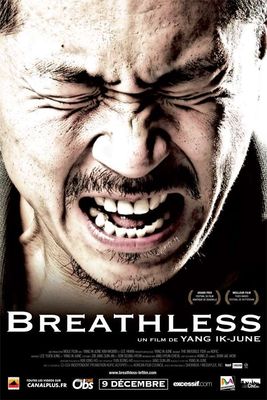La section Portrait faisait son grand retour au Festival du Film Coréen à Paris (FFCP) cette année. A l’honneur, la jeune cinéaste Kim Jung-eun qui venait présenter Gyeong-ah’s Daughter, un sensible premier long-métrage empreint d’une saine colère, sans éclats mais pas moins retentissante.
Yeon-su est une jeune prof. Elle vit seule dans un studio à Séoul mais retourne régulièrement chez sa mère, Gyeong-ah, qui vit à Incheon. La jeune femme a du mal à se remettre d’une récente rupture, d’autant que son ex la harcèle d’appels, sms et visites impromptues. La mère ne sait rien de la vie sentimentale de sa fille. Mais tout va changer lorsque Gyeong-ah reçoit un message qui va bouleverser leurs vies à toutes deux.

D’année en année, la veine très sociale de la jeune garde coréenne semble se confirmer davantage, avec des cinéastes déterminés à décortiquer (avec plus ou moins de succès) les dysfonctionnements de la société contemporaine. Kim Jung-eun se place complètement dans cette tendance et s’attaque, dans son premier long, à des sujets controversés qu’on pourrait vulgairement qualifier de « casse-gueule »: la relation mère/fille et la cybercriminalité sexuelle, plus particulièrement, le revenge-porn, un phénomène tristement répandu en Asie. De cette histoire d’intimité qui explose à plusieurs titres, la réalisatrice fait le choix judicieux de l’économie. Sans jamais perdre de vue son sujet, sans pour autant s’y laisser emprisonner, Kim Jung-eun travaille patiemment le quotidien et tente de sonder l’indicible (la pression, la déception, la honte, le non-dit) qui gangrène les rapports entre les personnages, qu’ils l’admettent ou non, et vient les dynamiter pour le meilleur ou pour le pire quand un cataclysme arrive.

Gyeong-ah’s Daughter n’est pas un film immédiatement aimable et c’est précisément ce qui le rend intéressant. Là où le sujet aurait pu amener à un certain sensationnalisme ou une certaine complaisance, l’intrigue se déroule ici dans une atmosphère classique et empreinte d’une forme d’austérité trompeuse. Il se dégage de la mise en scène une rigueur qui , certes, flirte parfois aux confins de la rigidité dans les moments les plus dramatiques, mais traduit bien plus souvent la détermination saisissante de son auteur à ne pas dévier de l’histoire qu’elle raconte et, avant tout, de sa loyauté envers ses personnages. En effet, si Gyeong-ah’s Daughter n’est pas un film émotif, il est profondément empathique dans sa manière de rester fermement ancré dans le parcours de Yeon-su (formidable Ha Yoon-kyung) et de la caractériser autant que possible, s’assurant ainsi de la faire pleinement exister dans le regard du spectateur, au delà de son statut de victime et de fille. Se plaçant volontairement dans cette perspective très contenue, et exclusivement féminine, Gyeong-ah’s Daughter propose une étude assez sensible, et sensée, du traumatisme et de la reconstruction. En témoigne l’utilisation efficace des espaces et du son, baignant le film dans une ambiance anxiogène qui nous garde en alerte face à chaque clic ou vibration de téléphone, comme pour incarner au plus près, le risque d’exposition constant auquel le personnage fait face.

Empathique, il l’est tout autant dans sa manière de réserver son jugement sur Gyeon-ah, mère envahissante confrontée à son aveuglement et à la remise en question de toutes ses convictions. Car, en pointillés, c’est avant tout une culture du tabou, notamment autour de la sexualité, que Kim Jung-eun pointe du doigt. Une culture transmise de génération en génération (dans l’éducation, les mœurs, les rapports sociaux et familiaux) justifiant les comportements les plus extrêmes et systématisant la honte comme l’émotion à adopter par défaut. En interrogeant si frontalement ce que l’on porte, ce que l’on transmet à un enfant (Yeon-su est d’ailleurs professeure, un métier qui n’a pas été choisi par hasard), et la responsabilité de l’accepter ou de s’en détacher, Gyeong-ah’s Daughter amorce une analyse prometteuse de la fameuse « piété filiale » (élargie dans le film aux quelques scènes secondaires sur l’avocate employant Gyeong-ah pour s’occuper de son père) qui a le mérite d’exister à défaut de la tenir jusqu’au bout.
En effet, le film s’essouffle dans une dernière partie qui semble très au clair avec sa conclusion mais hésitante quant au chemin à emprunter pour y parvenir. Cela tient peut-être au déséquilibre narratif qui se creuse de manière de plus en plus évidente au fur et à mesure que le récit avance. L’ampleur de l’arc de la fille se fait au détriment de celui de la mère qui demeure très opaque, et nous laisse trop combler des trous qui ressemblent davantage à des raccourcis scénaristiques, malgré l’interprétation tout en nuances de la comédienne Kim Jung-young. Les parcours peinent alors à se croiser et les scènes se répètent, heurtant la déconstruction de la filiation pourtant passionnante qui s’annonçait. En dépit de cela, Kim Jung-eun révèle un sacré tempérament dans un premier long-métrage souvent implacable, parfois terrifiant mais jamais défaitiste. Un tempérament qui n’a sans doute pas fini de vouloir s’exprimer.
Claire Lalaut
Gyeong-ah’s Daugter de Kim Jung-eun. 2021. Corée du Sud. Présenté au FFCP 2022





 Suivre
Suivre