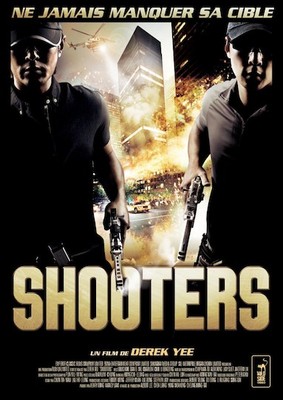La Belladone de la tristesse de Tamamoto Eiichi : un joyau sulfureux et rare de l’animation japonaise à (re)découvrir sur grand écran à l’occasion de sa diffusion au Black Movie de Genève dans une splendide restauration 4K.
L’histoire s’inspire des légendes médiévales autour de la sorcellerie. Une paysanne nommée Jeanne est violée par son seigneur, n’ayant pu obtenir le droit de se marier avec son amour, Jean, faute d’argent. Tous deux sont chassés du château, mais leur amour n’est plus le même et Jean la dédaigne. Le diable séduit alors Jeanne et en fait une sorcière puissante et désirée.
Le Studio Mushi s’est à l’origine imposé à la télévision au début des années 60 en adaptant les mangas les plus connus de son fondateur Tezuka Osamu (Astroboy, Le Roi Léo, Princesse Saphir). Mushi sera ainsi précurseur en imposant de nouveaux standards de production mais aussi artistiques pour suivre le rythme d’une diffusion télévisée. C’est dans une même démarche novatrice que Tezuka réoriente Mushi vers le cinéma au début des 70’s, cherchant à produire des films participant au courant érotique et psychédélique en essor au sein d’un nouveau public adulte potentiel. Trois films seront initiés dans ce sens avec la trilogie des Animera que forment Les Mille et une nuits (1969), Cléopâtre (1970) et donc Belladonna (1973). Tous seront des échecs commerciaux qui précipiteront la faillite du Studio Mushi.

Les trois films sont réalisés par Yamamoto Eiichi, véritable disciple de Tezuka dont il s’affranchit réellement de l’influence esthétique avec Belladonna. Le film est l’adaptation du roman La Sorcière de Jules Michelet paru en 1862. L’ouvrage est un brûlot féministe et anticlérical dont les préoccupations entrent en parfaite connexion avec la contre-culture qui se développe à l’époque. Yamamoto façonne ainsi un Moyen-Age cauchemardesque, en particulier pour les femmes, où la religion est un moyen d’abus sous couvert de piété. L’héroïne Jeanne sera la victime d’un cruel droit de cuissage de la part de son seigneur, la masculinité s’exprimant à la fois sous un jour tyrannique mais également lâche et opportuniste avec le personnage du mari, Jean. Le lien à la contre-culture se fera par la nature de l’émancipation de Jeanne qui se détourne de ces valeurs religieuses hypocrites en vendant son âme au Diable, puis en s’abandonnant à ses instincts lascifs sous les effets de la fleur de belladonne. Ainsi émancipée des codes moraux viciés du monde, elle est invulnérable et entraînera les villageois opprimés dans son sillage. L’aspect anticlérical est bien là mais demeure superficiel du fait de l’absence de réelle tradition chrétienne au Japon et les écarts sont plus sources d’inventions graphiques surprenantes que de vraies transgressions religieuses – qu’on peut juger dans un pinku eiga comme Le Couvent de la bête sacrée. C’est réellement la notion de féminisme par l’ivresse opiacée et sexuelle qui intéresse Yamamoto.

C’est d’abord la facette austère qui domine, afin de traduire visuellement la souffrance soumise de Jeanne. Yamamoto reprend les préceptes d’animation « figée » de Mushi, non pas pour faire des économies comme sur les séries télévisées mais pour donner une dimension purement figurative au récit à travers une suite d’images/tableaux fixe. Le film alterne les techniques, atmosphères et influences graphiques (Gustav Klimt, Odilon Redon, Alphonse Mucha, Egon Schiele et Félicien Rops…) au gré des sentiments de l’héroïne. Le début oppressant, gris et austère traduit l’impuissance d’une Jeanne apeurée, le premier choc et l’irruption de la couleur se faisant avec l’image répétitive de son entrejambe déchiré qui larde l’image d’un jet écarlate. La figure inquisitrice du seigneur arbore l’allure hiératique de la silhouette d’un carte de tarot tandis que le décor stylisé et imposant convoque L’Art Nouveau. Plus Jeanne est vulnérable et à la merci de ses ennemis, plus le cadre sera dépouillé avec comme sommet l’après viol où sans repère, elle apparaît prostrée dans un tableau en aquarelle terne et tout juste esquissé.

L’excentricité apparaît progressivement, notamment avec l’illustration du démon qui a l’aspect d’un sexe masculin parlant. La métaphore est explicite, Jeanne manipulant ce phallus qui grandit tandis que la voix du démon (doublée par Nakadai Tatsuya) se fait enjôleuse puis autoritaire. Dès lors, c’est l’environnement entier qui se surcharge de forme et de couleurs dans un véritable trip halluciné sur la vertigineuse bande-son psyché de Sato Masahiko. La transformation dépasse alors la seule Jeanne devenue sorcière toute puissante pour contaminer les villageois à travers les vapeurs bienfaitrices de la belladone. Plus aucune peur ou inhibitions ne viendra interrompre des fresques d’orgie dantesque où l’individu s’oublie parmi les corps d’hommes, d’animaux et de démons entremêlés pour une pure extase dionysiaque. La sorcière, chevelure démesurée au vent, domine de toute sa langueur décomplexée et de sa douce voix cette luxure. Le film trouve sa propre voix tout étant en parfaite continuité avec son époque puisque l’on pense autant aux Diables de Ken Russell qu’à El Topo (1971) d’Alejandro Jodorowski qui conjuguent également le trip à un vrai propos politique et la provocation. Le final sacrificiel lorgne d’ailleurs vers le classique de Russell en ranimant l’imagerie religieuse dans la tragédie. Mais Yamamoto ne perd jamais de vue qu’il narre avant tout un portrait de femme, une amoureuse qui le restera et qui cède à son humanité au détriment d’un pouvoir immense. Elle devient une icône christique au féminin, destinée à accompagner tous les combats des femmes à travers les siècles dans un montage audacieux en forme d’association d’idées. Un véritable ovni qu’il fait bon de (re)découvrir.
Justin Kwedi.
Belladonna de Yamamoto Eiichi. Japon. 1973.
Présenté au Black Movie 2017 de Genève.





 Suivre
Suivre