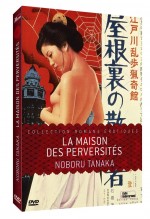Ozu Yasujirô apparaît certainement dans l’histoire du cinéma comme l’un des réalisateurs qui, au fil de ses œuvres, a su construire le mieux un univers original et personnel. Il est frappant de découvrir à quel point les thèmes de ses films s’emboîtent les uns les autres avec une certaine logique.
Certains thèmes introduits dès ses premiers films n’ont cessé d’être repris et développés dans des œuvres ultérieures : la relation entre le père et le fils de Chœur de Tokyo est étoffée dans Gosses de Tokyo dont certains éléments sont repris par la suite dans Bonjour. Le père au chômage d’Une auberge à Tokyo renvoie à celui de Chœur de Tokyo. Le goût du riz au thé vert compose avec la même pléiade de personnages que Qu’est-ce que la dame a oublié ?. Les frères et sœurs Toda prépare la structure narrative de Voyage à Tokyo. Herbes Flottantes est, quant à lui, un remake assumé de Récit d’herbes flottantes.
D’autres films présentent, d’un autre côté, de subtiles variations sur des thèmes prédéveloppés. Dès le muet, des films comme J’ai été recalé, mais… et J’ai été diplômé, mais… présentent, comme leur titre l’indique, deux récits complémentaires. La vie de débauche menée par le personnage de la sœur dans Une femme de Tokyo constitue le pendant féminin des mésaventures du frère de Femmes et voyous. Il était un père constitue, de son côté, le pendant masculin du Fils unique. Fin d’automne, quant à lui, est une relecture de Printemps tardif, dans la mesure où le premier développe les relations entre une mère et sa fille tandis que le second est centré sur les rapports entre un père et son enfant. Ces deux derniers films présentent par ailleurs un même dénouement.
Dans un même ordre d’idées, Ozu n’a jamais cessé de faire tourner les mêmes acteurs au fil des différentes périodes de sa filmographie (Tatsuo Saito, Takeshi Sakamoto et Chôko Iida pour le muet ; Chishû Ryû, Setsuko Hara, Haruko Sugimura et Shin Saburi, entre autres, pour le parlant). Le cinéaste tend également à utiliser de mêmes décors. Si certaines séquences des films muets semblent avoir été tournées dans de mêmes lieux en extérieur, c’est avant tout dans les derniers d’Ozu que cet aspect de son œuvre trouve son apogée : un certain restaurant, nommé Wakamatsu, apparaît tout aussi bien dans Fleurs d’équinoxe, Fin d’automne que dans Le goût du saké et chacune de ses apparitions met en scène les mêmes acteurs. On peut aussi relever le fait que le lieu de travail du personnage principal de Fin d’automne constitue exactement le même décor que dans Fleurs d’équinoxe – relation d’autant plus renforcée que dans les deux films, le bureau est également occupé par le même acteur.
Ces quelques exemples suffisent pour indiquer à quel point l’univers dépeint par Ozu se montre particulièrement homogène, comme si l’ensemble de ses films formait une seule et même œuvre, dont le propre consisterait à donner une image la plus réaliste possible du Japon qui lui est contemporain. Le cinéaste Kijû Yoshida rapporte dans son livre sur Ozu (Ozu, ou l’Anti-Cinéma) le fait que lorsqu’on interrogeait le réalisateur sur les raisons pour lesquelles celui-ci n’avait jamais cherché à développer des thèmes différents ou à explorer d’autres genres cinématographiques, Ozu se comparait volontiers à un marchand de tofu qui toute sa vie durant se contente de préparer et de vendre un même produit.
Si Ozu est comparable à un marchand de tofu, il faut toutefois préciser qu’il ne s’est jamais contenté d’appliquer la même recette au long sa carrière. L’un des secrets de son œuvre, c’est que, par-delà la reprise des mêmes thèmes et des mêmes acteurs, le cinéaste s’est toujours appliqué à améliorer sa façon de faire. Des premiers films muets, largement inspirés des productions américaines de l’époque (films burlesques et films noirs), aux dernières œuvres, où affleure un style éminemment personnel et original, l’écart parcouru s’avère particulièrement important.
Les films d’Ozu suivent de près, sans évidemment être les seuls, une grande partie de l’histoire du cinéma du XXème siècle. Le cinéaste a commencé par réaliser des films muets, s’est ensuite mis au parlant, puis dans sa dernière période, aux films en couleurs. Son œuvre se rapporte de plus à toute une part importante de l’histoire du Japon, dans la mesure où sont traités en toile de fond des évènements importants comme la crise économique des années 30, l’impact de la guerre du Pacifique sur la société japonaise et l’américanisation qui s’en est suivie à partir des années 50.
Il est vrai cependant qu’un seul et même point de vue traverse l’ensemble de la filmographie du cinéaste : celui de monsieur tout le monde et de son quotidien, de ses préoccupations et de ses espoirs. Les films d’Ozu ont beau être rattachés au plus profond d’eux-mêmes à une culture et à une histoire précises, il n’en reste pas moins vrai que, d’une évidence et d’une clarté des plus rares, ils affichent une portée universelle. Le regain de curiosité que l’on voue à son œuvre en est assurément la preuve.
Des ronds dans l’eau
Les films muets d’Ozu reposent pour la plupart sur des récits de jeunes diplômés, de laissés-pour-compte ou de voyous qui cherchent à se faire ou à se racheter une place dans la société. La difficulté pour ces personnages consiste à se conformer à ce que les autres attendent d’eux, tout en s’efforçant d’agir comme bon leur semble, de préserver l’impétuosité de leur jeunesse. On a là, signalons-le au passage, un type de conflit assez proche des romans de Natsume Sôseki, Botchan et Sanshirô en particulier, dont Ozu semble prolonger à l’écran, du moins au début de sa carrière, la même vision du Japon. D’autres films, dans une même optique, mettent en scène des personnages d’enfants (Chœur de Tokyo, Gosses de Tokyo) qui cherchent à s’épanouir malgré les remontrances et les interdits que ne cessent de leur imposer leurs parents.

Gosses de Tokyo
Une partie des premiers films d’Ozu semble traversée par des problèmes de conformité ou de filiation que la société ou la cellule familiale attend des personnages. Si le fils turbulent et capricieux de Chœur de Tokyo renvoie assurément à son père, qui sous son autorité cache une éternelle âme d’enfant, le problème pour ce dernier consiste à acquérir une certaine autorité et de cette façon à prendre la place qu’occupait le professeur de lycée qu’il abhorrait au temps de sa jeunesse. Il s’agit pour tous ces personnages de trouver un équilibre entre soi et les autres, l’impétuosité et l’ordre convenu. Leur principal problème consiste à accepter l’autre et sa vison du monde (les enfants de Gosses de Tokyo vont devoir comprendre leur père et les mécanismes de la société), ou encore, cela est manifeste dans les films parlants, à savoir tenir une place dans l’organisation familiale (les filles à marier des derniers films d’Ozu doivent à leur tour fonder une famille malgré leur réticence). Entretenir une relation avec autrui et se conformer aux exigences extérieures pour tâcher d’acquérir un rôle dans le monde revient dans cette mesure à accepter de sacrifier une partie de soi. Chez Ozu, le fait de perdre ses rêves de jeunesse est une condition nécessaire pour devenir adulte et responsable, comme finissent par le comprendre les personnages principaux de Chœur de Tokyo et de Cœur capricieux.
Pour reprendre les propos de Kijû Yoshida dans son même ouvrage, le drame naît chez Ozu à partir du moment où un personnage n’occupe plus la place qui lui est dévolue : les problèmes commencent dès qu’un père n’agit plus comme tel ou qu’une fille ne réagit pas comme elle le devrait. On pourrait développer l’idée en précisant que le drame intervient quand la volonté de l’un (tel personnage incarnant le désordre, le divertissement, la frivolité) ne répond pas aux exigences de l’autre (tel autre du côté de l’ordre, du devoir, des exigences sociales ou familiales). Il s’agit donc pour ces deux types de personnages de trouver un équilibre qui leur permettrait de s’accepter l’un l’autre pour pouvoir vivre sous un même toit, ou au contraire de savoir se séparer sans heurts, ni regrets.
On constate alors que, dès le muet, les personnages des films d’Ozu se définissent moins par leur individualité que par leurs relations avec les autres (c’est parce qu’il n’est pas comme les autres étudiants que le personnage principal de Chœur de Tokyo est singularisé). On a donc affaire à des personnages psychologiquement neutres, quasi interchangeables d’un film à l’autre, mais vis-à-vis desquels les relations avec leurs proches viennent donner un sens et constituer une figure précise.
Les protagonistes entretiennent les uns les autres un système de relations fondé sur un principe d’imitation ou, c’est plus rare, de rejet (Crépuscule à Tokyo, Le goût du saké). En ce sens, on pourrait rapprocher ce qui est à l’œuvre dans les films d’Ozu à l’image d’un rond dans l’eau, ou de tout autre effet de vibration : en jetant un pavé dans une mare, on provoque une série de remous qui tracent des courbes régulières, jusqu’à ce que, c’est là que le drame survient, le rond butte sur un obstacle, qu’un personnage refuse de suivre le mouvement commun.
Entretenir une relation avec autrui, se fondre dans les remous du rond dans l’eau, se traduit à l’écran, et c’est là l’une des singularités les plus frappantes des films d’Ozu, par le fait que des personnages, placés sur une même longueur d’onde, finissent par se ressembler en répétant les mêmes gestes. Le père et le fils d’Il était un père, comme l’enfant abandonné et la dame qui se voit contrainte de l’héberger dans Récit d’un propriétaire, finissent par se ressembler, non pas de caractère, ni bien sûr physiquement, mais dans leur principe même de figuration, comme si l’un était devenu l’ombre de l’autre. La séquence de la partie de pêche dans Il était un père (reprise par ailleurs dans Herbes flottantes) pendant laquelle les deux protagonistes principaux reproduisent exactement les mêmes gestes est à cet égard un exemple particulièrement éloquent.
De façon plus subtile encore, dans les derniers films d’Ozu, les personnages en phase l’un avec l’autre ont tendance à prendre une même posture accroupie et à regarder côte à côte dans une même direction. Ces personnages finissent dès lors par épouser un même rythme, comme les deux faces d’une même figure. Dans Fin d’automne, la fille et la mère en viennent à paraître quasi équivalentes, comme si l’une était la projection de l’autre, dès lors que la fille accepte de se marier et décide de suivre la voie que sa mère a jusqu’ici parcourue.
Il arrive a contrario qu’un décalage se crée entre les personnages. Le patriarche de Dernier caprice entend continuer à vivre comme bon lui semble, de sorte que le dynamisme qui le caractérise contraste avec l’immobilisme des membres de sa famille. Dans Le goût du saké, le personnage du professeur à la retraite, devenu alcoolique et misérable, et surtout responsable du malheur de sa fille qu’il n’a pas voulu marier pour la garder auprès de lui, constitue ce à quoi pourrait ressembler le personnage principal si lui-même ne marie pas rapidement sa propre fille.
Dans les films d’Ozu, plutôt que sur l’individualité des personnages, c’est sur leur relation que l’accent est mis et à partir de quoi intervient le drame. La psychologie naît du rapprochement de deux personnages, et non comme une donnée fournie a priori et à laquelle tout le film chercherait à épaissir le trait. Chez Ozu, il n’est nul héros, ni personnalité forte, influente, extravertie, mais des rapports humains scrutés avec une extrême minutie.
Vivre sous un même toit
L’une des caractéristiques les plus frappantes dans l’organisation de l’espace des films d’Ozu vient du fait qu’on ne voit que rarement les personnages aller d’un endroit à un autre. Ozu fait un usage abondant des ellipses narratives et privilégie à la représentation du mouvement une mise en scène relativement statique. Il en ressort l’impression que, comme au théâtre, ce ne sont pas les personnages qui se déplacent, mais le décor derrière eux qui, telle une toile de fond, change de forme.
Cette suppression des lieux intermédiaires est de plus en plus marquée au fil de la filmographie. Dans Dernier caprice, par exemple, le grand-père va régulièrement dans un quartier de Kyoto, sans qu’aucune séquence ne mesure le trajet parcouru, pour se rendre, à l’insu de sa propre famille, à la maison de son ancienne maîtresse. Ce dernier logement apparaît comme s’il se situait dans le même pâté de maisons, à quelques pas seulement de la résidence familiale.
Dans Fleurs d’équinoxe, la famille dont le film dresse le portrait part en week-end et se retrouve au bord d’un lac par un simple montage cut. Il en va de même pour Fin d’automne lorsqu’à la fin du film, la mère et sa fille partent pour un dernier voyage ensemble sans que leur déplacement ne soit représenté. On trouve le même procédé dans Voyage à Tokyo au cours duquel les parents se rendent à la capitale puis rentrent chez eux presque instantanément.
Un tel dispositif réorganise l’espace en différentes zones par-delà la disposition logique des lieux représentés. Certains points éloignés dans l’espace logique du récit finissent par paraître contigus. Il suffit pour les personnages d’exprimer le souhait de se rendre dans tel lieu, et d’éprouver certaines affinités avec les individus qui s’y trouvent, pour s’y rendre comme par enchantement.
A plus petite échelle, on relève dans Récit d’un propriétaire, Printemps précoce ou Bonjour, un procédé pour lequel l’entrée de telle habitation donne directement sur l’entrée du logement qui lui fait face, dans la mesure où la rue, et la profondeur qu’elle suppose, est effacée du champ. Un simple raccord de mouvement permet alors aux personnages de passer d’une maison à l’autre. Celles-ci semblent communiquer les unes avec les autres pour constituer un espace commun – placé sous le signe de la relation de voisinage et de l’échange de ragots –, et renforcer dans le même temps l’isolement des espaces privés et la réalité du drame qui s’y déroule.
On remarque en effet, notamment à partir de Qu’est-ce que la dame a oublié ?, que les personnages ont tendance à fuir les espaces communs pour apparaître dans des lieux qui leur sont constamment associés (bureau, bar, restaurant, etc.), de sorte que les protagonistes principaux en viennent à évoluer dans des zones qui leur sont réservées pour se retrouver en compagnie de personnages secondaires avec lesquels ils partagent une certaine affinité. Il ressort de ce type de configuration : d’un côté, un espace commun dans lequel on affronte l’autre (l’ordre contre l’impétuosité) et d’un autre côté, un espace privé dans lequel on vient se réfugier pour se ressourcer.
Dans son ouvrage consacré aux films d’Ozu, Shigehiko Hasumi insiste sur un procédé particulièrement significatif de cette conception de l’espace. Le cinéaste s’applique en effet, à partir de Printemps tardif, à supprimer systématiquement de l’écran toute représentation de l’escalier qui relie en toute logique les deux étages des habitations dans lesquelles le drame se déroule. Cet effacement contribue à séparer l’espace privé du personnage qui réside à l’étage – la fille à marier de Printemps tardif – de l’espace commun que constitue le rez-de-chaussée, habité par son père. Une scène de conflit qui vient opposer, dans le même film, les deux parents se résout par la fuite de la fille dans sa chambre, au prix d’un faux raccord de mouvement motivé par la suppression de l’escalier, comme si en s’éloignant de son père, la fille refusait tout à la fois de partager l’espace qui leur est commun et d’accepter le projet qui lui est réservé, le fait de se marier. A la déchirure spatiale se conjugue une déchirure sentimentale.
Un tel procédé réapparaît régulièrement dans toute la dernière période d’Ozu. Dans Printemps précoce, la scène de ménage qui éclate entre les deux personnages principaux répond à un même dispositif dans la mesure où la séquence finit par disposer les protagonistes dans des deux zones différentes, l’un à l’étage, l’autre au rez-de-chaussée, tandis que l’escalier, qui constitue le lien entre les espaces, n’est pas représenté. Chaque protagoniste en vient à un moment ou un autre à se réfugier dans la zone qui lui est dévolue. Le procédé est réutilisé dans Herbes flottantes lorsque le couple principal du film décide de rompre ; leur séparation est mise en valeur par le dispositif spatial qui, sous couvert d’un champ/contrechamp, place chaque personnage d’un côté de la rue en les séparant par un rideau de pluie.
L’organisation spatiale prend appui sur l’éclatement des lieux, découpés les uns des autres sous la forme d’une mosaïque, à contre-courant des principes de découpage hollywoodiens, hérités de Griffith, dont Ozu a pu s’inspirer au début de sa carrière et qui supposent une plus forte homogénéité de l’espace diégétique. L’important pour Ozu n’est pas de découper l’espace de ses films selon des coordonnées réalistes et logiques, mais de subordonner l’organisation spatiale des récits à une écriture dramatique pour laquelle chaque lieu vaut pour la relation de confiance ou de rejet qui se joue entre les personnages impliqués. Tout le problème des protagonistes revient le plus souvent chez Ozu à accepter de vivre sous un même toit, à ramener l’espace privé dans l’espace commun, à l’image des deux personnages principaux du Goût du riz au thé vert qui finissent par s’accepter tels qu’ils sont en faisant irruption dans une pièce de leur maison que seule leur servante a l’habitude d’occuper, leur cuisine.
Drames de la vie quotidienne
A partir du parlant, voire de certaines productions de l’époque du muet (Gosses de Tokyo), les films d’Ozu tendent à multiplier les personnages secondaires. Un film comme Eté précoce, par exemple, met en scène trois générations d’une même famille sous un même toit, de sorte que chacune d’entre elles est concernée soit par des problèmes qui lui sont propres soit par des problèmes communs à toute la famille. De même que l’espace paraît fractionné en différentes zones, l’organisation du récit repose sur une même structure en mosaïque au gré de laquelle chaque membre de la famille est susceptible d’apparaître comme le fil conducteur d’une séquence particulière.
L’intrigue du Goût du saké, qui se situe à l’apogée de ce type d’écriture, se voit diluée dans une multitude de scènes n’entretenant qu’un minimum de rapports les unes avec les autres. Celles-ci introduisent des protagonistes qui pour certains ne se rencontreront jamais, et dont le seul lien est constitué par le père de famille. Tout fonctionne dans ce film comme si chaque ensemble de saynètes présentait les différentes facettes de la vie de couple afin de donner une certaine résonance à ce qui préoccupe le personnage principal, le mariage de sa fille. Apparaissent alternativement dans le cours du film, un jeune couple en ménage, les amis du personnage principal qui contrairement à lui ont déjà casé leur fille, et parmi lesquels on trouve le personnage du veuf qui s’est remarié, le professeur affligé par le fait de ne pas avoir marié sa fille, la serveuse du bar qui ressemble à l’épouse décédée. Chaque protagoniste vit une existence autonome de façon à ce qu’autour du récit central s’organise toute une série de micro récits (le jeune couple se dispute à propos de l’achat de clubs de golf, par exemple) visant à un effet de dédramatisation.
A partir de Printemps tardif en effet, le drame des films d’Ozu se nourrit exclusivement d’éléments issus de la vie quotidienne. Cela est également vrai pour les films d’avant-guerre, mais cette tendance paraît bien plus évidente après Une poule dans le vent qui constitue probablement la dernière incursion du cinéaste dans le domaine dramatique au sens classique du terme. On assiste tout au long de la filmographie d’Ozu à l’émergence d’une écriture qui consiste à mettre l’accent sur les moments faibles du drame au détriment des moments forts. Le récit prend appui sur des situations banales (boire, manger, recevoir, inviter, voyager) et des conversations ordinaires (le temps qu’il fait, la vie qui passe, le pays qui change), le tout relevé de quelques pointes d’humour.
Les moments dramatiques forts sont quant à eux désamorcés de toute portée émotionnelle trop marquée, ou si l’on veut larmoyante, pour affluer dans un rythme commun à l’ensemble des scènes des films. Aux plans de tels personnages succèdent des plans vides, de même qu’aux scènes de discussion succèdent des plans muets ou accompagnés de quelques bruits de fond (voitures qui passent, trains, passants, moteur de bateaux, aboiements de chien, sons de piano, chants, etc.). Ainsi, dans Le fils unique, la scène douloureuse où, un soir le fils avoue à sa mère ses regrets quant à sa vie actuelle, finit sur un long plan vide au cours duquel on peut entendre quelques sanglots avant que le soleil ne finisse par se lever.
De même, la mort du père dans Les frères et sœurs Toda est signifiée par un plan sur une horloge pendant lequel on peut entendre les bribes d’une prière qui viennent amorcer un plan de chapeaux, ceux précisément des invités à la cérémonie funéraire qu’on voit par la suite. Idem pour la mort par noyade du lycéen dans Il était un père suggérée par un plan sur une lanterne de pierre, puis sur le lac où a eu lieu l’accident et au cours duquel on entend quelque mélopée funéraire qui conduit sur la cérémonie qui lui correspond. On relève encore la scène de prostitution d’Une poule dans le vent qui donne à voir une suite de plans vides de l’intérieur de la maison de prostitution, auxquels s’ensuit une scène dans laquelle deux femmes disent entendre quelqu’un en train de pleurer.
Les exemples abondent dans lesquels Ozu décide de cacher certains événements, dans le but d’évincer tout effet dramatique qui entrerait en contradiction avec le rythme général dans lequel baignent ses films. Le cinéaste préfère suggérer, bien souvent par quelques plans vides, ce qu’il se refuse à montrer.
Dans Fin d’automne, la scène du mariage final n’est pas portée à l’écran alors que tout le film prépare à cet événement. Le même procédé apparaît dans Fleurs d’équinoxe qui supprime la cérémonie de mariage de la fin du film, alors que le récit s’ouvre sur une autre scène de mariage concernant un couple dont on ne sait presque rien.
Dans Le goût du saké, la rencontre organisée entre la fille à marier et son prétendant – qu’on ne voit jamais – n’est pas représentée non plus. Une fois la rencontre décidée, on passe à quelques plans en extérieurs pour découvrir immédiatement la scène de préparation du mariage qui, à son tour, est suivie de quelques plans vides en intérieur, et aboutit sur une nouvelle séquence pendant laquelle le père retrouve ses amis après la cérémonie.
Tout fonctionne par conséquent comme si le processus narratif privilégiait le déroulement de telle action au détriment de sa résolution ; ou encore, comme si Ozu accordait plus d’importance à la résonance de telle relation conflictuelle qu’à la consolidation expressive des sentiments mis en jeu.
Des objets et des hommes
Du muet jusqu’aux films en couleurs, on constate une forte attention portée sur les objets de la vie quotidienne. L’espace filmique tel qu’Ozu le conçoit au fur et à mesure de ses réalisations se divise en deux zones distinctes : un espace proprement humain qui correspond le plus souvent aux scènes d’intérieur, et un espace plus large, constitué de plans descriptifs de la ville, des rues, des immeubles ou des jardins, que le cinéaste emboîte au précédent par l’intermédiaire d’un simple montage cut motivé ou non par un raccord regard. Ces deux espaces, infra et supra, partagent une même tendance à se charger d’objets divers, parmi lesquels on note une préférence pour toutes sortes de récipients (seau, bouilloire, baquet, extincteur, etc.).
Sur le même principe que l’agencement des lieux, l’organisation du cadre repose sur un principe de fragmentation qui s’explique par la présence quasi continue de différents objets placés le plus souvent au premier plan, et derrière lesquels s’accomplit le récit proprement dit. Ceux-ci peuvent tout aussi bien renseigner sur le niveau social des protagonistes que sur le résultat de telle action (l’irruption de la police dans l’appartement du couple de malfaiteurs de Femmes et voyous est suggérée par le désordre qui y est provoqué).
Si la plupart des objets ne jouent qu’une fonction purement décorative, certains d’entre eux semblent cependant avoir quelque chose à dire en lieu et place des personnages. Il arrive en effet qu’une relation métonymique se noue entre les objets et les personnages et qu’un certain raccourci se crée par là dans le tissu filmique.
Le déplacement de la jeune actrice de théâtre d’Histoires d’herbes flottantes, partie pour un rendez-vous amoureux, est suggéré par un plan sur son vélo laissé en pleine campagne. La séquence suivante, filmée dans l’auberge où le personnage réside, est amorcée par un plan sur le même vélo revenu à son emplacement d’origine. Les deux enfants de Bonjour, de leur côté, prennent soin d’emporter une bouilloire et un peu de riz dans un récipient avant de mener leur fugue. Tombant sur un policier devant lequel ils s’enfuient, les garnements abandonnent les objets derrière eux. La séquence qui s’ensuit montre les deux récipients posés dans le coin d’un poste de police. On comprend en un instant que leur disparition a été signalée.
D’autres objets jouent quant à eux un rôle métaphorique. On a déjà vu que les plans d’une horloge ou d’une lanterne de pierre pouvaient suggérer la mort d’un protagoniste en se substituant à l’événement en question. Dans un même ordre d’idées, certains objets se montrent susceptibles de suggérer le sentiment ressenti par un personnage. Il en va ainsi d’une célèbre scène de Printemps tardif dans laquelle la fille à marier s’adresse à son père alors que celui-ci s’est endormi. Un vase apparaît deux fois à l’écran par le biais d’un montage cut tandis qu’on continue à entendre les ronflements du père. Particulièrement somptueux, l’objet donne à voir une certaine image du père tel que sa fille, qui ne veut pas se séparer de lui, se le représente. Un procédé similaire apparaît à la fin de Voyage à Tokyo lorsque le fils cadet, arrivé chez ses parents alors que sa mère est décédée quelques heures plus tôt, sort de la maison familiale. Un plan furtif représente des pierres tombales dans un faux raccord regard, comme pour souligner l’émotion qui s’est emparée du protagoniste. Ces deux derniers exemples sont rares cependant : Ozu semble éviter par la suite d’exprimer visuellement les sentiments dont ses personnages sont traversés.
Il semble en effet que le cinéaste ait tendance à privilégier des plans de protagonistes esseulés, en train de réfléchir, sans rien préciser de leurs idées. Citons la mère à un moment crucial d’Une poule dans le vent, le père dans les derniers plans de Printemps tardif, ou encore la mère dans la dernière séquence de Fin d’automne. Rien ne permet de savoir exactement à quoi pensent ces personnages tant qu’aucun autre protagoniste n’est là pour les faire parler. Immobiles et inexpressifs, les personnages dans ce type de plans semblent partager les mêmes caractéristiques figuratives que les objets qui les entourent, au point qu’on pourrait les désigner comme des objets qui pensent et qui, tels des récipients, contiennent quelque chose qu’on ne saurait voir. L’enjeu de la majorité des films d’Ozu consiste, comme on va le voir, à faire sortir ce qui s’y trouve.
Au revers des images
Avec Printemps tardif, encore une fois, la mise en scène d’Ozu entre dans sa période de maturité : la caméra se trouve systématiquement placée au ras du sol et permet au cinéaste d’atténuer la profondeur de champ, ou de n’en laisser subsister qu’une petite partie. Le cadrage, dans les plans d’ensemble, prend appui sur un fond percé d’une ouverture qui se situe au centre du cadre, face à la caméra (fenêtre, shôji, fusuma, porte, etc.), de façon à ce que la profondeur de champ, dans les scènes d’intérieur comme en extérieur, se voit ramenée à une superposition de deux ou trois plans transversaux dont la communication s’effectue par l’ouverture en question. L’utilisation systématique de l’objectif 50 mm renforce d’autant plus l’écrasement de ces plans et souligne l’aspect bidimensionnel de l’image.
Avec l’apparition de la couleur, cette conception du cadre ramené à un plan en deux dimensions trouve une nouvelle ampleur. Ozu choisit de prêter aux objets et aux vêtements portés par les personnages des couleurs vives (rouge, jaune, vert) d’autant plus soulignées qu’elles ressortent sur des fonds neutres. Les objets comme les personnages se définissent comme autant de points chauds et lumineux, éparpillés un peu partout dans le cadre, de sorte qu’on est amené moins à les distinguer les uns des autres pour ce qu’ils sont qu’à apprécier de simples différences de tons. Les personnages et les objets semblent pétris dans une même pâte filmique, comme dans l’espace d’un tableau. On sait par ailleurs qu’Ozu, soucieux du moindre détail, a conçu lui-même le design d’un certain nombre d’objets qu’on voit dans ses films, comme s’il avait voulu accorder autant d’importance aux objets qu’à ses personnages.
Dans ses derniers films (Fleurs d’équinoxe, Fin d’automne, Le goût du saké), Ozu introduit dans ses séquences en intérieur une série de tableaux particulièrement colorés dont certains encore une fois sont signés par Ozu lui-même. Accrochés au fond du cadre, ces tableaux sont perçus frontalement et parsèment le cadre de petites zones en deux dimensions entre lesquelles les personnages viennent se positionner. Filmés avec une même focale longue que dans les scènes en intérieur, les plans de ruelles qui abondent dans la dernière période d’Ozu concourent à un effet similaire en parsemant le cadre de différents panneaux. Il en ressort l’impression que les personnages semblent évoluer bien moins dans un décor objectif, profond et palpable que dans des zones stylisées, des surfaces riches en couleurs et fragmentées en petits morceaux.
L’utilisation de ces panneaux, comme presque tout plan extérieur intercalé entre les séquences, paraît amorcer par un plan descriptif un lieu qui leur correspond systématiquement : tel bar par telle pancarte, tel logement par telle rue, ou encore l’usine qui apparait dans Le goût du saké par un plan sur des cheminées fumantes. Tout paraît fonctionner comme si, saisi dans un plan à deux dimensions, chaque espace se distinguait par une façade et un fond, de sorte que lorsque la caméra s’introduit dans tel lieu, elle semble passer en réalité de l’autre côté de l’image. L’infra espace apparaît dans cette optique comme le revers du supra espace.
Il semble qu’un principe équivalent soit à l’œuvre dans la représentation même des personnages. On remarque que, dans la relation conflictuelle qu’entretiennent les personnages principaux, ceux-ci peinent à exprimer leur sentiment, et que celui-ci, le plus souvent latent, ne perce qu’à de rares moments pour éventuellement prêter à confusion. Pourquoi, par exemple, la fille de Printemps tardif accepte de se marier contre toute attente ? Le père du même film, contrairement à ses propos, ne souffre-t-il pas lui aussi de cette séparation ? Ozu semble aimer à jouer avec l’ambiguïté : on trouve dans ses films beaucoup de non-dits, il s’y trame toujours quelque chose que le cinéaste évite de clarifier. On peut supposer que les sentiments qui agitent les personnages forment en ce sens le revers des images, ce qui ne saurait être vu mais qui à un moment crucial du récit est susceptible de surgir à la surface du film.
Toute la difficulté des personnages consiste à exprimer et à défendre leur propre point de vue face aux autres, c’est-à-dire à s’imposer dans l’espace commun. De même que les films montrent des personnages en train de passer l’essentiel de leur temps à boire et à manger, c’est-à-dire à vider des récipients, ceux-ci s’efforcent dans le même temps de se confier ou de vider leur sac, de formuler leur vrai sentiment « comme dans un rêve », comme on peut l’entendre dans Eté précoce.
Il arrive lorsque deux personnages sont en pleine discussion qu’au moins l’un d’entre eux soit filmé de face, en plan rapproché, de façon à ce que le regard de l’un ne peut raccorder avec celui de l’autre. Typique de la dernière période d’Ozu, cette technique constitue certainement l’élément stylistique le plus original de toute son œuvre. Celle-ci semble employée lorsque le personnage concerné est amené à parler sans aucun détour, avec son cœur.
Saisis devant un fond légèrement flou, sans aucun effet de profondeur, de tels personnages apparaissent dans des espaces réduits à deux dimensions qu’on suppose dotés d’un endroit (l’expression, l’apparence) et d’un envers (le sentiment, le cœur), autrement dit d’une part visible, ouverte sur les autres, et d’une part enfouie au plus profond d’eux-mêmes. Filmer les personnages face à la caméra suggérerait l’idée selon laquelle le moi sincère et enfoui de tel personnage finit par se trouver sur la même longueur d’onde que le regard de l’autre. Tout à la fois en phase avec eux-mêmes et en parfaite harmonie avec l’autre, les personnages se définissent comme si leur expression répondait en tout point à leur sentiment, comme si l’image avait basculé dans son propre envers.
L’exemple le plus frappant d’une telle technique apparaît dans le dénouement de Fin d’automne lorsqu’un champ/contrechamp à 180°, à l’encontre de toute règle académique, relie les personnages de la mère et de la fille, toutes deux saisies face à la caméra, comme si, par un effet de miroir, l’une apparaissait comme l’émanation de l’autre, dans une relation des plus harmonieuses.
On pourrait en conclure que le déroulement du drame des films d’Ozu s’apparente au surgissement du vrai sentiment des personnages, de ce qui habituellement se cache derrière les images et vient se manifester à leur surface. Dépasser les contraintes sociales ou familiales pour parler avec son cœur et se retrouver face à soi-même dans le regard complaisant de l’autre, tel est en substance le propos qu’Ozu n’a cessé de développer au fil de ses œuvres en cherchant toujours plus loin parmi les moyens offerts par le cinéma l’expression la plus subtile et la plus raffinée qu’il soit.
Nicolas Debarle
DVD : Coffret Ozu en 14 films et 1 documentaire, disponible en DVD, édité par Carlotta, à partir du 25/04/2014.
Rétrospective : Ozu à la Cinémathèque française du 23/04/2014 au 26/05/2014.
Au cinéma : Bonjour et Fin d’automne, version restaurée. En salles le 30/04/2014.

















 Suivre
Suivre