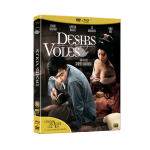Nous vous avions récemment parlé de Small Talk, documentaire de 2016 dans lequel Huang Hui-chen cherche à engager le dialogue avec sa mère, une prêtresse taoïste homosexuelle qui ne converse pas beaucoup avec sa famille. Ce geste de cinéma, où les maux au sein de la cellule familiale sont exorcisés, sera bientôt projeté en ligne via l’association Allers-Retours, suivi d’un débat entre la réalisatrice et Xiang Zi, metteuse en scène de A Dog Barking at the Moon. Nous avons eu la chance d’interviewer Huang Hui-chen par visioconférence.

Huang Hui-chen, pouvez-vous nous parler de la genèse de Small Talk, un documentaire très personnel sur vous, votre mère et votre famille ?
Quand j’avais 20 ans, un documentariste est venu tourner un film sur le travail de prêtresse taoïste (zhen tou) qui guide l’âme des défunts (qian wang), une profession que notre mère exerce et à laquelle nous participions, ma sœur et moi. Je me suis rendu compte que la forme était assez simple : on a juste besoin d’une personne et d’une caméra pour raconter une histoire. J’ai pris conscience que ce genre d’art cinématographique existait, et j’ai voulu l’utiliser pour faire le portrait de ma famille.
Ma première motivation pour filmer a été la haine, la haine de cette société, car j’ai toujours senti que je n’en faisais pas partie. À six ans, j’ai commencé à assister ma mère dans son travail, à dix ans j’ai quitté l’école et je n’ai jamais eu aucun diplôme. Ma mère est homosexuelle, et elle a quitté mon père sans même divorcer. La société juge tout ces éléments qui constituent mon identité, elle m’a toujours fait sentir que j’étais en dehors du courant dominant. C’est de là que je suis partie pour faire mon film. J’ai voulu prendre la parole dans ce flot de médias qui jugent les personnes qui vivent en marge. En fait, ils ne nous connaissent pas, et prendre la parole me permet de dire qui je suis, qui nous sommes. J’ai fait ce constat quand j’avais vingt ans. Et à partir de cette époque, j’ai commencé à participer à des mouvements sociaux, pour les droits des ouvriers et des femmes par exemple. J’ai mieux compris comment cette société fonctionnait, d’où viennent les oppressions, et avec l’âge, je trouve que cela va vers le mieux. Mais au final, ce qui m’importait après 18 ans, c’était de panser les blessures de la relation avec ma mère, c’est cela qu’il me fallait encore résoudre.
Vous avez donc commencé à filmer votre documentaire en 1998 ?
Oui, c’est cela, c’est l’année durant laquelle j’ai appuyé pour la première fois sur le bouton de la caméra. Au début, c’était très simple : je voulais juste tourner quelque chose. Je n’étais pas étudiante, je n’avais pas de projet cinématographique à réaliser, je voulais juste raconter une histoire. Cela a donné ce long-métrage, et une version courte pour la télévision. En 2009, je travaillais dans un syndicat de documentaristes, et c’est là que j’ai appris comment donner une forme finale à mon projet.
Y a-t-il une raison au fait que votre projet ait pris la forme d’un film ?
Ce projet est pour ma mère. J’ai essayé de lui écrire des lettres, elle n’y a jamais répondu. J’ai besoin d’interactions avec elle. La forme narrative du cinéma peut être comprise facilement par ma mère. Je ne suis pas écrivaine ni musicienne, et le cinéma est quelque chose que nous pouvons tous comprendre. C’est accessible… du moins c’est ce que je pensais au début ! En développant mon film au fil des années, j’ai compris que c’était compliqué (rires).
Small Talk a été vu dans de nombreux festivals à travers le monde. Cette lettre que vous avez adressée à votre mère, qui est une partie intime de vous, vous attendiez-vous à ce qu’elle soit lue par de très nombreuses personnes à travers le monde ?
Je ne m’y attendais pas du tout ! Mais le film nous a ouvert à un tout autre degré de diffusion. Il y a deux aspects dans ce que votre question sous-tend : j’ai toujours cet objectif d’engager le dialogue avec ma mère ; et le reste, c’est une expérimentation ! J’en constate les bienfaits : si le film n’avait été diffusé que dans le voisinage, ça n’aurait pas eu cet effet sur ma famille.
Est-ce que votre mère est intervenue dans les festivals à vos côtés ?
A Taïwan oui, mais pas en dehors, car elle a peur de l’avion. Au début du projet, ma mère s’est demandée qui regarderait ça. Traditionnellement, on ne parle de ce genre de choses en public, qui risque de jeter la honte sur la famille. Mais cette diffusion massive l’a beaucoup aidé a accepter la valeur du projet. Elle a donc eu confiance.
Votre film a dû être bien reçu qui plus est.
Oui. D’ailleurs, les projections et le succès ont aussi eu un impact sur moi-même, car j’apparais dans le film. Le trauma peut être transformé par l’Art, il devient autre chose. Ça m’a donné de la force et ça a donné de la force à d’autres personnes. Beaucoup de personnes sont venues me remercier d’avoir mis en scène un récit qu’on n’a pas l’habitude de voir, particulièrement de la part des communautés LGBTQ.
Dans l’étude des discours, le small talk est l’art de la petite conversation, parler de tout et de rien pour enrober les communications importantes. Sur certaines images utilisées pour la promotion du film, on voit d’ailleurs la mention « more than talk ». Pourquoi le choix de ce titre et comment le concept du small talk se diffuse-t-il dans le film ?
Le sens de small talk en mandarin est différent. Cela signifie conversation quotidienne, littéralement. Mais il est vrai que j’ai fait des recherches pour le nom anglais de ce concept. Quand j’ai choisi ce titre, Small Talk, que je voulais, les critiques à Taïwan m’ont dit que personne n’irait voir un film avec un titre pareil, parce que c’est nul ! Pourtant, c’est très intéressant et je suis contente que vous me posiez cette question, parce que c’est important. Les gens me la posent rarement. J’ai fait une recherche Google en tapant small talk, on trouve des images de cuisine, des photos joyeuses du quotidien… Comme vous dîtes, rien n’est important, on dit tout mais on ne dit rien. Je me suis demandé pourquoi on accorde autant d’importance à ces petites phrases, comme lorsque qu’à Taïwan, pour saluer, on demande « est-ce que vous avez mangé ? ». Pourquoi passe-t-on son temps à parler des choses qui n’ont aucune importance sans prendre le temps de parler des choses essentielles ? Adulte, on a beaucoup de temps qui est consommé par le travail, il faut aussi dormir, manger… Il reste peu de temps pour le reste. L’autre point qui m’a décidé à aborder le sujet sous cet angle, c’est que je n’ai jamais vraiment eu de conversation avec ma mère. Cela se résume presque à nous demander ce qu’on veut manger, sachant qu’elle fait la cuisine pour la famille comme on peut le voir dans le film. Parfois elle ne demande même pas et prépare le repas toute seule… Je voulais avoir plus de conversation avec ma mère, même des small talk. Pour la petite accroche « more than talk », il y une phrase en japonais qui dit « il faut lire l’air ». Il faut comprendre le langage, les paroles, en dehors de ce qu’il y a dedans, il faut lire les sentiments. Si vous vous souvenez, dans la scène de la confrontation avec ma mère, il y avait beaucoup de silence, de vide. Au début, je pensais qu’elle n’avait pas compris mes questions. Mais au fil du temps, en regardant tout ce matériau que j’ai enregistré, quelque chose a été capté. J’ai commencer à lire « l’air » de ma mère.

Dans votre documentaire, des propos très personnels apparaissent à l’écran. On y voit même le refus de certains propos, comme vos oncles et votre tante qui refusent d’évoquer l’homosexualité de leur sœur, et la gêne que cela engendre. Comment avez-vous pu convaincre votre famille d’apparence si pudique à se livrer ainsi ?
Mes oncles et ma tante sont des aînés assez âgés, et je profite de mon statut de membre plus jeune de la famille. Je ne suis pas à leurs yeux une journaliste qui viendrait les embêter sur un genre de nouvelle émission de télévision. Je n’apparais pas comme une menace. Et puis, ma famille est plutôt traditionnelle : on ne s’épanche pas trop sur l’amour filial. La dernière fois qu’on s’était contacté, c’était il y a une dizaine années, car un membre de la famille était mort. Il y a un peu de philosophie chinoise zen dans cette analyse. On ne sait pas quoi se dire… On pense à se voir mais on ne le fait pas toujours. Malgré tout, on y allé avec nos enfants, et on a été bien accueilli. Ce n’était pas vu comme un tournage, mais comme un film de réunion familiale. Je n’ai pas eu le refus de ma famille pour que le film soit diffusé. Si vous vous souvenez, il y a une séquence où j’ai demandé à mes oncles et ma tante s’ils savaient que ma mère était homosexuelle. Je pensais qu’ils allaient dire « oui, bien sûr » mais à la place, ils ont répondu d’un ton net qu’ils ne savaient pas ! Les spectateurs ont bien compris qu’ils savaient pourtant. En réalité, ça n’a jamais été un problème que ma mère soit gay. Le reniement que l’on voit à l’écran, c’est quelque chose que l’on observe dans les familles asiatiques. Ils voulaient précipiter la fin de la conversation en détournant le sujet, pour que cela soit plus simple. En fait, il n’était pas vraisemblable que ces gens âgés disent de manière franche « oui, on le savait et on l’accepte », même si c’est la vérité. En continuant la conversation, tous m’ont dit qu’ils connaissaient bien sûr l’attirance de ma mère pour les femmes, même si je n’ai pas mis ces séquences dans le film. Il y a beaucoup d’enfants homosexuels qui sont traités dans ce mutisme, qui évoluent dans un contexte familial où on ne les blâme pas mais où l’on masque tout questionnement autour du sujet, il devient inabordable. C’est cette raison, liée à la philosophie zen, qui a bloqué ma mère a contacter facilement sa famille et c’est pour cela, pour illustrer cette absence de communication, que je n’ai pas montré la suite de la conversation dans le film. Les gens de cette génération ne savent pas que c’est une chose dont on peut parler. Lorsqu’ils ont compris que je ne venais pas, avec ma caméra, reprocher quoique ce soit, ils ont commencé à se livrer. La famille s’est réconciliée, la parole s’est déliée. Ils ont alors saisi que c’est un sujet que l’on n’a pas besoin d’éviter. Maintenant, un de ces oncles me demande si les projections se sont bien passées et si j’ai gagné suffisamment d’argent (rires) ! La famille est devenue beaucoup plus unie, et grâce aux réseaux sociaux, mon oncle nous envoie toujours des salutations de la part de tous les aînés. Auparavant, ce sujet était un scandale, mais cela a été transformé par l’Art et cela a eu de très bons retours. Maintenant, même de la famille plus éloignée prend contact avec nous, en demandant pourquoi on n’a pas tourné chez eux ! (rires)

Votre mère dit des choses très intéressantes dans le documentaire, comme le fait qu’elle voudrait rester libre même si le mariage gay était légalisé (il l’a été depuis la sortie du documentaire, ndlr). Quel regard portez-vous sur votre mère après avoir fait le film ? A-t-il changé ?
J’apprécie vraiment cette question, car dans le monde sinophone, on simplifie très souvent cette relation entre les êtres humains. On a tendance à résumer mon histoire à une histoire d’amour filial entre une mère et une fille. Mais je voulais vraiment montrer cette complexité relationnelle. Qu’est-ce qui a changé après avoir filmé ? C’est la compréhension entre nous. J’ai dit que mon film était motivé par la haine, il se termine par la compréhension. J’ai appris à appréhender ma mère pas seulement comme une maman, mais comme une personne unique avec sa propre personnalité. Il y a deux aspects dans ce que je vous dis. Si je reste sur mon regard de fille, je vais conserver cette haine, car ma mère a dit que si elle avait pu choisir, elle n’aurait pas eu d’enfants. C’est un sentiment triste, car j’ai senti que mon existence était niée lorsqu’elle m’a dit cela. Mais j’ai essayé de regarder ma mère depuis un autre angle, celui d’un individu qui n’est pas dans ce rôle de fille. Ma mère a toujours endossé des rôles qu’elle ne voulait pas vivre. Elle s’est tout de même mariée, elle a été abusée, elle a eu des enfants, et a essayé de les faire grandir, de les accompagner dans la vie. De cet angle extérieur, je peux comprendre ma mère et éprouver du respect pour elle. Et puis il y a eu des changements en dehors du film me concernant. Maintenant que je suis moi-même maman, j’ai eu accès à un degré de compréhension supplémentaire.
La scène de confrontation/discussion autour de la table à la fin du film est emblématique. Ce qu’il s’y dit est intense et difficile. La scène est filmée de manière subtile et réfléchie, avec différents angles de prise de vue montés. Est-ce que l’on peut estimer que c’est la scène centrale du film ? A-t-elle été partiellement scénarisée ou répétée ?
C’est bien sûr la scène emblématique. Ce film a été créé pour cette scène. Je savais que je n’aurais qu’une chance dans ma vie d’avoir cette confrontation, donc ce n’était pas possible d’en faire quelque chose de scénarisé. J’ai effectué beaucoup de préparatifs pour cette journée particulière. J’ai parlé avec mon caméraman, on a placé trois caméras, et j’ai demandé à l’équipe de partir. Je savais qu’en présence de quelqu’un, ma mère n’aurait pas pu parler. On a mis une caméra au milieu, une autre dirigée vers ma mère et une dernière vers moi. La composition du plan repose ainsi sur l’égalité. On sait tous que la caméra est cruelle, qu’elle peut être utilisée comme une arme pour tirer sur quelqu’un, et c’est pour cela que je me suis mis la pression à moi-même en en dirigeant une vers moi. Je voulais cette pression pour me forcer moi aussi à avoir cette conversation. En tant que réalisatrice, j’ai bien sûr considéré ce positionnement pour le montage. Mon caméraman s’est amusé en disant qu’il n’a jamais eu un job aussi facile ! (rires) Mais c’est plus difficile que cela en a l’air, car il ne peut pas voir ce qu’il filme.

Parlons du bouddhisme dans votre film. Votre mère est prêtresse, alors que dans beaucoup de religions, les prêtres sont tenus au célibat. Appartient-elle à une branche spécifique ?
Le travail de ma mère prêtresse shamane se tient plutôt dans le cadre du taoïsme (les croyances dans certains pays d’Asie s’exercent parfois entre plusieurs religions, comme le taoïsme et le bouddhisme, ndlr). Dans le taoïsme, le célibat n’est pas demandé pour les prêtres et les prêtresses. Il y a beaucoup de différences selon les pays : les moines bouddhistes japonais peuvent se marier par exemple. Ce qui est intéressant dans cette question de la religion vis-à-vis de ma mère, c’est qu’elle-même est plutôt athée, elle n’est pas vraiment croyante, même si c’est son travail et qu’il lui convient. L’identité féminine de ma mère est toutefois atypique pour exercer ce métier, car un homme est réputé plus pur et disposant de plus d’énergie dans la tradition religieuse. Les règles des femmes sont considérées impures. Je vois ma mère comme quelqu’un qui a résisté contre beaucoup de choses. Elle vient de la campagne, mais elle préfère les filles ; dans la religion, on dit que les femmes ne peuvent pas faire ce métier, et elle le fait quand même.
Votre mère est quelqu’un de progressiste.
Oui, on pourrait dire cela, mais dans le cadre personnel, pas social. Ma mère n’a pas eu beaucoup d’éducation, elle vit sa vie pour être elle-même. Elle ne croit pas aux interdictions. C’est valable pour son attirance pour les femmes comme pour son métier, qu’elle exerce en étant athée. Elle se trouve d’ailleurs dans la pièce juste à côté et sera très contente que je lui dise ça ! (rires) De jeunes homosexuels lui ont d’ailleurs témoigné du respect pour cela.
Parlons maintenant de The Priestess Walks Alone. Il s’agit d’une version raccourcie de Small Talk, qui est chapitrée par des termes mystiques : summon, exorcism, salvation. Vous nous avez dit tout à l’heure qu’il s’agissait d’un montage pour la télévision. Pourquoi l’ajout de ces termes mystiques ?
Ce film a été financé partiellement par la NHK. J’avais contractuellement l’obligation d’en réaliser un montage pour la télévision japonaise. Cette version raccourcie permet aux spectateurs de rentrer plus facilement dans l’histoire. J’ai également voulu rappeler le processus de guidage des âmes des morts. J’effectue un parallèle avec l’objectif que je poursuis : j’appelle ce passé dont personne ne voulait parler, je le transforme, et je l’emmène au paradis. Ce n’est pas vraiment de la religion, mais une métaphore.

La défaillance de la communication entre un parent et un enfant sur fond de question d’orientation sexuelle des anciens a déjà été traité à plusieurs reprises dans les cinémas chinois contemporains. On pense notamment à A Dog Barking at the Moon de Xiang Zi, sorti en 2019. Avez-vous pu voir le film et si oui, qu’en avez-vous pensé ?
Non, je n’ai pas eu la chance de voir ce film, j’étais à Berlin cette année-là et c’est dommage. Il n’était pas diffusé à Taïwan d’ailleurs. Je vais contacter la réalisatrice, peut-être même que l’on pourra faire un échange.
Que pensez-vous de la place et de la réponse à la question des personnes LGBTQ dans la société taïwanaise ?
Taïwan est mieux loti que les autres pays asiatiques. Le mariage n’est plus limité aux seuls couples hétérosexuels. Les Taïwanais ne réagissent pas non plus comme les habitants des pays occidentaux, il est rare que les homosexuels soient violemment agressés. Mais comme pour le cas de ma famille, la règle, c’est que l’on n’en parle pas, donc on ne nous aide pas à protéger les droits des homosexuels non plus. En 2012, j’ai eu ma fille et ça a été un point de bascule : j’ai décidé de finir ce film. Coïncidence, cette année-là, un projet de loi a été soumis au Parlement pour protéger les droits des homosexuels. Auparavant silencieuse, la société s’est mise à parler, et les conservateurs se sont manifestés. Nous ne nous doutions pas qu’autant de gens étaient hostiles aux droits des personnes LGBTQ. Mais ça va de mieux en mieux. Je prends l’exemple de l’Allemagne, pour laquelle le droit des homosexuels s’est vu encore mieux protégé ces toutes dernières années, en l’inscrivant dans le droit civil, alors qu’auparavant, c’était un droit exceptionnel, comme à Taïwan. Des amis à moi se sont mariés en Allemagne, expressément pour ne pas être unis sous un régime exceptionnel, pour ne pas être considérés comme différents. Je veux même aller plus loin dans mon analyse : ce n’est pas qu’une question de mariage pour les personnes homosexuelles, il faut démolir ces jugements autour du mariage, même pour les hétérosexuels. Lors des réunions familiales, comme le nouvel an chinois, les aînés insistent sur les questions autour du mariage des plus jeunes, quand est-ce qu’ils vont avoir des enfants, etc. La véritable égalité, c’est de choisir la vie que l’on veut, y compris ne pas vouloir se marier. Ma mère porte la même idée que moi à ce niveau-là.
Small Talk est produit par 3H Production, la société de Hou Hsiao-hsien, et la musique est composée par Lim Giong, un collaborateur fidèle de Hou Hsiao-hsien. Comment Hou Hsiao-hsien en est venu à produire votre film ? L’avez-vous démarché ou a-t-il remarqué votre travail ?
Je n’ai pas de société de production qui m’est propre. J’ai signé un contrat avec la NHK et le réalisateur Hou Hsiao-hsien, qui est aussi le producteur de mon nouveau film. Je n’ai pas rencontré Monsieur Hou dans le monde du cinéma, mais dans les mouvements sociaux. Je sais que Hou est très célèbre en France, mais à Taïwan, on le connait également pour cette facette fortement engagée, pour les droits de l’homme, les droits d’accès à la santé, des animaux, des conditions de vie des prostituées… [Huang Hui-chen nous adresse le lien de cet article dans le chat de la réunion Zoom, ndlr]. C’est dans cette manifestation de 2008 que je l’ai rencontré, nous nous étions rasés le crâne pour la défense des droits des aborigènes. Concernant Lim Giong, on pense effectivement à l’évocation de son nom qu’il compose beaucoup de musique pour Hou Hsiao-hsien. Pourtant, leurs apports sur mon film ne sont pas connectés. J’ai rencontré Lim Giong au Festival de Busan, à un cocktail où il y avait énormément de bruit. Lui qui est une vedette de l’industrie musicale, une star, je lui ai raconté une histoire ; nous nous étions rencontrés il y a très longtemps, lors que j’étais encore prêtresse (donc avant mes 20 ans) et qu’il était venu assisté à une cérémonie. Je me suis toujours souvenu qu’il était là. Je lui ai dit que je faisais de mon histoire, un film. Il a été très touché, a déclaré que c’était le destin et qu’il allait faire la musique du film. Lim étant devenu un grand croyant bouddhiste ces dernières années, il m’a rassuré quant à l’argent que sa participation allait coûter et qu’il allait m’aider. En fait, je n’ai démarché ni Hou Hsiao-hsien, ni Lim Giong, car ce n’est pas dans mon caractère. Ce sont eux qui ont proposé leur aide, si bien que lorsque que Lim a intégré l’équipe, Hou s’est écrié « Ah bon, tu es là-dessus aussi ? » (rires). Hou est très courageux, il a proposé de m’aider alors qu’il n’avait rien vu de ce que je faisais.
Pouvez-vous nous en dire à propos de votre nouveau film ?
Il s’agit justement d’un film qui parle de mouvement social, précisément de l’article que je vous ai envoyé. On y a manifesté avec des membres d’une tribu de Taipei forcés de quitter leur zone d’habitation au profit de constructions modernes. Eux essayaient de conserver leur Terre, mais la mairie de Taipei ne voulait rien entendre. Les aborigènes ont une conception différente de la propriété terrienne, comme les amérindiens, ce n’est pas quelque chose que l’on peut vendre ou échanger ; c’est un élément qui a rapport aux ancêtres et aux esprits. Ce mouvement continue aujourd’hui et mon ex-mari en est la figure de proue. Je filme ce documentaire depuis 2008, et la période principale s’étend jusqu’à 2012, année de naissance de ma fille. L’histoire de ce mouvement du début à sa fin n’est pas le sujet du film. Mon intention est de répondre toujours à la même question : comment s’entendre avec quelqu’un qui nous a fait du mal. Nous deux sommes d’origine chinoise, et lorsque la manifestation était en passe de réussir, les aborigènes ont dit que nous pouvions partir, car nous sommes différents. Pourtant nous vivons tous sur la même île, nous ne pouvons pas nous en aller. Oui, nos ancêtres et le gouvernement leur ont fait du mal, mais c’est l’affaire de tous les habitants de Taïwan, c’est le vivre-ensemble. En creux, j’explore la métaphore personnelle de cette relation avec mon mari. Nous sommes divorcés, suite à des conflits et des désaccords. Notre enfant nous rattache, comme l’Histoire de cette île. Comment réagir au mal déjà fait ? J’ai sans doute encore besoin de plusieurs années pour que la sédimentation se fasse. Je ne sais pas encore quand cela va sortir.
Quel est votre moment de cinéma, un film ou une scène qui vous ait marqué dans le monde du cinéma ?
Je pense au film Siao Yu de Sylvia Chang (1995). Avant de voir ce film, j’imaginais seulement le cinéma comme une histoire. Siao Yu m’a fait comprendre qu’il y avait quelque chose de plus, qui questionne ce que l’on veut apporter au spectateur. C’est l’histoire d’une femme qui veut rejoindre les États-Unis sur fond de tradition chinoise. Son mariage est blanc, mais va se rendre compte du sens de la vie comme femme. C’est cela qu’il faut ramener au spectateur, au monde. C’est un message qu’il faut diffuser.
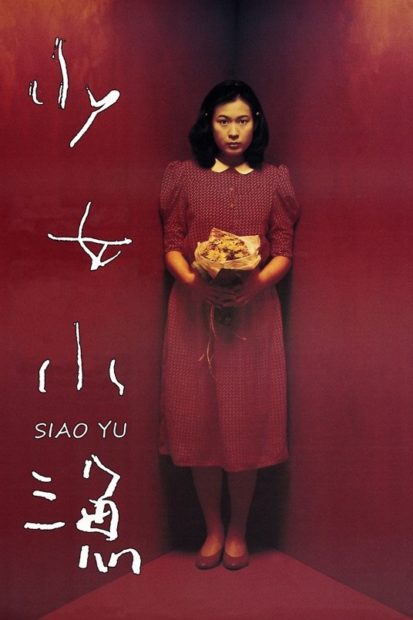
Propos recueillis par Maxime Bauer par réunion Zoom, le 10/04/2021.
Remerciements particuliers à Ko Yen-ju de l’association Allers-Retours pour la traduction.
Sujet connexe : interview de Xiang Zi.
Small Talk de Huang Hui-chen. Taïwan. 2016.






 Follow
Follow